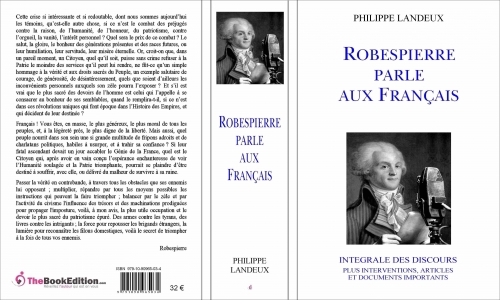mercredi, 04 mai 2011
ROBESPIERRE Histoire (version développée)
« Robespierre, ce nom qui fait ta gloire, ce nom qui porte l’effroi dans l’âme des tyrans, sera le mot d’ordre qui nous ralliera pour les combattre. »
Les Jacobins de Caen à Robespierre (alors simple citoyen), 7 mars 1792
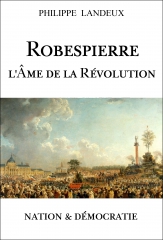 Robespierre fut un grand homme, un grand Français, le député le plus populaire et le plus grand révolutionnaire. En tant que tel, il fut l’objet d’attaques incessantes. Sa mémoire même fut souillée de calomnies. Même les raccourcis que l’histoire oblige parfois à faire transforment son portait du tout au tout. Ainsi, son nom est aussi célèbre que son histoire réelle et son œuvre sont méconnues du grand public.
Robespierre fut un grand homme, un grand Français, le député le plus populaire et le plus grand révolutionnaire. En tant que tel, il fut l’objet d’attaques incessantes. Sa mémoire même fut souillée de calomnies. Même les raccourcis que l’histoire oblige parfois à faire transforment son portait du tout au tout. Ainsi, son nom est aussi célèbre que son histoire réelle et son œuvre sont méconnues du grand public.
Il est pourtant primordial de connaître la véritable histoire et les idées de cet homme qui incarna la Révolution et inspira des générations de patriotes. Les Français ignorent tout ce qu’ils lui doivent ; la République elle-même a oublié qu’elle lui doit jusqu’à sa devise. Bien qu’il ait vécu et ait été exécuté il y a plus de deux cents ans, beaucoup de ses idées sont encore révolutionnaires, plus révolutionnaires que celles des révolutionnaires autoproclamés, et la vie de cet homme que l’on appelait l’Incorruptible reste un exemple.
Je me flatte d’être robespierriste. Et si l’on me demande pourquoi, ou pourquoi je tiens tant à défendre sa mémoire et à rappeler son souvenir dans toute son authenticité, qu’il me suffise de citer ce mot de Babeuf :
« Le robespierrisme est dans toute la République, dans toute la classe judicieuse et clairvoyante, et naturellement dans tout le peuple. La raison en est simple, c’est que le robespierrisme est la démocratie, et ces deux mots sont parfaitement identiques : donc en relevant le robespierrisme, vous êtes sûr de relever la démocratie. »
Il est impossible d’exposer ici la richesse de la pensée de Robespierre. Pour la connaître, il faut lire ses discours ou, au moins, de bonnes biographies (Jean Massin, Ernest Hamel) ou de bonnes histoires de la Révolution (Albert Mathiez, Albert Soboul, Georges Lefebvre). Mais pour se plonger ainsi dans l’étude, encore faut-il en sentir l’intérêt et ne plus avoir de lui l’image fausse et négative qui est généralement colportée.
Peindre Robespierre sous son véritable jour et anéantir les fausses idées reçues à son sujet pour donner envie de le lire est donc le but que je me propose. J'ai réalisé deux exposés dont le présent est la version développée. (version courte ici)
ROBESPIERRE Maximilien Marie Isidore (de) :
Né le 6 mai 1758 à Arras, exécuté à Paris le 28 juillet 1794 (10 thermidor an II). Avocat, homme politique français, surnommé l’Incorruptible, universellement reconnu comme tel, figure emblématique de la Révolution française et du jacobinisme.
AVANT la Révolution
Sa mère mourut alors qu’il n’avait que six ans. Son père, avocat au barreau d’Arras, abandonna le foyer peu après. Elève studieux, il obtint des autorités ecclésiastiques une bourse pour le collège Louis le Grand, à Paris, où il fut sans doute l’élève le plus brillant puisque c’est à lui que revint l’honneur de faire au nom du collège le compliment à Louis XVI au retour de son sacre (le 11 juillet 1775).
Reçu avocat au parlement de Paris le 2 août 1781, il retourna à Arras où il fut admis au barreau de la ville le 8 novembre. Il avait encore de la famille sur place, grands-parents, oncles, tantes, et notamment sa sœur, Charlotte, et son jeune frère, Jean-Bon Augustin, appelé Augustin, surnommé Bonbon et plus tard Robespierre jeune, qu’il envoya étudier à Paris grâce à une bourse que son brillant parcours lui avait permis de décrocher pour lui. Son frère lui fut fidèle jusque dans la mort.
Il apparut de suite comme un avocat et un esprit brillants (cf. lettre de M. Ansart). Grand admirateur de Jean-Jacques Rousseau, il se fit le défenseur des faibles, des pauvres, des lumières. L’affaire la plus célèbre qu’il eut à plaider fut celle du paratonnerre de St-Omer, en mai 1783, qui, grâce à la publication de sa plaidoirie (procédé auquel il recourut régulièrement par la suite), eut un retentissement national. Dans son argumentaire, il invoquait entre autres les travaux d’un certain Marat, le futur Ami du Peuple. Une autre affaire retint l’attention, en 1786, celle de François Deteuf, maître cordier à Marchiennes, accusé de vol par un moine de l'abbaye de Saint-Sauveur d'Anchin qui se vengeait ainsi de sa sœur, Clémentine Deteuf, laquelle avait refusé ses avances. En défendant Deteuf, Robespierre n’attaquait pas la religion mais les vices d’une institution qui avait couvert les turpitudes du moine.
En mars 1782, il s’était vu attribuer un siège vacant de juge à la Salle épiscopale. La même année, il entrait dans la Société des Rosati, des jeunes gens réunis par l'amitié, le goût des vers, des roses et du vin, réunissant tout le gratin d’Arras. Il y croisa Lazarre Carnot, son futur collègue et ennemi au Comité de salut public. Il y rencontra également Joseph Fouché, oratorien, cheville ouvrière du complot du 9 thermidor. Le 15 novembre 1783, il fut admis à l’académie d’Arras dont il fut élu président à l’unanimité le 4 février 1786. En 1784, il remporta le deuxième prix du concours de l’académie de Metz, sur « l'origine de l'opinion qui étend sur tous les individus d'une même famille une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit un coupable ».
Quoique le tableau soit brossé à grands traits, il ressort que Robespierre, avant la Révolution, avait tout pour lui : talent, culture, réussite et reconnaissance sociale. Voir en lui un personnage aigri et envieux relève de l’absurde. L’affirmation selon laquelle Robespierre aurait été franc-maçon relève elle aussi du fantasme.
Le 8 août 1788, le royaume étant au bord de la banqueroute, le roi convoqua les Etats Généraux, c’est-à-dire l’assemblée censée représenter le corps social à travers les trois ordres d’alors : la Noblesse, le Clergé et le Tiers Etat. Cette assemblée était seule autorisée à voter la levée de nouveaux impôts et c’est à cette seule fin qu’elle avait été convoquée. Pourtant, dans le même temps, chaque partie du peuple était appelée à rédiger ses doléances et le Tiers Etats comptait bien profiter de l’occasion pour les faire valoir.
Comme tant d’autres, Robespierre s’empara de la plume. En janvier, il publia anonymement un « Appel à la nation artésienne sur la nécessité de réformer les États d’Artois », brochure dans laquelle il dénonçait la composition illégale des Etats d’Artois permanents, le mode de composition desdits Etats pour les Etats généraux (d’après lesquelles le véritable Tiers ne devait avoir que 10 voix sur 150) et tous les abus qui en découlaient. Cette brochure fut rééditée en avril, preuve de son succès. Son leitmotiv tenait dans cette phrase : « Rendez-lui [au Peuple] la liberté de choisir lui-même ses Représentans, l’Ordre renaît et les abus disparaissent. »
En mars suivant, il publia une adresse au peuple artésien dans laquelle il lui indiquait comment choisir ses représentants :
« Défiez-vous du patriotisme de fraîche date, de ceux qui vont partout prônant leur dévouement intéressé, et des hypocrites qui vous méprisaient hier et qui vous flattent aujourd’hui pour vous trahir demain. Interrogez la conduite passée des candidats : elle doit être le garant de leur conduite future. Pour servir dignement son pays, il faut être pur de tout reproche. »
Fin mars, la corporation des savetiers, la plus pauvre et la plus nombreuse de la ville, chargea Robespierre de rédiger ses doléances. Le 26 avril, il fut élu député du Tiers Etats d’Artois (5e sur 8). Robespierre était lancé dans la carrière politique qui fut toute sa vie.
C’est au début de la Constituante — probablement après le 14 juillet 1789, et non immédiatement après son élection — que Robespierre rédigea pour lui-même une dédicace aux mânes de Jean-Jacques Rousseau dans laquelle il traça la conduite qui fut en effet la sienne et qui, à ce titre, mérite d’être citée :
« La conscience d’avoir voulu le bien de ses semblables est le salaire de l’homme vertueux ; vient ensuite la reconnaissance des peuples qui environnent sa mémoire des honneurs que lui ont déniés ses contemporains. Comme toi je voudrais acheter ces biens au prix d’une vie laborieuse, aux prix même d’un trépas prématuré. Appelé à jouer un rôle au milieu des plus grands événements qui aient jamais agité le monde, assistant à l’agonie du despotisme et au réveil de la véritable souveraineté, près de voir éclater des orages amoncelés de toutes parts, et dont nulle intelligence humaine ne peut deviner tous les résultats, je me dois à moi-même, je devrai bientôt à mes concitoyens compte de mes pensées et de mes actes ».
Etats Généraux / Assemblée constituante
Robespierre était lancé dans la carrière politique. Ses principes étaient simples : unité nationale, souveraineté du peuple, égalité des citoyens en droits. Il n’en démordit jamais. Il devint ainsi le champion de la démocratie et de l’Egalité. Il en fut le martyr. Le 24 septembre 1791, le journal L’Ami du Roi lui rendit hommage en croyant le brocarder : « M. Robespierre, qui a toujours l’air de croire que ces discussions sont sérieuses [l’Assemblée retirait aux hommes libres de couleur les droits qu’elle leur avait accordés quatre mois plus tôt], monte à la tribune, armé d’un mortel discours. Ses raisons, on le devine. Unité, égalité, ces deux mots disent tout. »
Les Etats Généraux s’ouvrirent le 5 mai 1789, à Versailles. Robespierre qui, le lendemain, fêta ses 31 ans, était alors un inconnu au milieu de cette foule de 1139 députés. Il prit la parole pour la première fois le 18 mai. Il intervint des centaines de fois, que ce soit aux Etats Généraux ou à l’Assemblée constituante qui les remplaça officiellement le 27 juin 1789, et toujours pour défendre le peuple et les principes. En quelques mois, sa ténacité et sa rigueur le rendirent célèbre et populaire. Il n’était pas seulement un des députés siégeant du côté gauche, il fut très vite considéré comme le plus à gauche, à tel point qu’il était souvent isolé et devait soutenir ses idées seul contre tous. (Ainsi, le 3 mai 1790, Loustalot écrivit dans Les Révolutions de Paris : « Nous avons peu de ces hommes qui, cherchant plutôt à remplir leur devoir qu’à obtenir des applaudissements, se tiennent, comme M. de Robespierre, près des principes, et qui, bravant le reproche d’être trop chaleureux, réclament sans cesse les droits sacrés du peuple, lors même qu’ils prévoient qu’ils vont être sacrifiés. [...] Il vient de donner une nouvelle preuve de ce genre d’héroïsme en défendant seul la maintenue des districts de Paris. ») Si, dans ces conditions, il ne pouvait guère influencer les décisions de l’Assemblée à l’esprit bourgeois et aristocratique, en revanche son prestige atteignit des sommets inimaginables. Ce fut sa gloire et son malheur. Car il eut toujours plus de prestige que de pouvoir réel. Son ascendant sur les masses permit à ses détracteurs de le présenter comme un dictateur et de l’abattre en tant que tel alors qu’il n’eut jamais d’autre arme que le verbe au service de la raison.
Il est impossible de rappeler ici toutes les idées qu’il défendit, tous les discours qu’il prononça ou publia. Signalons néanmoins les plus importants.
Fin septembre 1789, il s’éleva contre le droit de veto accordé au roi. La discussion ayant été fermée avant qu’il ait pu prononcer son discours, il le publia :
« Celui qui dit qu’un homme a le droit de s’opposer à la Loi, dit que la volonté d’un seul est au-dessus de la volonté de tous. Il dit que la nation n’est rien, et qu’un seul homme est tout. S’il ajoute que ce droit appartient à celui qui est revêtu du Pouvoir exécutif, il dit que l’homme établi par la Nation, pour faire exécuter les volontés de la Nation, a le droit de contrarier et d’enchaîner les volontés de la Nation. »
Le 22 octobre 1789, il s’éleva contre la distinction faite entre citoyens dits actifs (payant « une imposition directe de la valeur locale de trois journées de travail ») et citoyens dits passifs qui privait ces derniers de nombreux droits, dont celui de cité et celui de faire partie de la garde nationale. Il prônait, lui, le suffrage universel (pour les hommes, l’idée même de l’accorder aux femmes étant à l’époque inconcevable). Il ne fit pas de grands discours à ce sujet à cette époque. La moindre allusion soulevait un tollé général. En revanche, il en publia un et en donna lecture au club des Cordeliers en avril 1791. Rappelant les articles de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée par l’Assemblée l’année précédente et montrant la contradiction entre ses articles et la notion de suffrage censitaire, il poursuivait :
« Mais quel est donc après tout ce rare mérite de payer un Marc d’argent ou telle autre imposition à laquelle vous attachez de si hautes prérogatives ? Si vous portez au trésor public une contribution plus considérable que la mienne, n’est-ce pas par la raison que la société vous a procuré de plus grands avantages pécuniaires ? et, si nous voulons presser cette idée, quelle est la source de cette extrême inégalité des fortunes qui rassemble toutes les richesses en un petit nombre de mains ? Ne sont-ce pas les mauvaises lois, les mauvais gouvernements, enfin tous les vices des sociétés corrompues ? Or, pourquoi faut-il que ceux qui sont les victimes de ces abus, soient en plus punis de leur malheur, par la perte de la dignité de citoyen ! »
Fin décembre 1790, il publia un grand discours sur l’organisation des gardes nationales, dénonçant une fois de plus la distinction des citoyens entre passifs et actifs et les incohérences de l’Assemblée mais entrant aussi dans le détail de leur organisation selon les principes.
« La plus inévitable de toutes les loix, la seule qui soit toujours sûre d’être obéie, c’est la loi de la force. L’homme armé est le maître de celui qui ne l’est pas ; un grand corps armé, toujours subsistant au milieu d’un peuple qui ne l’est pas, est nécessairement l’arbitre de sa destinée ; celui qui commande à un corps, qui le fait mouvoir à son gré, pourra bientôt tout asservir. […] S’il est vrai que cette institution soit un remède contre le pouvoir exorbitant qu’une armée toujours sur pied donne à celui qui en dispose, il s’ensuit qu’elles ne doivent point être constituées comme les troupes de ligne ; qu’elles ne doivent point être aux ordres du prince ; qu’il faut bannir de leur organisation tout ce qui pourrait les soumettre à son influence ; puisqu’alors, loin de diminuer les dangers de sa puissance, cette institution les augmenterait, et qu’au lieu de créer des soldats à la liberté et au peuple, elle ne ferait que donner de nouveaux auxiliaires à l’ambition du prince. »
C’est à la fin de ce discours qu’il formula la devise que les gardes nationales devaient selon lui arborer sur leurs drapeaux : Liberté, Egalité, Fraternité.
Peu de gens savent que Robespierre fut le premier à réclamer l’abolition de la peine de mort (30 mai 1791). Quant à ceux qui ont vu dans ses positions ultérieures une contradiction, ils ont confondu Badinter et Robespierre. Ce n’est pas par humanité ou par sensiblerie que ce dernier l’avait réclamée, mais au nom des principes, au nom du droit à la légitime défense que les individus ont face à leurs agresseurs mais que la société n’a pas face à des auteurs de crimes ou délits de droit commun qui ne la menacent pas.
« Hors de la société civile, qu’un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que, repoussé vingt fois, il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé, puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue ; et la loi de la défense naturelle me justifie et m’approuve. Mais dans la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l’autoriser à lui donner la mort ? »
La France était alors en paix. Mais quand la France fut en guerre et la République, menacée, quand la société eut à se défendre, le même principe l’autorisait à tuer et justifiait l’exécution des contre-révolutionnaires. C’est ce qu’il explicita le 2 décembre 1792, lors du procès du roi :
« J’ai demandé l’abolition de la peine de mort à l’assemblée que vous nommez encore constituante ; et ce n’est pas ma faute si les premiers principes de la raison lui ont paru des hérésies morales et politiques. Mais vous, qui ne vous avisâtes jamais de les réclamer en faveur de tant de malheureux dont les délits sont moins les leurs que ceux du gouvernement, par quelle fatalité vous en souvenez-vous seulement pour plaider la cause du plus grand de tous les criminels ? Vous demandez une exception à la peine de mort pour celui-là seul qui peut la légitimer. Oui, la peine de mort, en général, est un crime, et par cette raison seule que, d’après les principes indestructibles de la nature, elle ne peut être justifiée que dans les cas où elle est nécessaire à la sûreté des individus ou du corps social. Or, jamais la sûreté publique ne la provoque contre les délits ordinaires, parce que la société peut toujours les prévenir par d’autres moyens, et mettre le coupable dans l’impuissance de lui nuire. »
Robespierre eut maintes fois l’occasion de démontrer qu’il n’était ni sectaire ni fanatique, qu’il ne se souciait que du bien commun, qu’il n’était attaché qu’aux principes et à la vérité et méprisait autant les démagogues que ce que nous appelons aujourd’hui le politiquement correct. Le 13 juillet 1791, il en donna un exemple en donnant aux Jacobins une leçon de république.
« On m’a accusé, au sein de l’assemblée, d’être républicain, on m’a fait trop d’honneur, je ne le suis pas. Si on m’eût accusé d’être monarchiste, on m’eut déshonoré, je ne le suis pas non plus. J’observerai d’abord que pour beaucoup d’individus les mots de république et de monarchie sont entièrement vides de sens. Le mot république ne signifie aucune forme particulière de gouvernement, il appartient à tout gouvernement d’hommes libres, qui ont une patrie. Or, on peut être libre avec un monarque comme avec un sénat. Qu’est-ce que la constitution française actuelle, c’est une république avec un monarque. Elle n’est donc point monarchie ni république, elle est l’un et l’autre. »
Un an plus tard, il précisa encore sa pensée :
« Est-ce dans les mots de république ou de monarchie que réside la solution du grand problème social ? Sont-ce les définitions inventées par les diplomates pour classer les diverses formes de gouvernement qui font le bonheur et le malheur des nations, ou la combinaison des lois et des institutions qui en constituent la véritable nature ? Toutes les constitutions politiques sont faites pour le peuple ; toutes celles où il est compté pour rien, ne sont que des attentats contre l’humanité ! Eh ! que m’importe que de prétendus patriotes me présentent la perspective prochaine d’ensanglanter la France, pour nous défaire de la royauté, si ce n’est pas la souveraineté nationale et l’égalité civile et politique qu’ils veulent établir sur ses débris ? Que m’importe qu’on s’élève contre les fautes de la cour, si loin de les réprimer, on ne cesse de les tolérer et de les encourager, pour en profiter ? Que m’importe que l’on reconnaisse, avec tout le monde, les vices de la constitution qui concernent l’étendue du pouvoir royal, si on anéantit le droit de pétition ; si on attente à la liberté individuelle, à celle même des opinions ; si on laisse déployer contre le peuple alarmé une barbarie qui contraste avec l’éternelle impunité des grands conspirateurs ; si on ne cesse de poursuivre et de calomnier tous ceux qui, dans tous les tems, on défendu la cause de la nation contre les entreprises de la cour et de tous les partis ? » (17 mai 1792)
A défaut d’avoir influencé l’ouvrage constitutionnel de l’Assemblée, Robespierre parvint à faire prévaloir son opinion sur des sujets annexes. Ce n’est pas parce qu’il était idiot ou ridicule qu’il n’était pas écouté, mais parce que ses principes contrariaient les intérêts des privilégiés. Et ce n’est pas non plus parce que les privilégiés étaient d’accord avec lui qu’il leur arriva de soutenir ses propositions, mais parce qu’ils n’avaient alors rien à perdre ou poursuivaient un autre but que lui. C’est ainsi qu’il obtint, en mai 1791, que les constituants, afin de ne pas prêter le flanc à la corruption, ne soient pas rééligibles (l’Assemblée limita cependant la portée de ce décret à la législature suivante). Dans le même esprit, et afin que le peuple, à défaut de faire les lois lui-même, ait au moins la consolation de renouveler souvent ses mandataires, il avait demandé en vain que le mandat de député soit limité à un an.
La Législative
Quand l’Assemblée nationale constituante acheva sa session, le 30 septembre 1791, la popularité de Robespierre était prodigieuse. Les Parisiens lui firent un triomphe. Il était rendu à la vie civile. Mais il avait trop fréquenté les hommes pour penser que son rôle était terminé. Tout commençait. Il lui restait la tribune des Jacobins que sa popularité et son intransigeance avait sauvés du désastre d’une scission et renforcés au mois de juillet précédent. (La fuite du roi en juin 1791, puis son rétablissement par l’Assemblée, avait provoqué un mouvement en faveur de sa déchéance qui suscita des divisions au sein des Jacobins que tous les leaders, excepté une poignée, quittèrent pour fonder un autre club, les Feuillants.)
Il connaissait mieux que quiconque les hérésies de la constitution de 1791. En renvoyant dans leurs foyers les députés sortants, il espérait que les députés nouveaux, éclairés par deux ans et demie de révolution, perfectionneraient l’ouvrage. Telle était sa conception du régime parlementaire. Il ne tarda pas à déchanter et à prendre ses responsabilités.
La nouvelle assemblée, dite législative, n’était plus composée que de bourgeois qui subirent rapidement l’ascendant d’un petit groupe d’entre eux, pour beaucoup originaires de Bordeaux, d’où leur nom de Girondins. (Nombre de Girondins, dont le plus fameux, Brissot, étaient inscrits aux Jacobins.) Représentant l’aristocratie de l’argent, les Girondins poussèrent l’Assemblée dans l’ultra-libéralisme. Leur devise était pour ainsi dire : Propriété, Liberté. Leur philosophie du libre échange se traduisait en pratique par la liberté d’accaparer, d’exploiter et d’affamer. N’y tenant plus, Robespierre lança son propre journal en mai 1792, intitulé Le défenseur de la Constitution. Il expliquait sa position, en apparence paradoxale, de manière suivante :
« C’est la constitution que je veux défendre, la constitution telle qu’elle est. On m’a demandé pourquoi je me déclarais le défenseur d’un ouvrage dont j’ai souvent développé les défauts : je réponds que, membre de l’Assemblée constituante, je me suis opposé, de tout mon pouvoir, à tous les décrets que l’opinion publique proscrit aujourd’hui : mais depuis le moment où l’acte constitutionnel fut terminé et cimenté par l’adhésion générale, je me suis toujours borné à en réclamer l’exécution fidèle, non pas à la manière de cette secte politique que l’on nomme modérée, qui n’en invoque la lettre et les vices que pour en tuer les principes et l’esprit ; non pas à la manière de la cour et des ambitieux qui, violant éternellement toutes les lois favorables à la liberté, exécutent avec un zèle hypocrite et une fidélité meurtrière toutes celles dont ils peuvent abuser, pour opprimer le patriotisme ; mais comme un ami de la patrie et de l’humanité, convaincu que le salut public nous ordonne de nous réfugier à l’abri de la constitution, pour repousser les attaques et l’ambition du despotisme. »
Chose plus surprenante, les Girondins avaient la passion de la guerre. A peine en poste, ils présentèrent les nobles émigrés réunis à Coblentz (Allemagne) comme un danger majeur et n’eurent de cesse d’engager la France dans une croisade pour la liberté. Leur but était double : détourner l’attention de leur politique intérieure et renflouer les finances publiques toujours mal en point avec du butin. Ils présentèrent également la guerre comme le moyen de démasquer le roi s’il trahissait. La suite leur donna raison mais prouva aussi que cet argument n’étaient pour eux qu’un prétexte.
Robespierre s’opposa de toutes ses forces à cette entreprise guerrière. Il prononça trois grands discours contre la guerre, les 18 décembre 1791, 2 et 11 janvier 1792. Selon lui, la guerre était inutile, les véritables ennemis de la Révolution étant à l’intérieur ; elle serait désastreuse, l’armée française étant désorganisée (en raison de l’émigration des officiers nobles et des conflits entre eux et la troupe), mal armée et les défenses de la France étant en ruine ; elle était dangereuse, car elle servait les desseins de la Cour qui en aurait la direction alors même qu’elle comptait sur les puissances étrangères pour étouffer la Révolution ; elle ruinerait la France ; elle dresserait contre la France les peuples étrangers (d’où son mot fameux : « Personne n’aime les missionnaires armés. ») ; elle exposerait au césarisme en cas de conflit prolongé. Ses arguments étaient sans réplique. Battus aux Jacobins dont ils faisaient alors partie, les Girondins travaillèrent l’Assemblée et les provinces. Le 20 avril 1792, Louis XVI, au nom de l’Assemblée nationale, déclarait la guerre à l’Empereur d’Autriche, une guerre inutile (les monarchies européennes, occupées à se déchirer entre elles, n’avaient pas l’intention de faire la guerre au pays le plus peuplé et le plus puissant d’Europe) qui allait durer plus de vingt ans.
La guerre ayant été déclarée bien malgré lui, Robespierre ne songea plus qu’aux moyens de la gagner.
« Messieurs, puisque la guerre est décrétée, je suis aussi d’avis de conquérir le Brabant, les Pays Bas, Liège, la Flandre, etc. La seule chose qui doive nous occuper désormais, ce sont les moyens d’exécuter cette utile entreprise ; c’est-à-dire, dans ce moment il faut faire, comme je l’ai proposé plusieurs fois, non pas la guerre de la cour et des intrigans dont la cour se sert, et qui à leur tour se servent de la cour, mais la guerre du peuple ; il faut que le peuple français se lève désormais et s’arme tout entier, soit pour combattre au-dehors, soit pour veiller le despotisme au-dedans. [...] Qu’on ne vienne pas nous dire : la guerre est déclarée, il ne faut pas décourager nos généraux ; il faut avoir confiance dans les autorités constituées. Non : c’est maintenant sur-tout qu’il faut surveiller le pouvoir exécutif et les autorités constituées. A cette condition, je ne crains pas non plus le pouvoir exécutif, ni les intrigues des traîtres de l’intérieur ; mais pour remplir cette condition, il faut croire à ces intrigues. [...] Ce n’est pas le roi ; le roi est un homme qui veut l’autorité absolue ; c’est un homme qui par lui-même est incapable de concevoir ce projet ; le roi est un homme qui, s’il avait été entouré d’hommes capables de lui faire entendre ses intérêts, aurait courbé sa tête sous la constitution. [...] »
Comme prévu, les premières rencontres avec l’ennemi tournèrent à la déroute. Le 27 mai, l’Assemblée décréta la déportation des prêtres réfractaires (à la constitution civile du clergé) qui prêchaient la contre-révolution. Le 8 juin, à l’appel du ministre de la guerre, girondin, elle décréta l’établissement sous les murs de Paris d’un camp de 20.000 fédérés, c’est-à-dire de gardes nationaux tirés des départements. Craignant que les fédérés ne soient choisis parmi les contre-révolutionnaires, Robespierre dénonça cette mesure aux Jacobins (il changea d’avis quand il vit que les fédérés étaient des patriotes). Le 11 juin, le roi apposa son veto sur ces deux décrets et, le lendemain, renvoya les ministres girondins qui n’avaient plus d’utilité à ses yeux puisque la guerre était déclarée. Le 20 juin, malgré les efforts de Robespierre pour s’y opposer, les Girondins soulevèrent les quartiers populaires de Paris pour que le roi reprenne des ministres parmi eux. Le peuple envahit les Tuileries où résidait le roi. Louis XVI fut humilié mais ne céda rien. Apprenant cela, La Fayette qui commandait une armée (en toute illégalité) tomba le masque. Il accourut illégalement à Paris dans l’espoir de soulever la garde nationale pour écraser les Jacobins, mais elle ne répondit pas à son appel et il s’en retourna tout piteux. Brissot et Robespierre étaient enfin d’accord sur quelque chose : La Fayette était un traître (les patriotes le considéraient ainsi de longue date) ; l’Assemblée devait le décréter d’accusation. Mais tandis que les Girondins ne savaient plus à quel Saint se vouer, Robespierre qui, dès le 10 février, avait rejeté les mesures partielles ne vit plus de salut que dans une insurrection qui renverserait la monarchie.
Aux déclarations illusoires de l’Assemblée qui décréta la patrie en danger le 11 juillet, aux mesures dilatoires des Girondins qui, autoproclamés républicains en 1791, ne cessaient de ménager le roi en 1792 pour régner en sous-ordre et menaçaient alors les républicains « du glaive de la loi », Robespierre allait droit au but et comptait sur les fédérés pour l’atteindre. « Vous n’êtes point venus pour donner un vain spectacle à la capitale et à la France… Votre mission est de sauver l’état. » (Aux Jacobins, le 11 juillet) Tandis que l’Assemblée et les Girondins s’évertuaient à les envoyer aux frontières, lui n’avait de cesse de les retenir à Paris (16 juillet). C’est lui qui rédigea les pétitions indignées contre le roi et les faiblesses de l’Assemblée que les fédérés présentèrent en leur nom. C’est à son appel que les sections parisiennes abolirent la distinction entre citoyens actifs et passifs pour que tous les citoyens puissent intégrer la garde nationale. C’est chez lui que les premières réunions en vue d’une insurrection unissant fédérés et Parisiens se tinrent. C’est lui que Pétion, son ancien collègue, alors maire de Paris, vint trouver dans l’espoir d’arrêter l’insurrection. Mais les dés étaient jetés. L’Assemblée n’ayant pas satisfait à l’ultimatum des sections parisiennes de déchoir Louis XVI, les sections appuyées par les fédérés se mirent en branle dans la nuit du 9 au 10 août. Dans la nuit, la commune de Paris fut remplacée par une commune insurrectionnelle, dont fit partie Robespierre et qui fut le véritable pouvoir révolutionnaire pendant deux mois, d’où la haine des Girondins à son endroit. Au matin, le palais des Tuileries fut pris d’assaut, ses défenseurs (gardes suisses et royalistes) n’ayant pas voulu mettre bas les armes et ayant tirés sur la foule qui avançait pour fraterniser. Sous la pression, l’Assemblée suspendit le roi qui s’était réfugié auprès d’elle et se désavoua en convoquant pour le mois de septembre une convention nationale.
A noter que, contrairement aux souhaits exprimés par Robespierre, le 1er août, d’« une convention nationale, dont les membres seront élus directement par les assemblées primaires, et ne pourront être choisis parmi ceux de l’assemblée constituante ni de la première législature », les Girondins se gardèrent bien d’adopter cette disposition. Alors que Robespierre se fermait une nouvelle fois la porte de l’Assemblée, démontrant qu’il avait bien fait adopter le décret sur l’inéligibilité des constituants par principe, les Girondins démontraient, eux, leur soif de pouvoir. Les ayant combattus en tant que simple citoyen, ayant mesuré l’étendue de leur ineptie, et s’étant en outre persuadé de l’importance de son propre rôle, Robespierre brigua de nouveau la législature. Le 5 septembre 1792, il fut le premier député élu de Paris.
La Convention girondine
Le 21 septembre, au lendemain de la victoire de Valmy, la Convention nationale ouvrait sa session. La monarchie fut aussitôt abolie en France. Le lendemain, en adoptant la proposition de Billaud-Varenne, député de Paris, de dater tous les documents de l’an I de la République, celle-ci fut indirectement proclamée. Mais l’unanimité des premiers jours n’était qu’illusoire. Les députés de Paris savaient que les Girondins avaient fait tous leurs efforts pour sauver la monarchie et accabler les révolutionnaires, et ils avaient de plus contre eux la plupart des députés de province que la propagande de ces derniers, maîtres de tous les rouages de l’Etat, avaient trompés sur leur compte. Le temps et l’expérience allaient finir par ouvrir les yeux de la majorité sur l’inconséquence, la petitesse, l’irascibilité et, au final, la dangerosité des Girondins.
Dès le 25 septembre, les Girondins ouvrirent les hostilités contre les députés de Paris, notamment Robespierre, Danton et Marat, et suscitèrent la défiance envers Paris en proposant pour la Convention une garde composée d’hommes tirés de tous les départements afin « que Paris soit réduit à un quatre-vingt-troisième d’influence, comme chacun des autres départements ». La Convention rejeta ce projet, mais les Girondins appelèrent quand même officieusement des provinciaux à venir à Paris, lesquels, une fois sur place et mieux informés sur leur compte, se retournèrent contre eux. Le 29 octobre, Louvet attaqua vivement Robespierre en exposant un astucieux roman, synthèse de toutes les calomnies girondines, préparé depuis longtemps dans le salon de Mme Roland, égérie des Girondins. En conclusion, il demandait le bannissement de Robespierre et la mise en accusation de Marat. Le 5 novembre, du haut de la tribune de la Convention, Robespierre lui répondit en défendant non seulement sa personne, mais surtout Paris, la Commune et la révolution du 10 août, et en appelant finalement à la concorde.
« J’ai vu à cette barre tels citoyens qui ne sont pas des Clodius, mais qui, quelque temps avant la révolution du 10 août, avaient eu la prudence de se réfugier à Rouen, dénoncer emphatiquement la conduite du conseil de la commune de Paris. Des arrestations illégales ? Est-ce donc le code criminel à la main qu’il faut apprécier les précautions salutaires qu’exige le salut public, dans les temps de crise amenés par l’impuissance même des lois ? Que ne nous reprochez-vous aussi d’avoir brisé illégalement les plumes mercenaires, dont le métier était de propager l’imposture et de blasphémer contre la liberté ? Que n’instituez-vous une commission pour recueillir les plaintes des écrivains aristocratiques et royalistes ? Que ne nous reprochez-vous d’avoir consigné tous les conspirateurs aux portes de cette grande cité ? Que ne nous reprochez-vous d’avoir désarmé les citoyens suspects ? d’avoir écarté de nos assemblées, où nous délibérions sur le salut public, les ennemis reconnus de la Révolution ? Que ne faites-vous le procès à la fois, et à la municipalité, et à l’assemblée électorale, et aux sections de Paris, et aux assemblées primaires même des cantons, et à tous ceux qui nous ont imités ? Car toutes ces choses-là étaient illégales, aussi illégales que la révolution, que la chute du trône et de la Bastille, aussi illégale que la liberté elle-même ? Mais que dis-je ? Ce que je présentais comme une hypothèse absurde n’est qu’une réalité très certaine. On nous a accusés, en effet, de tout cela, et de bien d’autres choses encore. [...] Citoyens, vouliez-vous une révolution sans révolution ? »
Ce discours fit une telle sensation que la Convention en vota l’impression à la quasi unanimité et ferma la bouche à Barbaroux et à Louvet qui voulurent répondre.
Les Girondins devaient subir une autre défaite dans l’affaire du roi que leurs personnalités avaient jusque-là permis de différer. Ils s’essayèrent jusqu’au bout à de nouvelles manœuvres dilatoires qui les discréditèrent un peu plus et gonflèrent encore les rangs des Montagnards (nom donné aux députés les plus radicaux dont Robespierre était un des principaux leaders). Après avoir argué de l’inviolabilité du roi, demandé le jugement par le peuple, puis l’appel au peuple du jugement de la Convention, ils votèrent la mort mais réclamèrent le sursis de l’exécution. La Convention finit par voter la mort sans sursis ni appel. Louis XVI fut exécuté le 21 janvier 1793. Dans cette affaire, Robespierre s’était déclaré pour l’exécution du roi sans jugement, considérant qu’il avait été jugé par l’insurrection du 10 août, que la Convention ne pouvait ni déjuger le peuple ni supposer le roi innocent.
« Proposer de faire le procès à Louis XVI, de quelque manière que ce puisse être, c’est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel ; c’est une idée contre-révolutionnaire, car c’est mettre la révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut être encore l’objet d’un procès, il peut être absous ; il peut être innocent : que dis-je ? il est présumé l’être jusqu’à ce qu’il soit jugé : mais si Louis est absous, si Louis peut être présumé innocent, que devient la révolution ? » (3 décembre 1792)
Pendant ce temps, le peuple était inquiet pour sa subsistance et réclamait la taxation des denrées. Mais tout ce dont étaient capables les Girondins était de lui répondre : « La seule chose peut-être que l’Assemblée puisse se permettre sur les subsistances, c’est de proclamer qu’elle ne doit rien faire » (Roland, 19 novembre). C’était là le paradoxe insurmontable des Girondins qui voulaient faire la guerre à l’Europe tout en méprisant les guerriers de la France. La victoire dans ces conditions était impossible et c’est pour l’avoir compris que les députés tout aussi bourgeois qu’eux mais plus réalistes se tournèrent de plus en plus vers la Montagne.
Comme les Girondins ne désarmaient pas contre les Montagnards (arrestation de Marat, le 13 avril) et Paris, comme ils avaient le don de soutenir les traîtres (La Fayette, Dumouriez) et d’exaspérer le peuple, comme ils étaient à l’évidence aussi incapables qu’arrogants, une nouvelle journée devint nécessaire. Le 3 avril, Robespierre appela les sections à s’armer. Le 2 juin 1793, la Commune de Paris fit cerner la Convention par la garde nationale (composée de civils) jusqu’à ce qu’elle décrète d’arrestation les principaux Girondins, soit 22, sans compter les ministres Clavière et Lebrun. Il ne s’agissait alors que de les mettre hors d’état de nuire. Ils devaient être simplement gardés à domicile. Mais la moitié d’entre eux profita de cette clémence pour s’enfuir et soulever les départements. (C’est de Caen, où nombre d’entre eux s’étaient retrouvés, qu’arriva Charlotte Corday pour assassiner Marat, le 13 juillet.) La guerre civile qu’ils préparaient depuis deux ans devenait réalité. Elle avait même déjà commencé en Vendée où, début mars, la levée de 300.000 hommes avait été l’étincelle. Elle venait aussi d’éclater à Lyon (29 mai).
La Convention montagnarde / L'an II
Aussitôt maîtres de la Convention, les Montagnards hâtèrent la rédaction d’une constitution. Les maîtres mots : souveraineté du peuple, égalité des citoyens, solidarité nationale. « Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. (art. 27 de la Déclaration) » « Le peuple français ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. (art. 121 de la constitution) » Voilà pour le ton ! Le résultat fut la constitution la plus démocratique, la plus patriotique, la plus libre, la plus humaniste, la plus virile que la France ait connue et que, malheureusement, les circonstances ne permirent jamais d’appliquer. Les députés devaient être élus au suffrage universel et les lois, soumises à l’approbation du corps électoral (articles 56 à 60). La constitution elle-même devait être ratifiée par le peuple qui n’était pas souverain seulement en théorie, mais en pratique.
En préambule de cette constitution figurait une nouvelle déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui était grosso modo celle que Robespierre avait proposée aux Jacobins le 21 avril et que ces derniers avaient aussitôt adoptée à l’unanimité. Nombre d’articles étaient repris tels quels. Ainsi les articles 28 et 29 qui devinrent les articles 34 et 35 :
« Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. — Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
Beaucoup n’avaient subit qu’une légère modification. Ainsi l’article 10 qui devint l’article 21 :
« Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux [La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, dans le texte original], soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. »
Mais la déclaration de Robespierre était plus sociale, plus démocratique et plus patriotique (internationaliste) encore que sa copie.
« Dans tout état libre, la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre l’autorité de ceux qui gouvernent. Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible est vicieuse. (art. 19) Le peuple a le droit de connaître toutes les opérations de ses mandataires ; ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion, et subir son jugement avec respect. (art. 34) Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s’entraider selon leur pouvoir comme les citoyens du même état. (art. 35) Celui qui opprime une seule nation se déclare l’ennemi de toutes. (art. 36) »
Chose plus significative encore, les bourgeois de la Convention n’avaient pas retenu ses articles sur la propriété qu’il définissait comme suit :
« La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer à son gré de la portion de bien qui lui est garantie par la loi. (art. 6) Le droit de propriété est borné comme tous les autres par l’obligation de respecter les droits d’autrui. (art. 7) Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables. (art. 8) Tout trafic qui viole ce principe est essentiellement illicite et immoral. (art. 9) »
La déclaration officielle disait simplement : « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. (art. 16) ». La propriété n’était donc pas reconnue comme un bienfait social mais comme une conquête individuelle. Elle n’avait plus pour borne les droits d’autrui. Les propriétaires pouvaient jouir sans entrave aux dépens de leurs concitoyens.
Il est à noter que c’est Robespierre qui, le 15 avril, avait décidé la Convention à faire précéder la constitution d’une déclaration au lieu de se précipiter, comme le voulait le Girondin Buzot, sur l’organisation du gouvernement. Le discours qu’il fit alors est caractéristique de sa tournure d’esprit, c’est-à-dire du bon sens qui lui ralliait les opinions :
« J’avoue que je ne conçois pas bien cette proposition ; qu’est-ce que l’organisation du gouvernement d’un peuple ? Ce n’est autre chose, si je ne me trompe, que les loix fondamentales qui forment sa constitution, qui constituent son gouvernement. Quelle est la base de la constitution et du gouvernement ? Ce sont, sans contredit, les droits des hommes. Quel est le but du gouvernement ? Quel est le but de la constitution ? C’est le bonheur des hommes, et par conséquent la conservation de leurs droits, de leur sûreté, de leur liberté, de leur propriété ; il faut donc avant d’instituer un gouvernement, bien déterminer et la nature et l’étendue des droits, dont la conservation est l’objet du gouvernement ; proposer de commencer par le gouvernement, c’est ne rien proposer, ou proposer la conséquence avant le principe. [...] Remarquez bien, citoyens, que le seul moyen de faire bien et même de faire vite cette constitution, c’est d’en établir d’abord les bases ; car, s’il n’est pas de principes posés, comment voulez-vous qu’on s’accorde sur les conséquences ? alors les discussions ne roulent que sur des détails et comme chacun part de bases et de principes opposés, qu’il modifie et qu’il appelle à son gré, parce qu’elles ne sont pas discutées dans l’opinion générale, il en résulte que la quantité des opinions est infinie, que les débats deviennent aussi interminables que tumultueux. Il faut donc pour procéder définitivement à une constitution, que chacun marche sur le même point : reconnaître les principes. »
Au sujet de la constitution, il est nécessaire de signaler le discours que Robespierre prononça à ce sujet le 10 mai 1793. Dans la mesure où Robespierre était l’âme des Jacobins, ses conceptions en la matière ne sont ni plus ni moins que le jacobinisme à l’état pur. Il est impossible de restituer ici l’ensemble de ses vues, mais il est utile de citer un passage qui tord le cou à la légende selon laquelle le jacobinisme serait par nature synonyme de centralisation :
« Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner : laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui ; laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient pas essentiellement à l’administration générale de la République ; en un mot, rendez à la liberté individuelle tout ce qui n’appartient pas naturellement à l’autorité publique, et vous aurez laissé d’autant moins de prise à l’ambition et à l’arbitraire. »
La centralisation que finit par connaître la Révolution doit moins à l’idéologie qu’aux circonstances et au processus engagé dans ce sens par la monarchie durant les siècles précédents.
Avec l’élimination des Girondins, le premier chapitre de la Convention était tourné. S’ouvrait la grande période révolutionnaire dite de l’an II, celles des défis et des titans, celle de la République assiégée et de la guerre civile, particulièrement terrible en Vendée, celle de la levée en masse, du maximum, de la déchristianisation, de la lutte des factions, de la Terreur, de la Convention montagnarde, de la prééminence du Comité de salut public, des ambitions sociales (suppression sans indemnité des droits féodaux, institution de l’école gratuite et obligatoire, adoption d’un embryon de sécurité sociale, abolition de l’esclavage), période qui s’achève le 10 thermidor, avec la mort de Robespierre et le retour en force de la bourgeoisie.
C’est cette période, durant laquelle Robespierre fut en première ligne, qui permit, en altérant les faits, d’étayer sa légende noire. Sept considérations à garder à l’esprit permettent cependant de révéler l’inanité de certaines controverses et de démasquer les impostures les plus manifestes et la mauvaise foi de ses détracteurs.
1) En l’an II, la République est déjà assiégée par toute l’Europe, tandis que la France est déchirée à l’intérieur par la guerre civile. Cette situation extrême eut fatalement des conséquences terribles et on peut même dire qu’elle conditionna toute la politique d’alors. Comment négliger un fait pareil ? Comment, en outre, oublier que Robespierre s’opposa de toutes ses forces à la déclaration de guerre et que les origines de la guerre civile remontaient aux politiques aristo-bourgeoise de la Constituante et bourgeoise, guerrière et anti-parisienne de la Gironde, politiques auxquelles Robespierre s’était également opposé ? En admettant qu’il fut un piètre pompier, du moins n’était-il pas le pyromane. Il est donc quelque peu hypocrite de lui jeter la pierre sans jamais songer à lapider les vrais responsables des problèmes dans lesquels les Montagnards durent se démener.
2) Les républicains qui venaient de renverser la monarchie avait en horreur le pouvoir personnel. La fonction présidentielle ne fut instituée que par De Gaulle, malgré les avanies de la gauche. A l’époque de la Révolution, une pareille fonction était inconcevable. Robespierre qui fut bien l’âme du Grand Comité au fort de la tempête n’eut donc jamais le pouvoir absolu et discrétionnaire que la légende lui prête. Les décisions importantes du Comité étaient prises collectivement. Ses collègues n’étaient d’ailleurs pas des marionnettes. C’étaient tous des hommes à poigne. Ils avaient autant de pouvoir que lui. Ils étaient libres d’en user. Ils le suivirent tant qu’ils furent d’accord avec lui ; ils l’écartèrent et finirent par le tuer quand ils se divisèrent. Robespierre n’avait la haute main ni sur l’armée, ni sur la police, ni sur le Trésor, pas même sur le Comité. S’il fut un dictateur, quel genre de dictateur était-il donc ? Le Comité de salut public lui-même n’avaient pas tous les pouvoirs pour la simple raison qu’il n’était pas le seul Comité et qu’il était, comme tous les comités, responsable devant la Convention qui pouvait s’opposer à ses décisions voire le casser, même si, pendant un an, elle reconduisit ses membres tous les mois.
3) Il n’y avait pas de partis politiques (au sens moderne du terme) à cette époque. Chacun se faisait gloire d’être libre de ses opinions (1). Les Jacobins et les clubs en général étaient avant tout des lieux de discussion. Ils réunissaient des individus opposés à certaines choses mais sans doctrine quant au reste, d’où leurs divisions internes. Ils étaient organisés pour fonctionner mais leurs membres étaient égaux, il n’y avait pas de hiérarchie entre eux. Tous pouvaient s’exprimer, et de la foule des orateurs émergeaient des leaders d’opinion qui n’étaient suivis et soutenus que dans la mesure où ils étaient convaincants. Il en était de même à la Convention et dans les Comités. Des tendances, des groupes se distinguaient mais les députés n’en étaient pas prisonniers et votaient, sur chaque sujet, selon leurs convictions. Nul ne pouvait être certain d’être toujours approuvé. Chaque débat était un combat pour rallier la majorité. Robespierre qui fut souvent suivi par la Convention, qui parvint même, en quelques occasions, à la retourner complètement par la seule force de ses arguments, ne fut pas toujours écouté, pas même par les Montagnards. Sa position n’était donc en rien celle d’un dictateur qui a le pouvoir et l’exerce sans consulter personne. Sa politique comme celle du Comité était moins l’expression de ses désirs qu’une adaptation aux besoins et aux pressions du moment.
4) La Révolution se déroula au XVIIIe siècle, à une époque où les moyens de circulation et de communication étaient encore rudimentaires. L’action sur le terrain, loin de Paris, dépendait essentiellement des hommes sur place. Le pouvoir ne pouvait donc agir qu’en dépêchant des hommes (agents divers, généraux, représentants en mission) qui, une fois livrés à eux-mêmes, étaient libres de faire et firent souvent ce qu’ils voulaient. En comparant leurs actes avec leurs ordres formels (ou l’esprit de ces ordres), il apparaît que les abus et les excès ne furent jamais ordonnés par la Convention ou le Comité, encore moins par Robespierre. Ils sont davantage imputables à des individus qu’à la Révolution. Il est vrai que cette limite technologique aurait moins pesé si le pouvoir avait été plus stable, plus structuré, plus strict et plus efficace, comme sous un Louis XIV ou un Napoléon. Mais c’est encore la preuve que le Comité de salut public n’avait pas un tel pouvoir, et que Robespierre en particulier, même en supposant qu’il ait été le maître du Comité, n’était pas plus un dictateur qu’il n’avait les moyens, ni la volonté d’ailleurs, d’en être un.
5) Les nations sont toujours en conflit, même en temps de paix apparente. La guerre secrète ne cesse jamais et est bien sûr plus intense en temps de guerre. Un aspect peu étudié de la Révolution, et surtout peu signalé, est l’influence des services secrets étrangers sur les événements durant cette période. Personne ne peut croire qu’ils cessèrent toute activité. Il est au contraire dans la logique des choses qu’ils en déployèrent une extraordinaire pour faire échec aux révolutionnaires et à la Révolution. Leurs efforts consistèrent fatalement à diviser, affaiblir, appauvrir, ruiner, désarmer, calomnier, discréditer, déshonorer, désinformer, désorganiser, troubler, apitoyer, assassiner, soudoyer, exciter, exagérer, minorer, décourager, etc.. Le propre des agents secrets actifs est soit d’agir dans l’ombre soit de s’agiter au grand jour. On ne peut que deviner leur présence en constatant les effets de leur action ou, au mieux, les prendre pour des traîtres, des tarés, des crapules ou des idiots ordinaires. En l’occurrence, toutes les difficultés de la Révolution, tous les crimes et les excès commis en son nom ne furent pas l’œuvre des services secrets étrangers ou de gens manipulés ou financés par eux, mais c’est cependant à bon droit que les révolutionnaires, et Robespierre en particulier, accusèrent l’Etranger ou du moins soupçonnèrent-ils sa main derrière chaque action ou opinion intrinsèquement contre-révolutionnaire, car, à défaut d’être responsable de tous, tous faisaient son jeu. Le « complot de l’Etranger » qu’ils invoquèrent souvent n’avait peut-être pas l’unité qu’ils imaginaient ; les manœuvres étrangères n’en étaient pas moins réelles et redoutables. Si l’accusation de connivence avec l’Etranger fut rarement prouvée (chose toujours difficile à faire), elle fut souvent justifiée d’un point de vue dialectique et importait d’ailleurs moins que les faits reprochés. Bref, s’il est impossible de mesurer l’impact (concret et psychologique) de l’activité des services étrangers sur la Révolution, elle existât fatalement et fût assurément négative pour l’image de la Révolution et des révolutionnaires auxquels il est donc injuste d’attribuer certains faits et de reprocher certaines erreurs.
6) Robespierre était un homme sensible, réfléchi, honnête et ferme, mais modéré. Le peindre comme un être sanguinaire rend incompréhensible ses positions et oblige à expliquer les faits de manière invraisemblable voire à les dénaturer pour corroborer la légende. La meilleure preuve n’est-elle pas que le 9 thermidor fut l’œuvre des hommes de sang et de rapines ? Tous les hommes violents et corrompus le haïssaient. Tous les opprimés se tournaient vers lui. Il avait dit, aux Girondins, le 5 novembre 1792 : « Vous saurez un jour quel prix vous devez attacher à la modération de l’ennemi que vous vouliez perdre. » Or c’est bien lui qui sauva d’une mort certaine les « 73 » députés qui protestèrent contre l’expulsion des Girondins. Des dizaines de faits attestent sa modération dans tous les domaines. Mais Robespierre n’était pas seul. Il avait des collègues, des ennemis ; il y avait la Convention, des factions ; il y avait aussi le peuple. S’il fut un personnage central de la Révolution, tout ce qui se fit en l’an II, en particulier les excès (à ne pas confondre avec les rigueurs nécessaires), ne peut honnêtement lui être imputé.
7) Tous les protagonistes de la période révolutionnaire, incarnant chacun des systèmes différents voire opposés, dans tous les cas inconciliables, se livraient une guère à mort. Les chefs en particulier ne devaient attendre aucune pitié de la part de leurs adversaires. Il y eut quelques violences avant 1792 (du peuple sur les nobles ou des bourgeois sur le peuple). Mais c’est une fois de plus la guerre voulue par la Cour et les Girondins qui, dès 1792, bien avant 1793, déchaîna les passions et plongea la Révolution dans un cycle infernal. Les victimes ne méritent pas plus de larmes que leurs vainqueurs ne méritent d’invectives. C’était la guerre. Vaincre ou mourir était la règle du jeu. Tous la connaissaient ; tous l’appliquèrent bon gré malgré quand ils eurent la force pour eux. Ce mot de Hérault de Séchelles qui ne passait pas précisément pour un sauvage et qui paya même de sa tête le fait d’avoir été soupçonné de livrer à l’ennemi les secrets du Comité illustre bien cet état d’esprit : « Il faut sans rémission évacuer, renfermer tout individu suspect. La liberté ne compose pas. Nous pourrons être humains quand nous serons assurés d’être vainqueurs. » (Lettre à Carrier, représentant dans la Seine-Inférieure, 29 septembre 1793)
Deux mois après l’expulsion des Girondins de la Convention, Robespierre fut élu membre du Comité de salut public (27 juillet). Etant donné son passé et son renom, il devint aussitôt l’incarnation du Comité aux yeux du grand public et des étrangers. Il lui apporta son énergie, sa détermination, son prestige. Son objectif : à l’extérieur, la paix dans la victoire ; à l’intérieur, paix civile et justice sociale. Mais, pour avoir la paix, il fallait frapper juste, fort et vite, non se coucher (comme Danton) ; il fallait stabiliser le pouvoir pour qu’il puisse agir avec la vigueur requise, donc asseoir l’autorité du Comité, défendre son existence, son action et ses membres ; il fallait éviter de multiplier les ennemis de la République, la faire aimer du peuple, la mettre dans tous les domaines en état de vaincre, étouffer les voix divergentes et écraser les ennemis irréductibles.
La victoire n’était pas seulement au bout du fusil ; elle était un tout. Robespierre s’intéressait donc à tout, comme le montrent les notes dans ses carnets, quoiqu’il s’occupa essentiellement de politique générale. Nous ne pouvons ici rapporter ni même évoquer toutes les affaires dans lesquelles il intervînt. Nous ne retiendrons que les six plus importants sujets, objets de polémiques : la déchristianisation, la Terreur, l’idéal de la Révolution, les factions, l’Etre suprême et la loi du 22 prairial.
La déchristianisation.
L’assassinat de Marat avait fait de lui un martyr et donné lieu à des processions populaires en sa mémoire, mouvement que l’on appela culte des martyrs. Les révolutionnaires avaient leur trinité : Le Pelletier de Saint-Fargeau (ami de Robespierre, assassiné à Paris le 20 janvier), Chalier (maire de Lyon, exécuté) et Marat. Ce « culte » païen, combiné au dépouillement des églises à des fins militaires ou financières, ouvrit la porte au culte « religieux » de la Raison. Initié, le 26 septembre, dans la Nièvre par Fouché qui était athée, ce nouveau culte se répandit commune une traînée de poudre, d’abord à Paris, grâce à Chaumette, procureur syndic de la Commune, puis dans tout le pays par le biais des représentants en mission. Mais, contrairement à Fouché et Chaumette, ceux que l’on appelle les déchristianisateurs n’étaient pas athées, pas même les plus virulents. Généralement, rousseauistes, ils étaient déistes pour la plupart. Ils croyaient en Dieu, sous quelque nom que ce soit, mais rejetaient les dogmes du catholicisme et l’emprise de l’Eglise. L’implication du clergé dans la contre-révolution décupla leur hostilité envers lui et ils résolurent de le balayer. Pour la plupart des adeptes, le culte de la Raison n’était donc que leur affirmation de la croyance en Dieu, en un Etre suprême, laquelle se passait de prêtres.
Ce mouvement eut un énorme succès auprès des Sans-culottes (ouvriers, petits patrons) et des bourgeois, notamment dans les villes. Les prêtres, les évêques abdiquaient en masse, qui volontairement, qui sous la contrainte, qui dans un but contre-révolutionnaires. Les scènes d’abdication se succédaient dans les clubs et à la Convention. Les églises étaient fermées d’autorité. C’est dans cette ambiance que, le 5 octobre, la Convention adopta le principe du calendrier républicain qui, remplaçant les semaines par des décades, supprimait au passage les dimanches. Robespierre était hostile à l’adoption de ce calendrier comme il était viscéralement hostile au culte de la Raison. Il se trompait quand il pensait que les adeptes de ce culte étaient athées, l’athéisme étant pour lui synonyme d’immoralité bourgeoise et aristocratique, mais il avait raison quand il craignait que, mal interprété comme il l’avait fait lui-même, ce culte ne soit du pain béni pour la propagande contre-révolutionnaire des autres pays européens, tous chrétiens, et ne dresse également les Français attachés au culte catholique contre la Révolution. En somme, il considérait ce mouvement comme contre-révolutionnaire et ses promoteurs comme des agents de l’Etranger.
Ses craintes, partagées par tous ses collègues du Comité, n’étaient que trop justifiées. Des centaines de mouvements quasi insurrectionnels agitèrent la France (cf. les lettres des représentants en mission). Le 21 novembre, alors que le flot semblait irrésistible, il jeta tout son prestige dans la balance. Ce fut un coup de tonnerre. Sa rhétorique imparable atterra ses détracteurs. Le discours qu’il prononça aux Jacobins à cette occasion, sous les applaudissements, contient tout ce qu’il dit par la suite sur le même sujet, mais surtout tout ce qui fonde la laïcité aujourd’hui, d’où l’importance de le citer longuement.
« Je ne vois plus qu’un seul moyen de réveiller parmi nous le fanatisme, c’est d’affecter de croire à sa puissance. Le fanatisme est un animal féroce et capricieux ; il fuyait devant la raison : poursuivez-le avec de grands cris, il retournera sur ses pas. […] Que des citoyens, animés par un zèle pur, viennent déposer sur l’autel de la patrie, les monumens inutiles et pompeux de la superstition pour les faire servir à son triomphe, la patrie et la raison sourient à ces offrandes. Que d’autres renoncent à telles ou telles cérémonies et adoptent sur toutes ces choses l’opinion qui leur paraît la plus conforme à la vérité, la raison et la philosophie peuvent applaudir à leur conduite. Mais de quel droit l’aristocratie et l’hypocrisie viendraient-elles ici mêler leur influence à celle du civisme et de la vertu ? De quel droit des hommes inconnus jusqu’ici dans la carrière de la Révolution, viendraient-ils chercher, au milieu de tous ces événemens, les moyens d’usurper une fausse popularité, d’entraîner les patriotes même à de fausses mesures, et de jeter parmi nous le trouble et la discorde ? De quel droit viendraient-ils troubler la liberté des cultes, au nom de la liberté, et attaquer le fanatisme par un fanatisme nouveau ? De quel droit feraient-ils dégénérer les hommages solennels rendus à la vérité pure, en des farces éternelles et ridicules ? Pourquoi permettrait-on de se jouer ainsi de la dignité du peuple, et d’attacher les grelots de la folie au sceptre même de la philosophie.
« On a supposé qu’en accueillant des offrandes civiques, la Convention avait proscrit le culte catholique. Non, la Convention n’a point fait cette démarche téméraire. La Convention ne la fera jamais. Son intention est de maintenir la liberté des cultes qu’elle a proclamée et de réprimer en même-temps tous ceux qui en abuseraient pour troubler l’ordre public ; elle ne permettra pas qu’on persécute les ministres paisibles du culte, et elle les punira avec sévérité toutes les fois qu’ils oseront se prévaloir de leurs fonctions pour tromper les citoyens et pour armer les préjugés ou le royalisme contre la République. On a dénoncé des prêtres pour avoir dit la messe ! ils la diront plus longtemps si on les empêche de la dire. Celui qui veut les empêcher est plus fanatique que celui qui dit la messe.
« Il est des hommes qui veulent aller plus loin ; qui, sous le prétexte de détruire la superstition, veulent faire une sorte de religion de l’athéisme lui-même. Tout philosophe, tout individu, peut adopter là-dessus l’opinion qui lui plaira. Quiconque voudrait lui en faire un crime est un insensé ; mais l’homme public, mais le législateur, serait cent fois plus insensé, qui adopterait un pareil système. La Convention nationale l’abhorre. La Convention n’est point un faiseur de livres, un auteur de systêmes métaphysiques ; c’est un corps politique et populaire, chargé de faire respecter, non seulement les droits, mais le caractère du peuple français. Ce n’est point en vain qu’elle a proclamé la Déclaration des droits de l’homme en présence de l’Être suprême.
« On dira peut-être que je suis un esprit étroit, un homme à préjugés ; que sais-je, un fanatique. J’ai déjà dit que je ne parlais ni comme un individu, ni comme un philosophe systématique, mais comme un représentant du peuple. L’athéisme est aristocratique ; l’idée d’un grand être qui veille sur l’innocence opprimée, et qui punit le crime triomphant, est toute populaire. Le peuple, les malheureux m’applaudissent ; si je trouvais des censeurs, ce serait parmi les riches et parmi les coupables. J’ai été, dès le collège, un assez mauvais catholique ; je n’ai jamais été ni un ami froid, ni un défenseur infidèle de l’humanité. Je n’en suis que plus attaché aux idées morales et politiques que je viens de vous exposer. Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer.
« Je parle dans une tribune où l’impudent Guadet osa me faire une crime d’avoir prononcé le mot de Providence [26 mars 1792]. Et dans quel tems ? Lorsque le cœur ulcéré de tous les crimes dont nous étions les témoins et les victimes ; lorsque, versant des larmes amères et impuissantes sur la misère du peuple éternellement trahi, éternellement opprimé, je cherchais à m’élever au-dessus de la tourbe impure des conspirateurs dont j’étais environné en invoquant contre eux la vengeance céleste, à défaut de la foudre populaire. Ce sentiment est gravé dans tous les cœurs sensibles et purs ; il anima dans tous les temps les plus magnanimes défenseurs de la liberté. Aussi long-temps qu’il existera des tyrans, il sera une consolation douce au cœur des opprimés ; et si jamais la tyrannie pouvait renaître parmi nous, quelle est l’âme énergique et vertueuse qui n’appellerait point en secret, de son triomphe sacrilège, à cette éternelle justice qui semble avoir écrit dans tous les cœurs l’arrêt de mort de tous les tyrans. Il me semble du moins que le dernier martyr de la liberté exhalerait son âme avec un sentiment plus doux en se reposant sur cette idée consolatrice. Ce sentiment est celui de l’Europe et de l’univers ; c’est celui du peuple français. Ce peuple n’est attaché ni aux prêtres, ni à la superstition, ni aux cérémonies religieuses ; il ne l’est qu’au culte en lui-même, c’est-à-dire à l’idée d’une puissance incompréhensible, l’effroi du crime et le soutien de la vertu, à qui il se plaît à rendre des hommages qui sont autant d’anathèmes contre l’injustice et contre le crime triomphant. […]
« Ne voyez-vous pas le piège que nous tendent les ennemis de la République et les lâches émissaires des tyrans étrangers ? En présentant comme l’opinion générale, les travers de quelques individus et leur propre extravagance, ils voudraient nous rendre odieux à tous les peuples pour affermir les trônes chancelans des scélérats qui les oppriment. Quel est le tems qu’ils ont choisi pour ces machinations ? Celui où leurs armées combinées ont été vaincues ou repoussées par le génie républicain, celui où ils veulent étouffer les murmures des peuples fatigués ou indignés de leur tyrannie ; celui où ils pressent les nations neutres et alliées de la France de se déclarer contre nous. Les lâches ne veulent que réaliser toutes les calomnies grossières dont l’Europe entière reconnaissait l’impudence, et repousser de vous par les préjugés ou par les opinions religieuses, ceux que la morale et l’intérêt commun attiraient vers la cause sublime et sainte que nous défendons. Je le répète ; nous n’avons plus d’autre fanatisme à craindre que celui des hommes immoraux soudoyés par les cours étrangères pour éveiller le fanatisme et pour donner à notre Révolution le vernis de l’immoralité qui est le caractère de nos lâches et féroces ennemis. »
Le 5 décembre, au nom du Comité de salut public, Robespierre proposa à la Convention, qui l’adopta, une réponse au manifeste des rois ligués contre la République. En préambule, il revenait sur la machiavélisme de la déchristianisation et introduisait un nouveau thème, celui des factions, rivales et contraires en apparence, mais tendant de fait au même but : la ruine de la République.
« Toujours attentifs à renouer les fils de leurs trames funestes, à mesures qu’ils sont rompus par la main du patriotisme ; toujours habiles à tourner les armes de la liberté contre la liberté même, les émissaires des ennemis de la France travaillent aujourd’hui à renverser la République par républicanisme, et à rallumer la guerre civile par philosophie. Avec ce grand système de subversion et d’hypocrisie, coïncide merveilleusement un plan perfide de diffamation contre la Convention nationale et contre la nation elle-même. Tandis que la perfidie ou l’imprudence, tantôt énervait l’énergie des mesures révolutionnaires commandée par le salut de la patrie, tantôt les laissait sans exécution, tantôt les exagérait avec malice, ou les appliquait à contre-sens ; tandis qu’au milieu de ces embarras, les agens des puissances étrangères mettant en œuvre tous les mobiles, détournaient notre attention des véritables dangers et des besoins pressans de la République, pour la tourner toute entière vers les idées religieuses ; tandis qu’à une révolution politique ils cherchaient à substituer une révolution nouvelle, pour donner le change à la raison publique et à l’énergie du patriotisme ; tandis que les mêmes hommes attaquaient ouvertement tous les cultes, et encourageaient secrètement le fanatisme ; tandis qu’au même instant ils faisaient retentir la France entière de leurs déclamations insensées, et osaient abuser du nom de la Convention nationale pour justifier les extravagances réfléchies de l’aristocratie déguisée sous le manteau de la folie : les ennemis de la France marchandaient de nouveaux ports, vos généraux, vos armées ; rassuraient le fédéralisme épouvanté, intriguaient chez tous les peuples étrangers pour multiplier vos ennemis. Ils armaient contre vous les prêtres de toutes les nations ; ils opposaient l’empire des opinions religieuses à l’ascendant naturel de vos principes moraux et politiques ; et les manifestes de tous les gouvernemens nous dénonçaient à l’Univers comme un peuple de fous et d’athées. C’est à la Convention nationale d’intervenir entre le fanatisme qu’on réveille et le patriotisme qu’on veut égarer, et de rallier tous les citoyens aux principes de la liberté, de la raison et de la justice. Les législateurs qui aiment la patrie, et qui ont le courage de la sauver, ne doivent pas ressembler à des roseaux sans cesse agités par le souffle des factions étrangères. »
Le 8 décembre (18 frimaire), la Convention confirmait son décret sur la liberté des cultes. La déchristianisation violente était terminée, du moins à Paris.
La Terreur.
Eté 1793. La République faisait front de tous côtés. Au nord, les Anglais. Au nord-est, les Prussiens et les Autrichiens. A l’est, les Piémontais. Au sud-ouest, les Espagnols. A l’intérieur, les Vendéens ravageaient l’Ouest, les Toulonnais accueillaient les anglo-espagnols, les Marseillais menaçaient de faire de même, les Lyonnais défiaient la République. La trahison était partout à craindre. Partout des réticences, l’égoïsme et la corruption à comprimer. A Paris, les prix avaient augmenté, le peuple avait faim. Et avec cela, plus d’hommes que jamais sous les drapeaux (décret de levée en masse, le 23 août), autant de bras en moins dans les champs et les ateliers pour répondre aux besoins ordinaires et extraordinaires de la France.
Au matin du 5 septembre, la Convention adopta la réorganisation du tribunal révolutionnaire selon le projet de Merlin (de Douai), membre du Comité de législation. Son activité allait croître. Le même jour, à midi, les ouvriers parisiens qui, la veille, s’étaient rassemblés à la Commune, envahirent la Convention, brandissant des pancartes : « Guerre aux tyrans, guerre aux aristocrates, guerre aux accapareurs ». Robespierre présidait (un nouveau président était élu toutes les deux semaines) et laissa rapidement sa place à Thuriot. A la demande de Danton, une indemnité est votée pour que les sans-culottes puissent assister à la séance de leur section. La demande de Basire, appuyée par Léonard Bourdon et Billaud-Varenne (élu le lendemain au Comité de salut public), de définir le terme gens suspects et d’épurer les comités révolutionnaires est votée. Sur un rapport de Barère, fait au nom du Comité de salut public, la formation d’une armée révolutionnaire fut décrétée. Jeanbon Saint-André, lui aussi membre du Comité de salut public, réclama et obtint la possibilité d’effectuer des visites domiciliaires la nuit. Sans qu’elle ait été décrétée, la Terreur était désormais à l’ordre du jour. Robespierre n’y était pour rien. Tout au plus était-il d’accord avec les mesures adoptées (le 25 août, il avait parlé aux Jacobins de la nécessité de réorganiser le Tribunal révolutionnaire).
Les propositions décrétées furent convertis en décret les jours suivants. Le 9 septembre, la Convention votait l’organisation de l’armée révolutionnaire, suspendait la permanence des Sections (deux séances par semaine), et l’indemnisation des sectionnaires pauvres. Le 11, elle décrétait le maximum des prix. Le 17, elle votait la loi des suspects présentée par Merlin (de Douai). La définition des suspects était on ne peut plus large. Le 10 octobre, la Convention, sur le rapport de Saint-Just, membre du Comité de salut public, fait à la demande de la Convention elle-même (le 4 octobre), décréta que le gouvernement serait révolutionnaire jusqu’à la paix. Le 4 décembre (14 frimaire an II), l’organisation du gouvernement révolutionnaire était votée sur un rapport de Billaud-Varenne. (Notons qu’il fallut des mois pour le mettre en place partout, pour établir partout des autorités ayant la confiance du Comité, cœur du dispositif, et que, de ce fait, il ne fonctionna pleinement guère plus de quelques mois avant le 9 thermidor.) Toutes ces étapes montrent que les révolutionnaires agirent de manière empirique, pour répondre aux exigences des circonstances, et non par idéologie ni par plaisir.
Ce n’est que le 25 décembre (5 nivôse an II), trois mois après que la Terreur ait été instaurée de fait (une éternité en ce temps-là), que Robespierre la théorisa. Il n’en n’était pas l’instigateur. Il ne fut que la voix d’un régime légitime et humaniste aux abois. Son rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire fut acclamé, sanctionné par la Convention. Il suffit de le lire pour comprendre pourquoi.
« La théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi neuve que la révolution qui l'a amené. Il ne faut pas la chercher dans les livres des écrivains politiques, qui n'ont point prévu cette révolution, ni dans les lois des tyrans, qui, contens d'abuser de leur puissance, s'occupent peu d'en rechercher la légitimité ; aussi ce mot n'est-il pour l'aristocratie qu'un sujet de terreur ou un texte de calomnie ; pour les tyrans, qu'un scandale, pour bien des gens, qu'une énigme ; il faut l'expliquer à tous pour rallier au moins les bons citoyens aux principes de l'intérêt public.
« La fonction du gouvernement est de diriger les forces morales et physiques de la nation vers le but de son institution.
« Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République ; celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder.
« La Révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis ; la Constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible.
« Le gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité extraordinaire, précisément parce qu'il est en guerre. Il est soumis à des règles moins uniformes et moins rigoureuses, parce que les circonstances où il se trouve sont orageuses et mobiles, et surtout parce qu'il est forcé de déployer sans cesse des ressources nouvelles et rapides, pour des dangers nouveaux et pressans.
« Le gouvernement constitutionnel s'occupe principalement de la liberté civile : et le gouvernement révolutionnaire, de la liberté publique. Sous le régime constitutionnel, il suffit presque de protéger les individus contre les abus de la puissance publique : sous le régime révolutionnaire, la puissance publique elle-même est obligée de se défendre contre toutes les factions qui l'attaquent.
« Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute la protection nationale ; il ne doit aux ennemis du peuple que la mort.
« Ces notions suffisent pour expliquer l’origine et la nature des lois que nous appelons révolutionnaires. Ceux qui les nomment arbitraires ou tyranniques sont des sophistes stupides ou pervers qui cherchent à confondre les contraires : ils veulent soumettre au même régime la paix et la guerre, la santé et la maladie, ou plutôt ils ne veulent que la résurrection de la tyrannie et la mort de la patrie. S'ils invoquent l'exécution littérale des adages constitutionnels, ce n'est que pour les violer impunément. Ce sont de lâches assassins qui, pour égorger sans péril la République au berceau, s'efforcent de la garrotter avec des maximes vagues dont ils savent bien se dégager eux-mêmes.
« Le vaisseau constitutionnel n'a point été construit pour rester toujours dans le chantier ; mais fallait-il le lancer à la mer au fort de la tempête, et sous l'influence de vents contraires ? C'est ce que voulaient les tyrans et les esclaves qui s'étaient opposés à sa construction ; mais le peuple français vous a ordonné d'attendre le retour au calme. Ses voeux unanimes, couvrant tout-à-coup les clameurs de l'aristocratie et du fédéralisme, vous ont commandé de le délivrer d'abord de tous ses ennemis.
« Il doit voguer entre deux écueils, la faiblesse et la témérité, le modérantisme et l’excès ; le modérantisme, qui est à la modération, ce que l’impuissance est à la chasteté, et l’excès qui ressemble à l’énergie, comme l’hydropisie à la santé. [...] S’il fallait choisir entre un excès de ferveur patriotique et le néant de l’incivisme, ou le marasme du modérantisme, il n’y aurait pas à balancer. Un corps vigoureux, tourmenté par une surabondance de sève, laisse plus de ressource qu’un cadavre. [...] Si donc on regardait comme criminels tous ceux qui, dans le mouvement révolutionnaire, auraient dépassé la ligne exacte tracée par la prudence, on envelopperait dans une proscription commune, avec les mauvais citoyens, tous les amis naturels de la liberté, vos propres amis et tous les appuis de la république.
« En indiquant les devoirs du gouvernement révolutionnaire, nous avons marqué ses écueils. Plus son pouvoir est grand, plus son action est libre et rapide, plus il doit être dirigé par la bonne foi. Le jour où il tombera dans des mains impures ou perfides, la liberté sera perdue ; son nom deviendra le prétexte et l’excuse de la contre-révolution même ; son énergie sera celle d’un poison violent. [...] »
On chercherait en vain dans ce discours, comme dans les autres, une trace de folie. Tout est logique, justifié, raisonnable, à la hauteur des circonstances. L’homme qui fit ce rapport n’était pas altéré de sang. Moins d’une semaine plus tôt, le 20 décembre, c’est sur sa proposition et dans ses propres termes que la Convention avait décrété la création d’une commission chargée de rechercher et de faire libérer les patriotes arrêtés à tort : souci de justice sans tomber dans l’excès du modérantisme ou de l’indulgence. Mais le 24 décembre, Camille Desmoulins, son ami d’enfance et instrument de Danton, appela, dans son journal Le vieux Cordelier, à la création d’un comité de clémence. En dénaturant la proposition de Robespierre, en cherchant à substituer l’angélisme à la justice (révolutionnaire), Camille Desmoulins suscita la réaction de Billaud-Varenne qui, le 26, fit rapporter le décret, non sans que Robespierre le défendisse à nouveau, en vain cette fois. Cet épisode dit tout.
Robespierre affina encore sa théorie le 5 février (17 pluviôse an II). La violence — la violence d’Etat — est nécessaire quand l’Etat est en péril. Cette violence était du reste préférable à la violence populaire, telle qu’elle avait pu se déchaîner en septembre 1792. Mais, comme toute chose, elle recelait des pièges et des dangers à éviter autant que faire se pourrait.
« Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur : la vertu, sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu ; elle est moins un principe particulier, qu’une conséquence du principe général de la démocratie, appliqué aux plus pressans besoins de la patrie.
« On a dit que la terreur était le ressort du gouvernement despotique. Le vôtre ressemble-t-il donc au despotisme ? Oui, comme le glaive qui brille dans les mains des héros de la liberté, ressemble à celui dont les satellites de la tyrannie sont armés. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis ; il a raison, comme despote : domptez par la terreur les ennemis de la liberté ; et vous aurez raison comme fondateurs de la République. Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. La force n’est-elle faite que pour protéger le crime ? [...]
« Jusqu’à quand la fureur des despotes sera-t-elle appelée justice, et la justice du peuple, barbarie ou rébellion ? Comme on est tendre pour les oppresseurs, et inexorables pour les opprimés ! Rien de plus naturel : quiconque ne hait point le crime, ne peut aimer la vertu. [...] Punir les oppresseurs de l’humanité, c’est clémence ; leur pardonner, c’est barbarie. [...] La rigueur des tyrans n’a pour principe que la rigueur : celle du gouvernement républicain part de la bienfaisance. Aussi, malheur à celui qui oserait diriger vers le peuple la terreur qui ne doit approcher que de ses ennemis ! Malheur à celui qui, confondant les erreurs inévitables du civisme avec les erreurs calculées de la perfidie, ou avec les attentats des conspirateurs, abandonne l’intrigant dangereux, pour poursuivre le citoyen paisible ! Périsse le scélérat qui ose abuser du nom sacré de la liberté, ou des armes redoutables qu’elle lui a confiées, pour porter le deuil ou la mort dans le cœur des patriotes ! Cet abus a existé, on ne peut en douter. Il a été exagéré, sans doute, par l’aristocratie : mais existât-il dans toute la république qu’un seul homme vertueux persécuté par les ennemis de la liberté, le devoir du gouvernement serait de la rechercher avec inquiétude, et de le venger avec éclat. [...] »
Pour Robespierre, il ne s’agissait pas là que de rhétorique. Telle fut bien la position qu’il adopta, qu’il essaya de faire prévaloir et qui fit de tous les extrémistes de la Terreur et de tous les pourris ses ennemis personnels. C’est eux, Fouché en tête, qui eurent sa peau.
L’idéal de la Révolution
Ce fameux rapport du 17 pluviôse sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention dans l’administration intérieure de la République ne concernait pas seulement la Terreur, la République en guerre, il indiquait aussi l’idéal que la Révolution se proposait d’atteindre.
« Il faut prendre de loin ses précautions pour remettre les destinées de la liberté dans les mains de la vérité qui est éternelle, plus que dans celle des hommes qui passent, de manière que si le gouvernement oublie les intérêts du peuple, ou qu’il retombe entre les mains des hommes corrompus, selon le cours naturel des choses, la lumière des principes reconnus éclaire ses trahisons, et que toute faction nouvelle trouve la mort dans la seule pensée du crime.
« Heureux le peuple qui peut arriver à ce point ! car, quelques nouveaux outrages qu’on lui prépare, quelles ressources ne présente pas un ordre des choses où la raison publique est la garantie de la liberté !
« Quel est le but où nous tendons ? la jouissance paisible de la liberté et de l’égalité ; le règne de cette justice éternelle, dont les lois ont été gravées, non sur le marbre ou sur la pierre, mais dans les cœurs de tous les hommes, même dans celui de l’esclave qui les oublie, et du tyran qui les nie.
« Nous voulons substituer, dans notre pays, la morale à l’égoïsme, la probité à l’honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l’empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l’insolence, la grandeur d’âme à la vanité, l’amour de la gloire à l’amour de l’argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l’intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l’éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l’homme à la petitesse des grands, un peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole et misérable, c’est-à-dire, toutes les vertus et tous les miracles de la République, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie.
« Nous voulons, en un mot, remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l’humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le modèle des nations, l’effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l’ornement de l’univers, et qu’en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir briller au moins l’aurore de la félicité universelle… Voilà notre ambition, voilà notre but.
« Quelle nature de gouvernement peut réaliser ces prodiges ? Le seul gouvernement démocratique ou républicain : ces deux mots sont synonymes, malgré les abus du langage vulgaire ; car l’aristocratie n’est pas plus la république que la monarchie. La démocratie n’est pas un état où le peuple, continuellement assemblé, règle par lui-même toutes les affaires publiques, encore moins celui où cent mille fractions du peuple, par des mesures isolées, précipitées et contradictoires, décideraient du sort de la société entière : un tel gouvernement n’a jamais existé, et il ne pourrait exister que pour ramener le peuple au despotisme.
« La démocratie est un état où le peuple souverain, guidé par des lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu’il peut bien faire, et par des délégués tout ce qu’il ne peut faire lui-même.
« C’est donc dans les principes du gouvernement démocratique que vous devez chercher les règles de votre conduite politique.
« Mais, pour fonder et pour consolider parmi nous la démocratie, pour arriver au règne paisible des lois constitutionnelles, il faut terminer la guerre de la liberté contre la tyrannie, et traverser heureusement les orages de la Révolution : tel est le but du système révolutionnaire que vous avez régularisé. Vous devez donc encore régler votre conduite sur les circonstances orageuses où se trouve la République ; et le plan de votre administration doit être le résultat de l’esprit du gouvernement révolutionnaire, combiné avec les principes généraux de la démocratie. »
C’est finalement cet idéal, formulé par Robespierre, et, de manière générale, l’esprit égalitaire et démocratique de l’an II, dont Robespierre était là encore le champion, que tous les peuples et la postérité ont retenu comme étant l’idéal et l’esprit de la grande Révolution française, plus encore que les déclarations aristo-bourgeoises de 1789. C’est aussi la devise formulée par Robespierre que la République française fit sienne jusqu’à nos jours. Il n’y a pas de hasard.
L’an II fut sur tous les plans le moment fort de la Révolution, et Robespierre, le personnage le plus illustre du moment. Et ce n’est pas en raison du sang versé sous la Terreur que les bourgeois — qui en firent couler des torrents en d’autres temps — s’efforcèrent, par la suite, de noircir cette époque et Robespierre pour mettre en valeur 1789 et La Fayette mais parce que les idées qui furent alors développées étaient et sont encore une condamnation de leurs sophismes, de leur mesquinerie, de leur mépris pour le peuple, de leur lâcheté à l’heure du danger. Les idées d’un Robespierre sont encore révolutionnaires aujourd’hui à bien des égards, donc subversives et à étouffer pour ceux qui veulent que le peuple demeure nul. Pour étouffer ses idées, pour que personne ne s’y intéresse, il fallait salir, rendre exécrable ou faire oublier l’homme qui, deux jours avant d’être exécuté, déclarait encore du haut de la tribune de la Convention :
« Peuple, souviens-toi que si, dans la République, la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté n'est qu'un vain nom. Peuple, toi que l'on craint, que l'on flatte et que l'on méprise ; toi, souverain reconnu qu'on traite toujours en esclave, souviens-toi que partout où la justice ne règne pas, ce sont les passions des magistrats, et que le peuple a changé de chaînes et non de destinées.
« Souviens-toi qu'il existe dans ton sein une ligue de fripons qui lutte contre la vertu publique, qui a plus d'influence que toi-même sur tes propres affaires, et que, loin de sacrifier cette poignée de fripons à ton bonheur, tes ennemis veulent te sacrifier à cette poignée de fripons, auteurs de tous nos maux, et seuls obstacles à la prospérité publique.
« Sache que tout homme qui s'élèvera pour défendre la cause et la morale publique sera accablé d'avanies et proscrit par les fripons ; sache que tout ami de la liberté sera toujours placé entre un devoir et une calomnie ; que ceux qui ne pourront être accusés d'avoir trahi seront accusés d'ambition ; que l'influence de la probité et des principes sera comparée à la force de la tyrannie et à la violence des factions ; que ta confiance et ton estime seront des titres de proscription pour tous tes amis ; que les cris du patriotisme opprimé seront appelés des cris de sédition, et que, n'osant t'attaquer toi-même en masse, on te proscrira en détail dans la personne de tous les bons citoyens, jusqu'à ce que les ambitieux aient organisé leur tyrannie. Tel est l'empire des tyrans armés contre nous : telle est l'influence de leur ligue avec tous les hommes corrompus, toujours portés à les servir.
« Ainsi donc, les scélérats nous imposent la loi de trahir le peuple, à peine d'être appelés dictateurs. Souscrirons-nous à cette loi ? Non : défendons le peuple, au risque d'en être estimés ; qu'ils courent à l'échafaud par la route du crime, et nous par celle de la vertu. »
Le lendemain, les brigands triomphaient. Robespierre, son frère, ses amis, ses partisans étaient conduits à l’échafaud. C’en était fait de la Révolution. L’aristocratie de Largent s’installait définitivement au pouvoir.
Les factions
Même d’accord sur un but, les hommes peuvent diverger sur la question des moyens. Ils divergent d’autant plus sur la question des moyens qu’ils ne sont d’accord qu’en apparence sur le but. Il était donc dans la nature des choses que, face au Comité de salut public, se dressent des hommes sincères ou hypocrites voulant faire plus que lui, d’autres voulant faire moins, tous pensant ou prétendant vouloir la Révolution et le bien de la République. Robespierre appela les premiers, ultra-révolutionnaires, les seconds, citra-révoltionnaires. L’Histoire connaît les premiers sous le nom de Cordeliers ou d’Hébertistes, les seconds, sous celui d’Indulgents ou de Dantonistes.
Au vrai, le premier courant ultra-révolutionnaire, antérieur à l’hébertisme, fut celui des Enragés, incarnés par Jacques Roux, un prêtre constitutionnel (celui-là même qui accompagna Louis XVI à l’échafaud), les jeunes Varlet, le harangueur de rue, et Leclerc d’Oze, lié aux Républicaines révolutionnaires. Le terme faction est trop fort les concernant ; ils n’avaient aucun lien entre eux. Contrairement à une idée reçue, leur idéal ne différait en rien de celui de Robespierre (cf. la déclaration des droits de Varlet), ils n’étaient pas plus avancés que lui. Ils étaient seulement plus impatients, plus turbulents, moins prudents, moins tacticiens, moins politiques ; en un mot, c’étaient des gauchistes. Plus proches du peuple que Robespierre de par leur origine et leur situation, ils étaient obsédés par la questions des subsistances et réclamaient à cor et à cris la punition des accapareurs et l’instauration du maximum. Ils n’avaient pas tort sur le fond, mais leur agitation incessante, depuis le début de 1793, avait d’abord gêné les Montagnards dans leur duel avec les Girondins, puis leur acharnement à critiquer la Constitution, la Convention et le Comité, à saper l’unité, obligea les Jacobins à les neutraliser. Des intimidations de la part des Jacobins et de la Convention suffirent pour que Leclerc et Varlet se fassent oublier. Jacques Roux, arrêté une première fois par sa section le 22 août (libéré le 27), une seconde fois par les Jacobins le 5 septembre, se poignarda le 12 janvier 1794 au milieu du tribunal de police correctionnelle qui venait de renvoyer son affaire au Tribunal révolutionnaire, pensant qu’il serait acquitté comme Marat (le 24 avril 1793). Ayant survécut à ses blessures, il se poignarda de nouveau, avec succès, un mois plus tard.
Robespierre intervint dans cette affaire, mais il ne fut au fond qu’un parmi les Jacobins qui tous, Marat en tête, réprouvaient les Enragés. Cependant, ces derniers avaient beau être impolitiques et insupportables, ils étaient honnêtes, sincères, désintéressés. Ceci explique sans doute pourquoi les révolutionnaires se contentèrent de les paralyser (comme ils voulaient d’ailleurs le faire initialement avec les Girondins). Mais c’est une tout autre espèce d’hommes qui leur succéda, des hommes plus éminents, plus ambitieux et plus dangereux, des hommes dont le plus connu fut Hébert, substitut du procureur syndic de la Commune et rédacteur du journal Le Père Duchesne, très apprécié des Sans-culottes.
Hébert qui n’avait pas été le moins farouche contre les Girondins et les Enragés ne semblait respirer que pour l’outrance. Ayant repris à son compte le programme des Enragés, plutôt axé sur les questions économiques, il y ajouta des mesures politiques radicales qu’il prônait tant dans son journal qu’aux Jacobins : proscription des nobles, des prêtres, Terreur et déchristianisation tous azimuts. Ce faisant, il attaquait le Comité de salut et ses membres qui, plus responsables, confrontés à la réalité des problèmes et à la difficulté de trouver des hommes compétents (parmi les bourgeois, les ex-prêtres et même les ex-nobles), ne voulaient ni ne pouvaient se permettre de tomber dans l’excès. Hébert marchait avec Chaumette, de la Commune, et était soutenu par Bouchotte, le ministre de la guerre qui diffusait son journal auprès des armées, par les chefs de l’armée révolutionnaire et, sur la fin, par les Cordeliers.
Mais une autre faction faisait pendant à celle-là, incarnée par Danton, homme plus que trouble, député de Paris, grand tribun, fondateur du club des Cordeliers, jacobin, partisan de tous les compromis et de la paix à tout prix. Il est avéré aujourd’hui qu’il avait été payé par la Cour, via Mirabeau, pour compromettre le mouvement révolutionnaire, et par l’Espagne, via Ocariz, pour sauver Louis XVI. En autres actes de corruption, il fut formellement accusé par le maréchal de camp Miaczynski d’avoir organisé avec Lacroix, à Liège et à Aix-la-Chapelle, deux fabriques de faux assignats, information que Miaczynski, condamné à mort le 17 mai, confia à des commissaires de la Convention le 18 mai avant d’être exécuté le 22. Danton couvrait ses manœuvres et ses échecs par de grandes déclarations. De fait, il soutint la création de toutes les institutions révolutionnaires et même l’instauration de la Terreur. Mais ses collègues n’étaient pas dupes. Certains se défiaient de son caractère, voire soupçonnaient ses trahisons ; d’autres, au contraire, partageaient ses vues et formaient avec lui la faction des Indulgents.
Ces deux factions rivales — aux contours mal définis, certains hommes pouvant même être classés dans les deux à la fois, suivant le sujet — attaquaient le Comité pour des raisons opposées et se dénonçaient mutuellement. Le Comité pouvait donc s’appuyer tantôt sur l’une pour contrer l’autre, tantôt sur l’autre pour contrer la première. Mais les attaques dont il était en permanence l’objet contrariaient son action et menaçaient jusqu’à son existence. En outre, elles divisaient les révolutionnaires à un moment où l’union était plus que jamais nécessaire. C’est d’abord à la raison et à la réconciliation qu’en appela Robespierre, en son nom et au nom du Comité, en présentant les dangers de telles attitudes. Sa première intervention, le 25 septembre, faisait suite à une attaque de la droite, motivée par les difficultés militaires :
« On nous accuse de ne rien faire, mais a-t-on donc réfléchi à notre position ? Onze armées à diriger, le poids de l’Europe entière à porter, partout des traîtres à démasquer, des émissaires soudoyés par l’or des puissances étrangères à déjouer, des administrateurs infidèles à surveiller, à poursuivre, partout à aplanir des obstacles et des entraves à l’exécution des plus sages mesures ; tous les tyrans à combattre, tous les conspirateurs à intimider, eux qui se trouvent presque tous dans une caste puissante autrefois par ses richesses et encore par ses intrigues : telles sont nos fonctions. Croyez-vous que, sans unité d’action, sans le secret dans les opérations, sans la certitude de trouver un appui dans la Convention, le gouvernement puisse triompher de tant d’obstacles et de tant d’ennemis ? Non, il n’y a que la plus extrême ignorance ou la plus profonde perversité qui puissent prétendre que dans de pareilles circonstances, on ne soit pas un ennemi de la patrie, alors qu’on se fait un jeu cruel d’avilir ceux qui tiennent le timon des affaires, d’entraver leurs opérations, de calomnier leur conduite. »
Dans cette discussion, Billaud, Barère, Prieur (de la Marne) et Jeanbon Saint-André, tous membres du Comité, étaient aussi intervenus, mais c’est lui, Robespierre, qui obtint que la Convention unanime accorde toute sa confiance au Comité. Un mot fort applaudi de Basire illustre tout le prestige dont il jouissait : « Où en serions-nous donc si Robespierre avait besoin de se justifier devant la Montagne ? »
Le Comité ayant obtenu la confiance sans équivoque de la Convention, les factions ne purent plus l’attaquer frontalement et furent réduites à se déchirer entre elles, notamment aux Jacobins. Leur querelle s’intensifia fin novembre avec le retour de Danton, le 18 novembre. Objets d’attaques en raison de son comportement louche, il s’était retiré à Arcis-sur-Aube le 12 octobre. L’arrestation de son ami Chabot l’avait décidé à quitter sa retraite et à plaider désormais ouvertement l’indulgence (avec comme arrière pensée de renverser les Comités, de conclure une paix de compromis, de réviser la Constitution et de mâter les Sans-culottes, dixit Garat), à la grande fureur des hébertistes. Il entama sa campagne aux Jacobins, le 22 novembre, en s’opposant comme Robespierre, par tactique, à la déchristianisation mais aussi à la Terreur, en demandant « l’économie du sang des hommes ». (A cette époque, la Terreur ne représentait presque rien. Il n’y avait eu à Paris que 152 exécutions depuis l’instauration du Tribunal révolutionnaire en avril, pour 252 acquittements et 69 condamnations à des peines diverses.)
Dès le 5 décembre, par sa réponse au manifeste des rois ligués contre la République, Robespierre mit en garde les uns et les autres (voir plus haut) qui tous avaient trempé dans la déchristianisation qui semblait alors le principal moyen de la contre-révoltion. En disant que ce mouvement était une manœuvre de l’étranger, mais en n’accusant personne, il permettait aux naïfs de se reprendre. Mais les hypocrites ou les irresponsables étaient prévenus.
Le 25 décembre, la situation avait changé. Le 15 décembre avait paru le n° 3 du Vieux Cordelier de Camille Desmoulins qui appelait à la clémence. Le 17, les Indulgents avaient réussi à faire décréter d’arrestation Vincent et Ronsin. Le 19, était découverte l’implication de Fabre d’Eglantine, ami de Danton, qui avait dénoncé Chabot, dans la falsification d’un décret, elle-même rattachée à un vaste complot. Le 20, des femmes de Lyon étaient venues pleurer à la Convention. Robespierre lui-même avait obtenu la formation d’une commission de justice. Le 21, Fabre qui n’avait pas encore été arrêté obtenait l’arrestation de Mazuel, lieutenant de Ronsin. L’indulgence avait le vent en poupe. Mais les Sections grondaient et les ultra-révolutionnaires furent regonflés par Collot-d’Herbois, membre du Comité de salut public, de retour de Lyon. Le 23, aux Jacobins, alors que les accusations fusaient, Robespierre appela à l’union. « Soyez-en persuadés, la tactique de nos ennemis, et elle est sûre, c’est de nous diviser, on veut que luttant corps à corps, nous nous déchirions de nos propres mains. » Le 24, paraissait le n° 4 du Vieux Cordelier qui appelait à la fin de la Terreur. C’est donc dans ce contexte tendu que, le 25 décembre, Robespierre fit son rapport sur les Principes du gouvernement révolutionnaire (voir plus haut) dans lequel il parla pour la première fois de faction à propos des uns et des autres. Sa position était sans ambiguïté : « S’il fallait choisir entre un excès de ferveur patriotique et le néant de l’incivisme, ou le marasme du modérantisme, il n’y aurait pas à balancer. Un corps vigoureux, tourmenté par une surabondance de sève, laisse plus de ressource qu’un cadavre. » Position théorique en vérité.
Robespierre avait été assez proche de Danton depuis le début de la Révolution et était plus proche encore de Desmoulins qui était un ami d’enfance ; il avait été le témoin à son mariage et était même le parrain de son fils. Ces considérations le portèrent à les ménager autant qu’il put, jusqu’à ce qu’il devint impossible de les défendre. Le 10 janvier, il lâchait Desmoulins tout en faisant rapporter la décision des Jacobins de l’exclure de leur sein.
« Tous les hommes de bonne foi doivent s’apercevoir que je ne défends pas Camille Desmoulins, mais que je m’oppose seulement à sa radiation isolée parce que je sais que l’intérêt public n’est pas qu’un individu se venge d’un autre, qu’une coterie triomphe d’une autre. Il faut que tous les intrigans sans exception soient dévoilés et mis à leur place. Je termine en demandant que la Société, regardant son arrêté comme non avenu, s’occupe de discuter l’intrigue générale en ne prenant pas des intrigans isolés pour l’objet de sa discussion, ou que l’on mette à l’ordre du jour les crimes du gouvernement britannique. »
Le 7 janvier, Robespierre avait proposé aux Jacobins de cesser leurs disputes et de s’intéresser au gouvernement anglais. Cette idée n’était pas stupide. Les Jacobins en sentirent l’utilité et une douzaine au moins de discours furent en effet prononcés par la suite sur ce sujet. C’est alors que Robespierre tomba malade une première fois. Lorsqu’il revint, quinze jours plus tard, le 5 février (17 pluviôse), il fit son rapport sur les principes de morale politique, dans lequel il fustigeait les factions qui, pour être moins actives, n’avaient pas disparu pour autant :
« Les ennemis intérieurs du peuple français se sont divisés en deux factions, comme en deux corps d’armée. Elles marchent sous des bannières de différentes couleurs et par des routes diverses : mais elles marchent au même but ; ce but est la désorganisation du gouvernement populaire, la ruine de la Convention, c’est-à-dire, le triomphe de la tyrannie. L’une de ces deux factions nous pousse à la faiblesse, l’autre aux excès. L’une veut changer la liberté en bacchante, l’autre en prostituée. [...]
« Le faux révolutionnaire est peut-être plus souvent encore en-deçà qu’au-delà de la Révolution : il est modéré, il est fou de patriotisme, selon les circonstances. On arrête dans les comités prussiens, anglais, autrichiens, moscovites même, ce qu’il pensera le lendemain. Il s’oppose aux mesures énergiques, et les exagère quand il n’a pu les empêcher : sévère pour l’innocence, mais indulgent pour le crime : accusant même les coupables qui ne sont point assez riches pour acheter son silence, ni assez importans pour mériter son zèle ; mais se gardant bien de jamais se compromettre au point de défendre la vertu calomniée : découvrant quelquefois des complots découverts, arrachant le masque à des traîtres démasqués et même décapités ; mais prônant les traîtres vivans et encore accrédités : toujours empressé à caresser l’opinion du moment, et non moins attentif à ne jamais l’éclairer, et sur-tout à ne jamais la heurter : toujours prêt à adopter les mesures hardies, pourvu qu’elles aient beaucoup d’inconvéniens : calomniant celles qui ne présentent que des avantages, ou bien y ajoutant tous les amendemens qui peuvent les rendre nuisibles : disant la vérité avec économie, et tout autant qu’il faut pour acquérir le droit de mentir impunément : distillant le bien goutte-à-goutte, et versant le mal par torrens : plein de feu pour les grandes résolutions qui ne signifient rien ; plus qu’indifférent pour celles qui peuvent honorer la cause du peuple et sauver la patrie : donnant beaucoup aux formes du patriotisme ; très-attaché, comme les dévots dont il se déclare l’ennemi, aux pratiques extérieures, il aimerait mieux user cent bonnets rouges que de faire une bonne action. [...]
« Si tous les coeurs ne sont pas changés, combien de visages sont masqués ! combien de traîtres ne se mêlent de nos affaires que pour les ruiner ! Voulez-vous les mettre à l’épreuve, demandez-leur, au lieu de serment et de déclaration, des services réels ?Faut-il agir ? Ils pérorent. Faut-il délibérer ? Ils veulent commencer par agir. Les temps sont-ils paisibles ? Ils s’opposeront à tout changement utile. Sont-ils orageux ? Ils parleront de tout réformer, pour bouleverser tout. Voulez-vous contenir les séditieux ? Ils vous rappellent la clémence de César. Voulez-vous arracher les patriotes à la persécution ? Ils vous proposent pour modèle la fermeté de Brutus ; ils découvrent qu’un tel a été noble, lorsqu’il sert la république ; ils ne s’en souviennent plus dès qu’il la trahit. La paix est-elle utile ? Ils vous étalent les palmes de la victoire. La guerre est-elle nécessaire ? Ils vantent les douceurs de la paix. Faut-il défendre le territoire ? Ils veulent aller châtier les tyrans au-delà des monts et des mers. Faut-il reprendre nos forteresse ? Ils veulent prendre d’assaut les églises et escalader le ciel. Ils oublient les Autrichiens pour faire la guerre aux dévotes. Faut-il appuyer notre cause de la fidélité de nos alliés ? Ils déclameront contre tous les gouvernemens du monde, et vous proposeront de mettre en état d’accusation le grand Mogol lui-même. Le peuple va-t-il au Capitole rendre grâce de ses victoires ? ils entonnent des chants lugubres sur nos revers passés. S’agit-il d’en remporter de nouvelles ? Ils sèment, au milieu de nous, les haines, les divisions, les persécutions et le découragement. Faut-il réaliser la souveraineté du peuple et concentrer sa force par un gouvernement ferme et respecté ? Ils trouvent que les principes du gouvernement blessent la souveraineté du peuple. Faut-il réclamer les droits du peuple opprimé par le gouvernement ? Ils ne parlent que du respect pour les lois, et de l’obéissance due aux autorités constituées.
« Ils ont trouvé un expédient admirable pour seconder les efforts du gouvernement républicain : c’est de le désorganiser, de le dégrader complètement, de faire la guerre aux patriotes qui ont concouru à nos succès. Cherchez-vous les moyens d’approvisionner vos armées ? vous occupez-vous d’arracher à l’avarice et à la peur les subsistances qu’elles resserrent ? Ils gémissent patriotiquement sur la misère publique et annoncent la famine. Le désir de prévenir le mal est toujours pour eux un motif de l’augmenter. dans le Nord, on a tué les poules, et on nous a privé des œufs, sous le prétexte que les poules mangent du grain. Dans le Midi il a été question de détruire les mûriers et les orangers, sous le prétexte que la soie est un objet de luxe, et les oranges une superfluité. Vous ne pourriez jamais imaginer certains excès commis par des contre-révolutionnaires hypocrites, pour flétrir la cause de la Révolution. »
Six jours plus tard, Robespierre tombait de nouveau malade pour un mois, du 13 février au 12 mars. C’est dans cet intervalle que la crise atteignit son paroxysme. Le danger le plus pressant vint finalement des ultras, des Cordeliers, sous l’impulsion de Vincent, Ronsin (libérés le 2 février), Momoro, Hébert, Carrier (le bourreau de Nantes, dénoncé par Jullien de Paris et rappelé sur l’avis de Robespierre) qui profitèrent de l’absence de Robespierre pour l’insulter et s’agiter sous prétexte des subsistances. Le 4 mars, ils appelèrent à l’insurrection. Mais ils avaient commis l’erreur classique de prendre Robespierre pour le maître. Le Comité pouvait fonctionner sans lui et tous ses membres firent bloc. Collot-d’Herbois notamment leur fit face. La menace d’une insurrection se précisait (quoique les Sections ne suivaient manifestement pas le mouvement).
Le 13 mars, suite au rapport de Saint-Just sur les factions de l’étranger, la Convention chargea l’accusateur public d’arrêter et de poursuivre « ceux qui seront convaincus d’avoir, de quelque manière que ce soit, favorisé dans la République le plan de corruption des citoyens, de subversion des pouvoirs et de l’esprit public ; d’avoir excité des inquiétudes à dessein d’empêcher l’arrivage des denrées à Paris ; d’avoir donné asile aux émigrés ; ceux qui auront tenté d’ouvrir les prisons ; ceux qui auront introduit des armes dans Paris dans le dessein d’assassiner le peuple et la liberté ; ceux qui auront tenté d’ébranler ou d’altérer la forme du gouvernement républicain. »
Les Cordeliers étaient visés aussi bien que les Indulgents. Le soir même, sur ordre de Fouquier-Tinville, l’accusateur public, les meneurs Cordeliers furent arrêtés. Dans les jours qui suivirent, Robespierre insista pour que la portée politique de cette affaire soit mise en relief (ce que n’avait pas fait Vadier dans son rapport et qui en voulut à mort à Robespierre de cette critique qu’il rappela comme un crime le 9 thermidor) mais s’opposa, aux Jacobins, à ce que les arrestations se multiplient. (Il couvrit ainsi Pache, le maire de Paris, Hanriot, commandant de la garde nationale, Boulanger, général de l’armée révolutionnaire, mais il s’opposa aussi à l’arrestation en masse des signataires des pétitions contre-révolutionnaires dites des 8.000 et des 20.000.) Après trois jour de procès, les Cordeliers furent exécutés, le 24 mars (4 germinal an II).
Mais si le Comité était résolu à en finir avec certains excès et le danger de gauche, tout en satisfaisant les revendications populaires légitimes, il n’entendait pas être débordé par sa droite. Le 18 mars, les députés compromis dans l’affaire de la Compagnie des Indes (vaste complot visant à discréditer la Convention), Fabre, Chabot, Basire, Delaunay, tous dantonistes, étaient décrétés d’accusation. Le 20, les Indulgents passaient à l’offensive à leur tour et obtenaient l’arrestation de Héron, agent du Comité de sûreté générale. Mais Robespierre intervint et fit rapporter le décret. Le 21 mars, jour de l’ouverture du procès des Cordeliers, était enfin publié le tableau du maximum. Le 27, l’armée révolutionnaire était licenciée. Le 29, La Convention décrétait la suppression des commissaires aux accaparements institués par les Sections pour veiller à l’application du maximum. Le lendemain, harcelé depuis des jours par ses collègues des deux Comités qui auraient fini par se passer de son avis, Robespierre consentit à l’arrestation des Indulgents, Danton et Desmoulins compris. Il avait d’ailleurs rencontré Danton la veille et s’était convaincu qu’il n’y avait rien à espérer. Les Indulgents furent donc arrêtés dans la nuit du 30 au 31 mars sur ordre des Comités de salut public et de sûreté générale. Cet ordre d’arrestation est celui qui revêt le plus grand nombre de signatures (18), preuve de l’unanimité des membres des Comités sur cette affaire.
Une fois de plus, le Comité n’avait frappé que les chefs. Or, contrairement aux Cordeliers, les meneurs Indulgents étaient pour la plupart députés et avaient encore des amis à la Convention qui, poussée par Legendre, s’agita en apprenant leur arrestation. Robespierre et Barère intervinrent et ramenèrent le calme. Le procès des Indulgents, dont Fabre était le principal accusé, quoique l’histoire en ait fait le procès de Danton, s’ouvrit le 2 avril. Le 5 avril (16 germinal an II), ils étaient exécutés. Seuls Camille Desmoulins et Philippeaux furent réhabilités par la Convention thermidorienne (le 11 vendémiaire an III), preuve qu’ils furent frappés par la Convention unanime, qui considérait Danton et ses amis comme des pourris.
Les factions étaient abattues (une troisième « fournée » eut lieu le 24 germinal an II, réunissant les personnages secondaires des deux factions, Chaumette, Lucille Desmoulins, la veuve d’Hébert, etc.), mais tous les factieux n’étaient pas morts, tandis que les caractères conduisant aux idées factieuses, démagogiques, extrémistes et défaitistes, sont impérissables. L’opposition n’étaient donc mâtée que pour un temps.
Il ressort que Robespierre participa à la nécessaire lutte contre les factions mais ne fut pas le seul acteur. Cette lutte n’avait rien de personnel. Les factions sapaient l’autorité de la Convention, attaquaient à tord et à travers les Comités, divisaient les révolutionnaires et menaçaient consciemment ou non la République. Beaucoup le comprirent et les combattirent. Leur écrasement ne fut en rien une victoire de Robespierre qui, non seulement, n’en retira pas une once de pouvoir en plus, mais, dut bientôt renoncer à exercer le peu qu’il avait, étant en bute à l’hostilité de ses collègues (le Comité n’étant plus menacé de l’extérieur, ses membres se désunirent jusqu’à s’entretuer).
L’Etre suprême
Robespierre reconnaissait n’avoir jamais été un bon catholique (21 novembre 1793). Mais, à l’instar de la plupart de ses contemporains et des hommes de tous les temps, il croyait en Dieu, en une puissance supérieure, en un créateur, en ce que l’on appelait alors l’Etre suprême. Il pensait également que les hommes ont une âme immortelle. Pour autant, il était loin d’être un bigot. Il ne raisonnait jamais en religieux, toujours en politique ; il ne s’appuyait pas sur des présupposés métaphysiques ou des vérités révélées, mais sur la nature humaine et les rapports sociaux.
En fait, il n’évoqua ses convictions personnelles qu’une seule fois, le 26 mars 1792, aux Jacobins, lorsque le girondin Guadet lui reprocha d’avoir répété le mot Providence. « J’avoue, dit ce denier, que, ne voyant aucun sens à cette idée, je n’aurais jamais cru qu’un homme qui a travaillé avec tant de courage pendant trois ans pour tirer le peuple de l’esclavage du despotisme pût concourir à le remettre ensuite sous l’esclavage de la superstition. » Cette attaque était une manœuvre politique pour déstabiliser celui qui contrariait les Girondins depuis des mois. Mais ce coup bas provoqua une telle indignation dans l’assistance que la presse girondine n’osa le rapporter. Robespierre en effet ne s’était pas laissé démonter et avait épanché son cœur.
« Quand j’aurai terminé ma courte réponse, je suis sûr que M. Guadet se rendra lui-même à mon opinion. J’en atteste son patriotisme et sa gloire qui ne peuvent être fondés que sur les principes que je viens de proposer ; mais l’objection qu’il ma faite, tient trop à mon honneur, à mes sentiments et aux principes reconnus par tous les peuples du monde, et par les assemblées de tous les peuples et de tous les tems, pour que je ne croye pas mon honneur engagé à les soutenir de toutes mes forces.
« La première objection porte sur ce que j’aurais commis la faute d’induire les citoyens dans la superstition après avoir combattu le despotisme. La superstition, il est vrai, est un des appuis du despotisme, mais ce n’est point induire les citoyens dans la superstition que de prononcer le nom de la divinité, j’abhorre autant que personne toutes ces sectes impies qui ses sont répandues dans l’univers pour favoriser l’ambition, le fanatisme et toutes les passions, en se couvrant du pouvoir secret de l’éternel qui a créé la nature et l’humanité, mais je suis bien loin de la confondre avec ces imbéciles dont le despotisme s’est armé. Je soutiens, moi, ces éternels principes sur lesquels s’étaie la faiblesse humaine pour s’élancer à la vertu. Ce n’est point un vain langage dans ma bouche, pas plus que dans celle de tous les hommes illustres qui n’en avaient pas moins de morale pour croire à l’existence de dieu.
« Oui, invoquer le nom de la providence et émettre une idée de l’être éternel qui influe essentiellement sur les destins des nations, qui me paraît à moi veiller d’une manière toute particulière sur la révolution française, n’est point une idée trop hasardée, mais un sentiment de mon cœur, un sentiment qui m’est nécessaire ; comment ne me serait-il pas nécessaire à moi qui, livré dans l’assemblée constituante à toutes les passions, à toutes les viles intrigues, et environné de tant d’ennemis nombreux, me suis soutenu. Seul avec mon âme, comment aurais-je pu soutenir des travaux qui sont au-dessus de la force humaine, si je n’avais point élevé mon âme. Sans trop approfondir cette idée encourageante, ce sentiment divin m’a bien dédommagé de tous les avantages offerts à ceux qui voulaient trahir le peuple. [...]
« On a dit encore que j’avais fait une injure aux sociétés populaires. Ah ! certes, messieurs, je vous en atteste tous, s’il est un reproche auquel je sois inaccessible, c’est celui qui me prête des injures au peuple, et cette injure consiste en ce que j’ai cité aux sociétés, la providence et la divinité. Certes je l’avoue, le peuple français est bien pour quelque chose dans la révolution. J’avoue que tous ceux qui étaient au-dessus du peuple auraient volontiers renoncé pour cet avantage à toute idée de la divinité, mais est-ce faire injure au peuple, aux sociétés affiliées que de leur donner l’idée d’une divinité, qui, suivant mon sentiment, nous sert si heureusement. Oui, j’en demande pardon à tous ceux qui sont plus éclairés que moi, quand j’ai vu tant d’ennemis créés contre le peuple, tant d’hommes perfides employés pour renverser l’ouvrage du peuple, quand j’ai vu que le peuple lui-même ne pouvait agir, et qu’il était obligé de s’abandonner à des hommes perfides ; alors plus que jamais j’ai cru à la providence et je n’ai jamais pu insulter, ni le peuple, ni les sociétés populaires, en parlant comme je l’ai fait, des mesures qu’il faut prendre pour la guerre ou pour la paix ; ni dans le retour que j’ai fait sur ce qui s’est passé. »
Robespierre exprimait là le sentiment général. Seuls des hypocrites et des athées fanatiques pouvaient et peuvent encore voir un angle d’attaque dans ce sujet qu’il n’abordait d’ailleurs jamais. Oubliaient-ils que toute l’Europe était chrétienne, que, à la demande de l’abbé de la Borde, la Constituante avait proclamé les droits de l’homme et du citoyen « en présence et sous les auspices de l’Etre suprême » (26 août 1789) ? Robespierre n’y était pour rien. Peut-être peut-on, avec beaucoup d’imagination, accuser Robespierre d’avoir contraint la Convention montagnarde à faire de même pour sa Déclaration du 24 juin 1793. Mais dira-t-on que la Convention thermidorienne, composée à quelque chose près des mêmes hommes que précédemment, tremblait encore au souvenir de Robespierre quand elle proclama, elle aussi en présence de l’Etre suprême, sa déclaration des devoirs et des droits de l’homme et du citoyen (22 août 1795) ? Et était-ce par fantaisie que Napoléon rétablit l’Eglise ? Non ! les Français dans leur immense majorité et quelle que fut leur classe n’étaient pas athées et n’avaient pas besoin que Robespierre leur inculque la croyance en un Etre suprême. Ils furent au contraire heureux de trouver un Robespierre pour les défendre quand, en l’an II, une infime minorité les brima pour leurs convictions religieuses.
C’est d’ailleurs le mouvement déchristianisateur qui explique pourquoi la Convention fut progressivement amenée à proclamer, par la bouche de Robespierre, l’existence de l’Etre suprême et l’immortalité de l’âme.
La déchristianisation symbolisée par la fermeture des églises et le culte de la Raison ne fut pas un mouvement athée comme Robespierre le pensait et comme les contre-révolutionnaires le prétendirent. Mais la violence dans les faits et l’ambiguïté dans les termes suscitèrent la stupeur, l’incompréhension et le rejet, d’où le décret du 18 frimaire (8 décembre) sur la liberté des cultes pour y mettre officiellement un coup d’arrêt. C’est alors que l’importance d’un autre paramètre apparut : le changement de calendrier.
La déchristianisation avait désorganisé l’ancien culte sans rien lui substituer. Le jour de fête était désormais le décadi, mais rien, ni thème ni budget, n’avait été prévu. Partout les révolutionnaires organisaient des fêtes selon leur inspiration, mais le défaut d’unité au niveau national se faisait cruellement sentir. Dès le mois de décembre, le malaise était signalait. Les demandes pressant le Comité d’organiser les fêtes décadaires ne cessèrent dès lors d’affluer.
Ainsi, le 24 février, dans une lettre particulièrement significative, le représentant Paganel, alors à Villefranche, signala au Comité la rivalité des dimanches et des décadis. « Une mesure générale [pour abattre les obstacles au développement de la raison] doit à la fois les attaquer dans toute la République. C’est à vous de la proposer, et à la Convention de l’établir. Le peuple respecte et choisit toutes institutions qui viennent d’elle. [...] Il faut qu’un jour marqué par le plaisir et par des sensations extraordinaires lui [le peuple] fasse oublier plusieurs jours de peine et de travail, et que le retour prévu de ce jour l’empêche de craindre les nouvelles peines qui le précèdent. Le dimanche est triste par lui-même et sous le rapport religieux, mais il donne lieu à des rassemblements, à des entretiens, à quelques danses. Les regards sont accoutumés ces jour-là à une sorte de spectacle. L’ennuyeux sermon est suivi de chants et de cérémonies précieuses au peuple, bien que tristes, tandis qu’on ne mettra rien à la place. [...] Hâtez-vous donc, citoyens mes collègues, de procurer aux citoyens des campagnes une sorte de fête décadienne, qui les rassemble et leur fasse trouver, à la place de cérémonies lugubres, les amusements et les instructions qui conviennent à des hommes libres. »
En fait, le Comité d’instruction publique s’était saisi du dossier dès le mois de janvier. Les 2 et 10 janvier, sur la proposition de Mathieu (de l’Oise), il avait adopté le principe qu’« il y aura[it] des fêtes révolutionnaires qui perpétueront les événements les plus remarquables de la Révolution. » Le 27 février (9 ventôse), ledit Comité avait arrêté que le projet de fêtes nationales et décadaires présenté par Mathieu serait imprimé et distribué aux membres de la Convention. L’article 5 de ce projet qui en comptait 37 stipulait : « Ces fêtes, instituées sous les auspices de l’Être-suprême, auront pour objet de réunir tous les citoyens, de leur retracer les droits et les devoirs de l’homme en société, de leur faire chérir la nature et toutes les vertus sociales. » Le 11 germinal (31 mars), le Comité autorisa Mathieu à se concerter avec le Comité de salut public au sujet de ce plan. Le 6 avril (17 germinal), Couthon annonça à la Convention, à sa grande satisfaction, que le Comité de salut public présenterait d’ici peu « un projet de fête décadaire dédié à l’Eternel, dont les Hébertistes n’ont pas ôté au peuple l’idée consolante ». La simple annonce de ce projet de décret suscita partout l’enthousiasme. Le 6 mai, de Quillan (Aude), Chaudron-Roussau écrivit au Comité : « Le décret de la Convention sur la croyance d’un Etre suprême y a produit [à Carcassonne] un très bon effet. Les hébertistes avaient ici quelques disciples. L’un d’eux a été professeur des maximes d’athéisme. A l’avant-dernière décade, mes coopérateurs et moi l’avons accablé en lui répliquant, et il n’est point d’acte de bienfaisance qui eût excité dans le peuple autant de reconnaissance que cette réfutation publique d’une doctrine d’athée et l’assurance que nous n’avons pas manqué d’y joindre, que nos principes sur la croyance d’un Dieu étaient ceux de la Convention et du Comité de salut public. » Des fêtes expressément dédiées à l’Etre suprême avaient déjà eu lieu dans de nombreuses villes, sans parler des célébrations ordinaires dans les temples de la Raison qui n’étaient pas autre chose. Ainsi, Lejeune signala au Comité que, le 6 avril, à Dôle, il avait inauguré, au milieu de quatre à cinq mille citoyens en liesse, « le temple consacré à l’éternelle vérité, c’est-à-dire à l’Etre suprême ».
C’est après toutes ces péripéties et dans ce contexte que, le 18 floréal (7 mai), Robespierre fit à la Convention son fameux rapport sur les idées religieuses et morales, au terme duquel il proposait de reconnaître à la face du monde l’existence de l’Etre suprême et l’immortalité de l’âme et d’adopter un plan de fêtes décadaires qui reprenait en le simplifiant celui de Mathieu.
« Ne consultez que le bien de la patrie et les intérêts de l’humanité. Toute institution, toute doctrine qui console et qui élève les âmes, doit être accueillie ; rejettez toutes celles qui tendent à les dégrader et à les corrompre. Ranimez, exaltez tous les sentimens généreux et toutes les grandes idées morales qu’on a voulu éteindre ; rapprochez par le charme de l’amitié et par le lien de la vertu les hommes qu’on a voulu diviser. Qui donc t’a donné la mission d’annoncer au peuple que la Divinité n’existe pas, ô toi qui te passionnes pour cette aride doctrine, et qui ne te passionnas jamais pour la patrie ? Quel avantage trouves-tu à persuader l’homme qu’une force aveugle préside à ses destinées, et frappe au hasard le crime et la vertu ; que son âme n’est qu’un souffle léger qui s’éteint aux portes du tombeau ? [...] Je ne conçois pas du moins comment la nature aurait pu suggérer à l’homme des fictions plus utiles que toutes les réalités ; et si l’existence de Dieu, si l’immortalité de l’âme, n’étaient que des songes, elles seraient encore la plus belle de toutes les conceptions de l’esprit humain.
« Je n’ai pas besoin d’observer qu’il ne s’agit pas ici de faire le procès à aucune opinion philosophique en particulier, ni de contester que tel philosophe peut être vertueux, quelles que soient ses opinions, et même en dépit d’elles, par la force d’un naturel heureux ou d’une raison supérieure. Il s’agit de considérer seulement l’athéisme comme national, et lié à un système de conspiration contre la République. Eh ! que vous importe à vous, législateurs, les hypothèses diverses par lesquelles certains philosophes expliquent les phénomènes de la nature ? Vous pouvez abandonner tous ces objets à leurs disputes éternelles : ce n’est ni comme métaphysiciens, ni comme théologiens, que vous devez les envisager. Aux yeux du législateur, tout ce qui est utile au monde et bon dans la pratique, est la vérité.
« [...] Il résulte du même principe qu’on ne doit jamais attaquer un culte établi qu’avec prudence et avec une certaine délicatesse, de peur qu’un changement subit et violent ne paraisse une atteinte portée à la morale, et une dispense de la probité même. Au reste, celui qui peut remplacer la Divinité dans le système de la vie sociale est à mes yeux un prodige de génie ; celui qui, sans l’avoir remplacée, ne songe qu’à la bannir de l’esprit des hommes, me paraît un prodige de stupidité ou de perversité. [...] »
« Cette secte [les encyclopédistes], en matière politique, resta toujours au-dessous des droits du peuple : en matière de morale, elle alla beaucoup au-delà de la destruction des préjugés religieux. Ses coryphées déclamaient quelquefois contre le despotisme, et ils étaient pensionnés par les despotes ; ils faisaient tantôt des livres contre la Cour, et tantôt des dédicaces aux rois, des discours pour les courtisans, et des madrigaux pour les courtisanes ; ils étaient fiers dans leurs écrits, et rampans dans les anti-chambres. Cette secte propagea avec beaucoup de zèle l’opinion du matérialisme qui prévalut parmi les grands et parmi les beaux esprits. [...] Ils ont combattu la Révolution, dès le moment qu’ils ont craint qu’elle n’élevât le peuple au-dessus de toutes les vanités particulières [...] Tel artisan s’est montré habile dans la connaissance des droits de l’homme, quand tel faiseur de livres, presque républicain en 1788, défendait stupidement la cause des rois en 1793. [...]
« Fanatiques, n’espérez rien de nous. Rappeler les hommes au culte pur de l’Être suprême, c’est porter un coup mortel au fanatisme. Toutes les fictions disparaissent devant la Vérité et toutes les folies tombent devant la Raison. Sans contrainte, sans persécution, toutes les sectes doivent se confondre d’elles-mêmes dans la religion universelle de la Nature. [...]
« Prêtres ambitieux, n’attendez donc pas que nous travaillions à rétablir votre empire ; une telle entreprise serait même au-dessus de notre puissance. Vous vous êtes tués vous-mêmes, et on ne revient pas plus à la vie morale qu’à l’existence physique. Et, d’ailleurs, qu’y a-t-il entre les prêtres et Dieu ? Les prêtres sont à la morale ce que les charlatans sont à la médecine. Combien le Dieu de la nature est différent du Dieu des prêtres ! Il ne connaît rien de si ressemblant à l’athéisme que les religions qu’ils ont faites. A force de défigurer l’Être suprême, ils l’ont anéanti autant qu’il était en eux ; ils en ont fait tantôt un globe de feu, tantôt un bœuf, tantôt un arbre, tantôt un homme, tantôt un roi. Les prêtres ont créé Dieu à leur image : ils l’ont fait jaloux, capricieux, avide, cruel, implacable. Ils l’ont traité comme jadis les maires du palais traitèrent les descendants de Clovis, pour régner sous son nom et se mettre à sa place. Ils l’ont relégué dans le ciel comme dans un palais, et ne l’ont appelé sur la terre que pour demander à leur profit des dîmes, des richesses, des honneurs, des plaisirs et de la puissance. Le véritable prêtre de l’Être suprême, c’est la Nature ; son temple, l’univers ; son culte, la vertu ; ses fêtes, la joie d’un grand peuple rassemblé sous ses yeux pour resserrer les doux nœuds de la fraternité universelle, et pour lui présenter l’hommage des cœurs sensibles et purs. Prêtres, par quel titre avez-vous prouvé votre mission? Avez-vous été plus justes, plus modestes, plus amis de la vérité que les autres hommes ? Avez-vous chéri l’égalité, défendu les droits des peuples, abhorré le despotisme et abattu la tyrannie ? [...]
« Le patriote n'est autre chose qu'un homme probe et magnanime dans toute la force de ce terme. C'est peu d'anéantir les rois, il faut faire respecter à tous les peuples le caractère du peuple français. C'est en vain que nous porterions au bout de l'univers la renommée de nos armes, si toutes les passions déchirent impunément le sein de la patrie. Défions-nous de l'ivresse même des succès. Soyons terribles dans les revers, modestes dans nos triomphes, et fixons au milieu de nous la paix et le bonheur par la sagesse et par la morale. Voilà le véritable but de nos travaux ; voilà la tâche la plus héroïque et la plus difficile. Nous croyons concourir à ce but, en vous proposant le décret suivant.
Art. I. Le peuple français reconnaît l’existence de l’Etre suprême, et l’immortalité de l’âme.
II. Il reconnaît que le culte digne de l’Etre suprême est la pratique des devoirs de l’homme.
III. Il met au premier rang de ces devoir de détester la mauvaise foi et la tyrannie, de punir les tyrans et les traîtres, de secourir les malheureux, de respecter les faibles, de défendre les opprimés, de faire aux autre tout le bien qu’on peut, et de n’être injuste envers personne.
VI. La République française célèbrera tous les ans les fêtes du 14 juillet 1789, du 10 août 1792, du 21 janvier 1793, du 31 mai 1793.
VII. Elle célèbrera, aux jours des décadis, les fêtes dont l’énumération suit : A l’Etre suprême et à la Nature. Au Genre humain. Au Peuple français. Aux Bienfaiteurs de l’humanité. Aux Martyrs de la liberté. A la Liberté et à l’Egalité. A la République. A la Liberté du Monde. A l’amour de la Patrie. A la haine des Tyrans et des Traîtres. A la Vérité. A la Justice. A la Pudeur. A la Gloire et à l’Immortalité. A l’Amitié. A la Frugalité. Au Courage. A la Bonne foi. A l’Héroïsme. Au Désintéressement. Au Stoïcisme. A l’Amour. A la Foi conjugale. A l’Amour paternel. A la Tendresse maternelle. A la Piété filiale. A l’Enfance. A la Jeunesse. A l’Age viril. A la Vieillesse. Au Malheur. A l’Agriculture. A l’Industrie. A nos Ayeux. A la Postérité. Au Bonheur.
XI. La liberté des cultes est maintenue conformément au décret du 18 frimaire.
XII. Tout rassemblement aristocratique et contraire à l’ordre public sera réprimé.
XIII. En cas de troubles, dont un culte quelconque serait l’occasion ou le motif, ceux qui les exciteraient par des prédications fanatiques, ou par des insinuations contre-révolutionnaires ; ceux qui les provoqueraient par des violences injustes et gratuites seront également punis selon la rigueur des lois.
XV. Il sera célébré le 20 prairial prochain [8 juin] une fête nationale en l’honneur de l’Etre suprême. »
Accueilli avec enthousiasme par la Convention et la France entière, ce discours fut rapporté par de nombreux journaux, imprimé à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires et traduit dans toutes les langues. La Convention croula sous les félicitations. C’était bien elle qui était félicitée, plus encore que Robespierre qui n’avait été que son organe. Celle-ci, néanmoins, le porta à sa présidence le 4 juin, afin qu’il préside la première des fêtes qu’il avait si brillamment concouru à faire instaurer.
On le voit, toutes les fêtes décadaires étaient placées sous les auspices de l’Etre suprême, mais une seule, la première, Lui était spécialement dédiée. Cet ordre ne tenait pas du hasard. Les révolutionnaires sentaient la nécessité de rassurer le peuple sur leurs intentions en matière religieuse et de couper court à la propagande contre-révolutionnaire les présentant comme des athées, et la Révolution, comme l’Antéchrist. En pratique, les fêtes majestueuses et populaires qui eurent lieu partout en France le 20 prairial ressemblèrent en tous points aux fêtes de la Raison tant sur le plan du cérémonial que des discours. Ce ne furent rien moins que de grandes « messes » patriotiques, comme l’avait été, à Paris, la fête de la fédération du 14 juillet 1790 — que nous célébrons officiellement aujourd’hui.
En fait, il n’y eut jamais à proprement parler de « culte de l’Etre suprême », expression qui sous-entend une sorte de fanatisme religieux et permet à certains de présenter Robespierre comme le pontife de ce culte, quand ils ne lui prêtent pas la volonté plus absurde encore d’avoir voulu faire de ce culte la dernière étape avant l’instauration d’un culte de la personnalité, de la sienne en l’occurrence. Il ne devait y avoir dans l’année qu’une fête en l’honneur de l’Etre suprême. Cette fête, comme toutes les autres, devait être organisée et dirigée par des membres des autorités constituées locales, donc selon leurs talents et leur sensibilité. Il n’y avait ni texte sacré ni liturgie ni clergé. Le décret du 18 floréal n’instaurait donc pas une nouvelle religion, encore moins un « culte » fanatique, mais plutôt une forme de laïcité.
Quant à Robespierre, il fournit lui-même la preuve de son peu de fanatisme lorsque, le 15 mai (26 floréal), aux Jacobins, il répondit au jeune Marc-Antoine Jullien, dit Jullien de Paris, qui, suite au décret du 18 floréal, proposait de chasser de la République tous les athées :
« Il est des vérités qu’il faut présenter avec ménagement, telle cette vérité professée par Rousseau, qu’il faut bannir de la République tous ceux qui ne croient pas à la divinité. Ce principe cité dans l’adresse ne doit pas être adopté, ce serait inspiré trop de frayeur à une grande multitude d’imbéciles ou d’hommes corrompus. Je ne suis pas d’avis qu’on les poursuive tous, mais seulement ceux qui conspirent contre la liberté. Je crois qu’il faut laisser cette vérité dans les écrits de Rousseau, et ne pas la mettre en pratique. »
Certains ont prétendu que Robespierre fut à l’apogée de son pouvoir le 20 prairial. En réalité, il n’eut pas le lendemain de la fête plus de pouvoir qu’il n’en avait la veille ou les mois précédents. De la popularité, oui, mais pas de pouvoir concret. En fait, c’est à ce moment-là que les membres du Comité donnèrent libre cours à leurs divergences politiques (notamment sur la conduite de la guerre, sur l’application des lois de ventôse et de la Terreur) et à leurs animosités personnelles et que Robespierre perdit toute influence sur eux. En outre, dès le 15 juin (27 prairial), le Comité de sûreté générale, par l’entremise de Vadier, athée indécrottable, s’acharna à le tourner en ridicule avec l’insignifiante affaire Catherine Théot, avant de s’attacher à le rendre odieux en répandant de fausses rumeurs. (Buonarroti, un intime de Robespierre, qui retrouva Vadier en Belgique après la restauration, dit de lui : « Haïr les Nobles et se moquer de la religion, voilà toute la politique de Vadier. ») Le 1er juillet, Robespierre avait tellement de pouvoir que, dégoûté par les petites et criminelles manœuvres, il cessait de participer au Comité et ne parut même plus à la Convention avant le 8 thermidor (26 juillet). Dans l’intervalle, on ne le vit que cinq fois aux Jacobins (les 1er, 11, 14, 16 et 24 juillet). C’est à eux qu’il confia son désarroi le 1er juillet et leur indiqua qu’elle allait être sa conduite.
Le 8 thermidor, après près de quatre semaines d’absence, il se présentait à la Convention armé d’un discours mémorable. L’impression en fut décrétée. Mais ses ennemis (Vadier, Cambon, Panis, Amar) qu’il venait de dénoncer à demi mots se jetèrent dans la bataille et firent rapporter le décret, sous prétexte de soumettre son discours à l’examen des Comités. Robespierre avait perdu la première manche et ne devait pas remporter la revanche. Le lendemain, parmi les accusations contradictoires (Billaud-Varenne lui reprocha d’avoir protégé Danton, et Garnier (de l’Aube), d’être étouffé par son sang.) dont l’accablèrent ses ennemis pour l’empêcher de parler, Vadier rappela l’affaire Catherine Théot et l’attitude de Robespierre qui avait imposé en toute illégalité à Fouquier-Tinville de l’enterrer. Personne cependant ne critiqua le décret du 18 floréal. Billaud-Varenne déclara même : « Il a accusé le gouvernement d’avoir fait disparaître tous les monuments consacrés à l’Etre suprême ; eh bien ! apprenez que c’est par Couthon… ». Quelle qu’ait été cette affaire, cette déclaration indique que le gouvernement adhérait pleinement au décret du 18 floréal. Jamais d’ailleurs la Convention ne l’abrogea.
Et, s’il fallait encore une preuve que Robespierre n’imposa pas l’Etre suprême à la Convention et à la France, mais exprima alors le sentiment général, il suffirait de citer cette lettre de Lambert, représentant dans la Côte-d’Or et la Haute-Marne, qui, le 8 août (21 thermidor), de Dijon, écrivit à la Convention : « Le supplice de Robespierre et de ses complices doit faire absoudre l’Etre suprême dans l’esprit de tous ceux qui jusqu’alors avaient douté de son existence. »
La loi du 22 prairial an II
La loi du 22 prairial (10 juin 1794) sur la réorganisation du Tribunal révolutionnaire que Robespierre demanda à Couthon de rédiger et de présenter à la Convention et qu’il soutint est pour beaucoup d’historiens un mystère et pour tous ses détracteurs son plus grand crime. Elle ouvrit, dit-on, la période de la Grande Terreur. Il est pourtant facile de comprendre la raison d’être de cette loi et les effets que Robespierre pouvait légitimement en attendre, quoi qu’il fut déçu par son application. Il est tout aussi facile de montrer que les polémiques ne sont soutenables que par des omissions coupables et des apparences trompeuses.
Cette loi avait pour but d’accélérer les procédures du Tribunal révolutionnaire. Elle prévoyait, outre la nomination, l’augmentation du nombre des juges et des jurés, la division du Tribunal en plusieurs sections (articles 1, 2 et 3), et, sauf cas particuliers (art. 14 et 15), la suppression tant de l’interrogatoire préalable des accusés (art. 12) que de la comparution de témoins (art. 13). Tout devait se faire en public. Le jugement, la mort ou l’acquittement (art. 7), reposait entièrement sur la conscience des jurés patriotes (art. 8 et 16). Les défenseurs étaient de fait supprimés (art. 16). Les motifs passibles du Tribunal révolutionnaire étaient précisés (art. 5 et 6), de sorte que ne puissent y être déférés des prévenus passibles des tribunaux ordinaires (art. 20). Enfin, ne pouvaient déférer des prévenus au Tribunal que la Convention, les Comités de salut public et de sûreté générale, les représentants en mission et l’accusateur public (art. 10 et 11).
Il est évident que cette loi faisait partie d’un ensemble. La considérer isolément oblige à dénaturer le caractère et les intentions de ses promoteurs pour l’expliquer, du moins pour expliquer les interprétations fantaisiste des dispositions de la loi elle-même. En vérité, la loi du 22 prairial ne fut pas l’œuvre du seul Robespierre qui aurait perdu les pédales ; elle ne fut pas imaginée dans la panique, après les tentatives d’assassinat dont il avait été l’objet (la dernière, le 23 mai, celle de Cécile Renault, semble du reste avoir été une affaire montée de toute pièce par le Comité de sûreté générale) ; elle n’allongeait pas la liste des crimes passibles du Tribunal révolutionnaire ; elle n’avait pas non plus pour but d’atteindre quelques députés terroristes ou corrompus ; elle n’ouvrit pas la période de la Grande Terreur qui n’est d’ailleurs qu’une illusion d’optique ; elle ne plongea pas la France dans l’horreur absolu ; les abus qui eurent cependant lieu par la suite ne furent pas des conséquences de cette loi mais des conséquences de sa violation et du non respect d’autres dispositions. La loi du 22 prairial était intimement liée aux lois et décrets des 8, 13 et 23 ventôse et du 27 germinal et, de manière générale, à l’état d’esprit des révolutionnaires.
Pour ne pas tomber dans les explications simplistes et mensongères et éviter les affirmations aussi fausses que gratuites, dont l’objet est généralement d’accabler Robespierre, et pour prouver ce qui vient d’être dit, il faut donc connaître la genèse de cette loi et l’histoire avant et après son adoption.
Dès le 29 octobre 1793, à l’occasion du procès des Girondins, Audouin, au nom des Jacobins, avait demandé à la Convention « 1° de débarrasser le tribunal révolutionnaire des formes qui étouffent la conscience et empêchent la conviction ; 2° d’ajouter une loi qui donne aux jurés la faculté de déclarer qu’ils sont assez instruits ». Osselin avait aussitôt transformé en motion une partie de la pétition et la Convention avait décrété que les débats au Tribunal cesseraient dès que les jurés seraient en état de prononcer. Lorsque la rédaction du décret définitif fut présentée, Robespierre intervint sur la question du délai :
« La rédaction qui vous est proposée, dit-il, ne vous conduit pas au but que vous voulez atteindre ; votre but est d’empêcher qu’on ne rende interminables les procès des conspirateurs. Vous voulez qu’une prompte justice soit rendue au peuple, tout en faisant jouir les accusés de l’établissement bienfaisant des jurés. La rédaction d’Osselin est trop vague, elle laisse les choses dans l’état où elles sont. En voici une qui concilie les intérêts des accusés avec le salut de la patrie. Je propose de décréter qu’après trois jours de débats, le président du tribunal demandera aux jurés si leur conscience est assez éclairée ; s’ils répondent négativement, l’instruction du procès sera continuée jusqu’à ce qu’ils déclarent qu’ils sont en état de prononcer ».
Appuyée par Barère, cette proposition complémentaire avait été aussitôt adoptée.
Le 27 novembre suivant (7 frimaire), les représentants à Commune-Affranchie (Lyon), dont Collot-d’Herbois, avaient arrêté la création de la Commission révolutionnaire, en « considérant que l’exercice de la justice n’a besoin d’autre forme que l’expression de la volonté du peuple ; que cette volonté énergiquement manifestée doit être la conscience des juges [...] ».
Le 9 février (21 pluviôse), le Comité (Robespierre, Billaud-Varenne, Jeanbon St-André et C.-A. Prieur) avait noté, dans un arrêté à propos de l’habitude prise par les jurés de motiver leur opinion : « Cette manière nouvelle d’influencer les opinions, incompatible avec la célérité et la pureté des jugements, peut substituer insensiblement le pouvoir de la parole ou de l’intrigue à celui de la raison et à la voix de la conscience, rappelle que les jurés doivent se contenter de donner leur déclaration purement et simplement, conformément aux principes et à la loi, sans se livrer à aucune discussion. »
Les 26 février (8 ventôse) et 3 mars 1794 (13 ventôse), avec les lois de ventôse adoptées sur le rapport de Saint-Just, les biens des condamnés devaient être distribués aux indigents, aux sans-culottes, « selon le tableau que le Comité de sûreté générale lui en aura présenté et qui sera rendu public », de sorte qu’ils profitent de la Révolution et y soient plus que jamais attachés. Il fallait donc juger rapidement les suspects et éventuellement les condamner. La Convention avait donc voté dans la foulée, 13 mars (23 ventôse), la création de six Commissions populaires qui, établies à Paris, seraient chargées de juger les détenus. En conséquence, la Convention vota, le 16 avril (27 germinal), les mesures de police générale présentées par Saint-Just, d’après lesquelles tous les prévenus de conspiration devaient être transférés à Paris. C’était suspendre de fait tous les tribunaux révolutionnaires de province et donner un travail énorme à celui de Paris. Le 22 avril (3 floréal), le Comité de salut public (Collot-d’Herbois, Billaud-Varenne) arrêta : « Le décret du 27 germinal [16 avril] disposant que tous les prévenus de conspiration seront traduits, de tous les points de la République, au Tribunal révolutionnaire à Paris, et que des Commissions populaires seront établies pour le 15 floréal [4 mai], les opérations des Commissions révolutionnaires [de province] sont provisoirement suspendues. » On ne saurait dire plus clairement. (Pour être tout à fait exact, quelques tribunaux révolutionnaires furent maintenus ou rétablis en mai : celui d’Arras, jusqu’au 10 juillet, de Bordeaux, de Nîmes, de l’armée de la Moselle et, à l’Ouest, celui de Noirmoutier, de Laval-Vitré-Rennes et de l’armée de l’Ouest. La Commission d’Orange qui n’existait pas alors fut elle aussi établie en mai, le 10.)
Le 20 avril (1er floréal), la Convention, sur un rapport de Billaud-Varenne, décréta que les ennemis de la République seraient punis sans pitié. Le 8 mai (19 floréal), sur le rapport fait par Couthon au nom des Comités de salut public et de législation réunis, la Convention décréta encore que, en exécution de l’article premier de la loi du 27 germinal, tous les crimes contre-révolutionnaires, définis par les lois antérieures, seraient du ressort du Tribunal révolutionnaire de Paris, où qu’ils aient été commis dans la République.
Le 13 mai (24 floréal), conformément au décret du 23 ventôse (13 mars), les Comités de salut public et de sûreté générale réunis (Voulland, Billaud-Varenne, Robespierre, B. Barère, C.-A. Prieur, Couthon, Amar, Elie Lacoste, Louis (du Bas-Rhin), Dubarran, Jagot, Carnot et Vadier) arrêtèrent la création de la première Commission populaire chargée de juger les détenus, de trier d’un côté les patriotes incarcérés à libérer, d’un autre les suspects à déporter ou à envoyer au Tribunal. « Les membres de la Commission [...] ne perdront jamais de vue le salut de la patrie, qui leur est confié et qui doit être la règle suprême de leurs décisions. Ils vivront dans cet isolement salutaire qui concilie aux juges le respect et la confiance publique et qui est le plus sûr garant de l’intégrité des jugements. Ils repousseront toutes sollicitations et fuiront toutes les relations particulières qui peuvent influencer les consciences et affaiblir l’énergie des défenseurs de la liberté (Ecrit par Billaud-Varenne.) ». Une seconde Commission fut établie le lendemain. Chaque Commission populaire était composée de cinq membres. Trinchard, membre de la première Commission, et Laporte le jeune, membre de la seconde, étaient jurés au Tribunal révolutionnaire. Subleyras et Laviron, membres de la seconde Commission, furent nommés jurés le 22 prairial. Le 24 mai (5 prairial), le Comité (sans précision) arrêta que « le traitement des membres composant les deux Commissions populaires établies à Paris, sera le même que celui des juges du Tribunal révolutionnaire, et que les dépenses s’ordonnanceront de la même manière que pour ce tribunal ».
Par ailleurs, le Comité institua une Commission révolutionnaire à Orange le 10 mai (20 floréal). Avignon, Arles, Tarascon, Marseille, en un mot la Provence avait été le théâtre d’insurrections et de complots. Il était impossible de transférer à Paris les neuf à dix mille personnes qui attendaient leur jugement ni de faire déplacer le triple de témoins. Comme le tribunal révolutionnaire de Marseille n’existait plus en vertu de la loi du 27 germinal, le représentant Maignet avait réclamé l’établissement d’une Commission pour le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. L’arrêté autorisant cette Commission était écrit par Robespierre et signée par Collot-d’Herbois, Robespierre, Barère, Billaud-Varenne, Couthon. Le 18 mai (29 floréal), le Comité (Carnot, Billaud et Couthon) rédigea une instruction pour cette Commission. « La preuve requise pour la condamnation sont tous les renseignements de quelque nature qu’ils soient, qui peuvent convaincre un homme raisonnable et ami de la liberté. La règle des jugements est la conscience des juges éclairés par l’amour de la justice et de la patrie. Leur but est le salut public et la ruine des ennemis de la patrie. Les membres de la commission auront sans cesse les yeux fixés sur ce grand intérêt ; ils lui sacrifieront toutes les considérations particulières. Ils vivront dans cet isolement salutaire, qui est le plus sûr garant de l’intégrité des juges et qui, par cela même, leur concilie la confiance et le respect. Ils repousseront toutes sollicitations dangereuses. » Cette instruction était manifestement inspirée par le fonctionnement des Commissions populaires et inspira à son tour les articles 8 et 16 du décret du 22 prairial. (Sur 591 prévenus, environ 300 furent condamnés à mort, une centaine, à de la réclusion ou à des amendes, et près de 200 furent acquittés.)
Le 22 mai (3 prairial), le Comité (Robespierre) donna aux Commissions populaires séantes au Muséum tous les moyens pour enquêter.
« Elles feront paraître devant elles les prévenus, lorsqu’elles le jugeront nécessaire. Elles pourront appeler des citoyens pour en prendre des renseignements, soit sur les faits, soit sur les individus. Cette faculté s’étendra jusqu’aux fonctionnaires publics, notamment les membres des Comités révolutionnaires ou de surveillance, et ce, de toutes les parties de la République, sauf à user de cette faculté avec la plus grande réserve. Les papiers que l’on saura exister dans tel endroit, et même dans les Comités de la Convention, pourront être demandés. Lorsque les Commissions découvriront dans l’examen d’une affaire de nouveaux coupables, elles auront le droit de lancer un mandat d’arrêt, en prévenant le Comité de salut public dans les vingt-quatre heures après l’arrestation. Elles auront le droit de mandat d’amener contre les citoyens non fonctionnaires publics qui, étant appelés pour donner des renseignements, ne se rendraient pas. »
Les Commissions commencèrent à produire des listes de personnes à libérer, déporter ou envoyer au Tribunal à partir du 7 juin (19 prairial). (En tout, elles dressèrent 124 listes : 97 de personnes à envoyer au Tribunal révolutionnaire, 15 de personnes à déporter et au moins 4, mais probablement 12, de personnes à libérer. Toutes les pièces relatives aux listes de libération ont disparu ou ont été détruites. Seuls subsistent deux messages des Commissions aux Comités qui en mentionnent 4 (3 + 1).)
Trois jour plus tard (un hasard ?), le 22 prairial (10 juin), Couthon présenta à la Convention la fameuse loi qui n’était finalement que la synthèse de dispositions antérieures. Comme quelques députés firent des objections, Robespierre intervint pour qu’elle soit discutée article par article, ce qui fut fait. Ruamps qui le premier s’était élevé contre cette loi et avait prétendu qu’il se brûlerait la cervelle si elle était adoptée n’en fit rien et avoua même, le 6 germinal an III, qu’à cette époque il conspirait déjà contre Robespierre. Les conspirateurs cherchaient alors à l’obliger à se défendre d’intentions qu’il n’avait pas pour que la Convention, à force d’entendre les mêmes accusations infondées, finisse par douter de lui et craindre pour elle-même. Il reste toujours quelque chose de la calomnie. Ainsi, le lendemain, en l’absence des membres du Comité, Bourdon (de l’Oise), appuyé par Bernard (de Saintes), réclama un décret additionnel pour assurer les députés qu’ils ne pourraient être poursuivis que par la Convention, comme si le Comité avait voulu changer les choses en la matière. Merlin (de Douai) intervint et la Convention, « considérant que le droit exclusif de la représentation nationale de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre au jugement est un droit indéniable », décréta qu’il n’y avait pas lieu à délibérer.
Mais, le lendemain, les membres du Comité protestèrent contre le considérant lui-même. Couthon estimant qu’il injuriait le Comité réclama son retrait, sous les applaudissements. Bourdon (de l’Oise) balbutia de plates excuses. Robespierre intervint. « Ce n’est pas par des rétractations éternelles et peut-être concertées ; ce n’est pas par des discours qui, sous les apparences de l’accord et du patriotisme, concourent toujours au système si souvent interrompu et si souvent repris de diviser la représentation nationale, que l’on peut justifier ces démarches. Ce qu’à dit Couthon est resté dans toute sa force, et il est bien démontré qu’il n’y avait pas lieu aux plaintes qui ont été faites. » Appuyé par Billaud-Varenne et Barère, le considérant fut rapporté. C’était la dernière « victoire » de Robespierre et sa dernière intervention à la Convention avant le 8 thermidor.
La loi du 22 prairial était désormais en vigueur. Pour autant, les listes des Commissions populaires ne furent pas transmises au Comité, pour approbation, ni au Tribunal révolutionnaire, pour application des sentences. Les quatre autres Commissions prévues n’étaient toujours pas établies. Les lois de ventôse en faveur des pauvres rencontraient une sourde obstruction tant au sein du Comité de salut public que du Comité de sûreté générale qui devait dresser le tableau des indigents. C’était là le fond de la querelle entre Robespierre et les membres des Comités.
A cela s’ajoutaient néanmoins les différends politiques, les rivalités de personnes et les questions d’autorité. Carnot, Lindet et Prieur (de la Côte d’Or) aspiraient à une politique bourgeoise. Carnot était en outre favorable à la guerre de conquête, tandis que Robespierre désirait mettre fin à la guerre une fois le territoire national libéré et la République à l’abri. Carnot s’était également heurté à Saint-Just et au frère de Robespierre sur des questions stratégiques. (Ce dernier avait proposé pour l’armée d’Italie un plan conçu par Bonaparte, que celui-ci appliqua avec succès en 1796 et que Carnot rejeta alors.) Moins claires sont les raisons de la rupture de Collot-d’Herbois (le compère de Fouché à Lyon) et de Billaud-Varenne avec Robespierre, et encore moins celles du louvoyant Barère (dont Robespierre admirait la puissance de travail mais n’appréciait pas les « carmagnoles », ses rapports pompeux sur les victoires françaises). Les membres éminents du Comité de sûreté générale, eux, ne supportaient plus l’ascendant du Comité de salut public et celui de Robespierre en particulier ; ils avaient en travers l’Etre suprême et ils n’acceptaient pas la création du Bureau de police générale au sein du Comité de salut public. (Ce Bureau, vu par le Comité de sûreté générale comme un concurrent, avait été créé par décret le 26 germinal pour surveiller les personnes publiques. Il fut d’abord dirigé par Saint-Just, puis, en son absence, par Robespierre ou Couthon. Ses arrêtés, environ 460 — concernant des arrestations, des transferts, des destitutions, des nominations, etc. —, devaient cependant recevoir l’aval du Comité et, de fait, tous les membres accordèrent des signatures. Seules six personnes arrêtées sur ses ordres furent exécutées.)
Pendant ce temps, le Tribunal révolutionnaire tournait à plein régime. Avec la loi du 27 germinal qui supprimait les tribunaux de province, le nombre d’exécutions avait logiquement triplé à Paris, par rapport aux décades précédentes ; mais il avait encore doublé depuis le 22 prairial. La simplification des procédures n’expliquait pas tout. Les prévenus étaient désormais envoyés par dizaines au Tribunal révolutionnaire et les « fournées » qui avaient été exceptionnelles avant étaient maintenant l’ordinaire. Cette pratique odieuse n’était pas prescrite par la loi du 22 prairial, mais l’opinion publique habilement manipulée ne pouvait que lui en attribuer la cause et, partant, en accuser Robespierre. Le summum fut atteint avec la fournée dite « des chemises rouges », le 17 juin (29 prairial). Le Comité de sûreté générale et Fouquier-Tinville étaient derrière la manœuvre.
Contre le premier, Robespierre ne pouvait rien dans l’immédiat. En revanche, il essaya de faire destituer Fouquier. Le 26 juin (8 messidor), Herman, robespierriste, ex-président du Tribunal révolutionnaire, commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, adressa ce mot à Desvieux, président du tribunal du 3ème arrondissement : « Je te crois bon patriote et éclairé ; je m’adresse à toi pour que, dans ta conscience républicaine, tu m’indiques un citoïen propre à remplir les fonctions d’accusateur public, que le Comité de Salut public m’a chargé de rechercher. Prompte réponse. Salut et fraternité. » Robespierre n’obtint pas satisfaction. Le 29 juin, il se heurta violemment à ses collègues du Comité qui le traitèrent de dictateur. A partir du 1er juillet, il ne parut plus au Comité. Il exposa les raisons de son retrait le soir même aux Jacobins :
« Quand le crime conspire dans l’ombre la ruine de la liberté, est-il pour des hommes libres, des moyens plus forts que la vérité et la publicité ? Irons-nous, comme les conspirateurs, concerter dans des repaires obscurs, les moyens de nous défendre contre leurs efforts perfides ? Irons-nous répandre l’or et semer la corruption ? En un mot, nous servirons-nous contre nos ennemis des mêmes armes qu’ils emploient pour nous combattre ? Non. Les armes de la liberté et de la tyrannie sont aussi différentes, que la liberté et la tyrannie sont opposées. Contre les scélératesses des tyrans et de leurs amis, il ne nous reste d’autre ressource que la vérité, et le tribunal de l’opinion publique, et d’autre appui que les gens de bien. »
L’absence de celui que la France et l’Europe voyaient, à tort, comme le chef de la Révolution et de la République finit par s’ébruiter et par inquiéter. D’autant plus que Robespierre dénonçait aux Jacobins ses ennemis, leurs manœuvres, leurs calomnies et les excès de la Terreur. Les membres des Comités sentirent la nécessité de se réconcilier avec lui. Pour gage de leur sincérité, ils ratifièrent enfin les listes dressées par les Commissions populaires. La première, cumulant 36 listes portant sur 150 détenus à envoyer au Tribunal révolutionnaire, fut ratifiée le 20 juillet (2 thermidor). Ils la lui firent porter chez lui. Il la signa à son tour. Ils en ratifièrent deux autres le lendemain. Une cumulait 66 petites listes et portait sur 313 détenus à envoyer au Tribunal révolutionnaire ; l’autre cumulait 14 listes portant sur 47 détenus à déporter. Le 22 juillet (4 thermidor), les Comités arrêtèrent la création des quatre dernières Commissions populaires. Le lendemain, Robespierre assistait à la séance des Comités. Mais il ne crut pas en leur bonne foi. Deux jours plus tard, il portait ses plaintes à la Convention et, deux jours après, sa tête à l’échafaud.
Ainsi, la loi du 22 prairial an II ne fut pas un caprice ou un délire de Robespierre. Elle n’avait pas été conçue à la hâte ; elle faisait partie d’un tout. De ce fait, il est possible que Couthon et Robespierre l’aient rédigée et présentée à la Convention sans en informer leurs collègues du Comité de salut public, mais rien dans cette loi n’était nouveau ni dans la forme ni dans l’esprit, rien ne pouvait les choquer eux qui, tous, un mois plus tôt, avaient cautionné l’établissement de la Commission d’Orange qui en était le modèle. En outre, les Commissions populaires dont l’établissement avait été décrété dans le cadre des lois de ventôse, qui devaient mâcher le travail du Tribunal révolutionnaire et qui commençaient à fonctionner permettaient d’accélérer les procédures dudit Tribunal. Quant au Comité de sûreté générale, si ses membres furent vexés de ne pas avoir été prévenus de la présentation de cette loi, ce n’est certes pas son contenu qui pouvait les émouvoir.
Deux documents prouvent jusqu’à l’évidence ces affirmations. Le 13 juillet, de Tulle, Roux-Fazillac, représentant dans la Corrèze et le Puy-de-Dôme, consulta le Comité pour savoir s’il devait envoyer au Tribunal révolutionnaire des accusés prévenus de complicité d’émigration, de conduite incivique ou de propos contre-révolutionnaires. « La marche du tribunal [local] se trouve barrée par le décret du 22 prairial, qui veut que les ennemis du peuple soient jugés par le Tribunal révolutionnaire et qui prohibe aux autorités constituées d’y envoyer ceux qui peuvent être dans cette classe, sans avoir obtenu l’autorisation des Comités de salut public et de sûreté générale. Je vous ai déjà demandé, citoyens collègues, si les commissions populaires, décrétées par la Convention, seraient mises en activité, et si le décret du 22 prairial y suppléait. » Le 23 juillet, le Comité (sans autre précision) lui répondit : « Les lois du 19 floréal [8 mai] et 22 prairial déterminent si précisément les crimes dont la connaissance est exclusivement attribuée au Tribunal révolutionnaire, qu’il n’est pas possible d’élever un doute sur ce point. C’est à lui qu’il appartient, suivant l’article 10 de cette dernière loi, d’y traduire ceux dont le crime est désigné comme attentatoire à la liberté du peuple et à la marche de la Révolution. Quant aux autorités constituées, l’article 11 exige qu’elles en préviennent les Comités de salut public et de sûreté générale, et qu’elles obtiennent leur autorisation. Nous nous reposons d’ailleurs sur ta sagacité et ton amour pour la chose publique. Jusqu’à ce que les Commissions populaires soient en pleine activité dans toute la République, il n’y a pas d’autre marche à suivre que celle qui est prescrite par les lois des 27 germinal [16 avril, sur les mesures de police générale], 19 floréal [8 mai, précision sur la loi du 27 germinal] et 22 prairial. »
Les détracteurs de Robespierre qui ne s’embarrassent guère de la logique, des faits et de preuves ont prétendu que cette loi élargissait à l’infini les crimes passibles du Tribunal révolutionnaire ce qui, selon eux, serait la cause de l’augmentation considérable des exécutions. Autrement dit, la loi du 22 prairial était plus vague que la loi précédemment en vigueur. Or la loi en vigueur était toujours celle du 17 septembre 1793 qui définissait ainsi les suspects :
« Sont réputés gens suspects : 1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté ; 2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par la loi du 21 mars, de leurs moyens d’exister et de l’acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu de la loi du 14 août dernier ; 5° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœur, et agents d’émigrés qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution ; 6° ceux qui ont émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789 à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu’ils soient rentrés en France dans le délai fixé par cette loi, ou précédemment. »
La loi du 22 prairial définissait les suspects dans l’article 6 :
« Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre ; Ceux qui auront trahi la République dans le commandement des places et des armées, ou dans toute autre fonction militaire, entretenu des intelligences avec les ennemis de la République, travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées ; Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou à causer la disette dans la République ; Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l’impunité des conspirateurs et de l’aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes de la révolution, des lois ou des mesures du gouvernement, par des applications fausses et perfides ; Ceux qui auront trompé le peuple ou les représentants du peuple, pour les induire à des démarches contraires aux intérêts de la liberté ; Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la République ; Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple ; Ceux qui auront cherché à égarer l’opinion et à empêcher l’instruction du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, et altérer l’énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination ; Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République ; Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple ; Enfin, tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes relatives à la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par quelques moyens que ce soit et de quelques dehors qu’ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l’unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l’affermissement. »
La longueur de cette définition atteste à elle seule la plus grande précision de la loi du 22 prairial an II comparée à celle du 17 septembre 1793. La liste des crimes passibles du Tribunal révolutionnaire, dictée par l’expérience, se voulait aussi exhaustive que possible. Elle était moins concise pour qu’il y ait moins d’abus. Qu’il y ait eu des abus ne signifie pas que la loi les ait provoqués et que Robespierre en ait été responsable, d’autant plus que nous savons qu’ils furent le fait de ses ennemis.
Les admirateurs de Robespierre, en revanche, ont prétendu que la loi du 22 prairial, dans l’esprit des robespierristes, ne devait servir qu’à atteindre une poignée de députés terroristes ou corrompus. Ils citent à l’appui la déclaration que fit Couthon aux Jacobins, le 6 thermidor : « la vertu et l’énergie de la Convention nationale peuvent écraser à volonté les cinq ou six petites figures humaines dont les mains sont pleines des richesses de la République et dégoûtantes du sang des innocents qu’ils ont immolés ». Cette déclaration ne prouve pas leur assertion, tandis que la connaissance de la Révolution montre qu’une loi pour saisir quelque députés était inutile (des députés avaient déjà été arrêtés et exécutés). Du reste, la loi avait à l’évidence une portée générale ; elle n’était pas faite pour viser cinq ou six personnes. En somme, cette thèse suppose que les robespierristes avaient mal calculé leur coup et furent inconséquents dans cette affaire, ce qui est à la fois insultant pour eux et tout aussi loin de la vérité que les thèses de leurs détracteurs.
On a reproché à cette loi, donc à Robespierre, de violer toutes les règles de la justice en supprimant les interrogatoires préalables, les témoins et les défenseurs. Mais, outre qu’il ne s’agissait pas là de justice ordinaire mais de justice révolutionnaire, que supprimait réellement cette loi comparé au fonctionnement antérieur du Tribunal ? Seulement des illusions entraînant des lourdeurs. Les interrogatoires préalables étaient inconsistants. Les témoins, quand il y en avait ne prouvaient rien. Quant aux défenseurs, il était de notoriété publique qu’ils escroquaient leurs clients. D’où l’article 16 : « La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés, des jurés patriotes ; elle n’en accorde point aux conspirateurs. » Tous les révolutionnaires étaient depuis longtemps dans cet état d’esprit. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les détenus devaient être jugés par les Commissions populaires qui, elles, avaient reçu de Robespierre lui-même les moyens d’enquêter, d’interroger prévenus et témoins.
Les détracteurs de Robespierre s’acharnent à prétendre que la loi du 22 prairial ouvrit le règne de la Grande Terreur et s’indignent de l’explosion du nombre des exécutions. Ils feignent d’oublier que la loi du 27 germinal avait supprimé les tribunaux révolutionnaires de province et que, de ce fait, la plupart des exécutions avaient lieu depuis à Paris, de sorte que la Terreur à Paris doit être rapportée à la France. Ainsi le nombre d’exécutions augmenta à Paris, non avec la loi du 22 prairial, mais dès la fin germinal (même s’il est vrai qu’il augmenta encore après le 22 prairial), parce qu’elles avaient quasiment cessé partout ailleurs. Au niveau national, le nombre d’exécutions ne se maintint pas, il chuta en raison de la difficulté d’envoyer à Paris tous les suspects. Ainsi, loin d’inaugurer une Grande Terreur, les lois des 27 germinal et 22 prairial an II mirent quasiment fin à la Terreur. Si le but des révolutionnaires, et de Robespierre en particulier, avait été de plonger la France dans la Terreur et les abus, ils auraient couvert la France de tribunaux. Ils firent l’inverse. Il y avait des tribunaux partout ; ils n’en laissèrent subsister qu’un, à Paris. Que peut en déduire le bon sens sur leurs intentions ? Auraient-ils procédé autrement s’ils avaient voulu réduire la Terreur, la contrôler et se donner les moyens de l’arrêter le moment venu ?
Si l’on veut néanmoins parler de Grande Terreur à Paris, l’honnêteté commande d’en dater le début au 27 germinal, et non au 22 prairial (On sait pourquoi seule cette deuxième date retient l’attention de certains.) et de signaler qu’environ 60 % des condamnés étaient des provinciaux, ce qui permet de relativiser la terreur qu’éprouvèrent les Parisiens.
On ne saurait cependant parler de la Terreur à Paris sans avancer de chiffres. La représentation du nombre des exécutions sous forme de graphique permet de distinguer 5 phases.
1) d’avril 1793 (le Tribunal révolutionnaire avait été institué le 10 mars 1793, mais les premières exécutions eurent lieu en avril) au 20 octobre = 20 décades.
- 93 exécutions (dont 74 provinciaux, soit 79,5 %), soit 4,65 / décade
- 210 libérations
- 50 peines autres que la mort
2) du 21 octobre 1793 au 20 février 1794 (2 ventôse an II) = 12 décades
- 271 exécutions (dont 134 provinciaux, soit 49,4 %), soit 22,58 / décade
- 299 libérations
- 99 peines autres que la mort
3) du 21 février au 10 avril (21 germinal an II) = 5 décades
- 198 exécutions (dont 115 provinciaux, soit 58 %), soit 39,6 / décade
- 105 libérations
- 18 peines autres que la mort
Total des trois premières périodes, d’avril 1793 au 10 avril 1794 = 37 décades :
- 562 exécutions (dont 323 provinciaux, soit 57,47 %), soit 15,2 / décade
- 614 libérations
- 167 peines autres que la mort
4) du 11 avril (22 germinal) au 10 juin (22 prairial an II) = 6 décades
- 713 exécutions (dont 432 provinciaux, soit 60,6 %), soit 118,8 / décade
- 296 libérations
- 62 peines autres que la mort
5) du 11 juin au 29 juillet (9 thermidor an II) = 5 décades
- 1364 exécutions (dont 809 provinciaux, soit 59,3 %), soit 272,8 / décade
- 308 libérations
- 29 peines autres que la mort
Total pour la Terreur à Paris, d’avril 1793 au 9 thermidor an II
- 2639 exécutions (dont 1564 provinciaux, soit 1075 Parisiens sur 600.000)
- 1218 libérations
- 258 autres peines que la mort
Ces chiffres, rigoureusement exacts, tirés des archives du Tribunal révolutionnaire, confirment que si Grande Terreur il y eut à Paris, elle commença avec la loi du 27 germinal, puisqu’il y eut dans les six décades qui suivirent plus d’exécutions que durant les 37 qui précédèrent. Ils montrent en outre que, contrairement aux impressions que laissent les récits des anciens suspects, les Parisiens n’eurent finalement pas grand chose à craindre de la Terreur qui fit moins de 0,2 % de victimes parmi eux, que cette période fut loin d’être pour eux la plus terrible de l’histoire. En 1871, par exemple, les Versaillais en fusillèrent sans jugement autour de 20.000 en une semaine. A l’échelle de la France, les historiens estiment à environ à 17.000 le nombre d’exécutions, et à 40.000 le nombre de victimes de la Terreur en comptant les exécutions sommaires et les décès en prison, soit 0,15 % d’une population qui comptait 26 millions d’âmes, ou encore l’équivalent d’une bataille napoléonienne. (N’entrent pas dans ces chiffres les morts de la guerre à l’Ouest.)
Les concerts d’indignation ont donc quelque chose d’exagéré et de partial. Malgré des abus certains, les révolutionnaires ne furent pas des sanguinaires. La République aux abois ne pouvaient pas être sauvée sans verser de sang, mais les chiffres montrent qu’ils n’en versèrent pas tant que cela. Même le Tribunal révolutionnaire de Paris, présenté comme un tribunal de sang, acquitta près d’un tiers des prévenus. Les acquittements furent moins nombreux après le 27 germinal et surtout après le 22 prairial, mais il y en eut quand même plus de 600. La proportion des condamnations fut logiquement plus élevée durant cette période puisque furent déférées au Tribunal et souvent envoyées de loin les personnes les plus notoirement contre-révolutionnaires.
Ceci explique sans doute pourquoi Robespierre ne s’éleva pas contre les exécutions, en définitive peu nombreuses, mais contre les arrestations abusives, c’est-à-dire la manière aveugle et criminelle de certains d’exercer la Terreur.
« Est-ce nous qui avons plongé dans les cachots les patriotes, et porté la terreur dans toutes les conditions ? Ce sont les monstres que nous avons accusés. Est-ce nous qui, oubliant les crimes de l’aristocratie et protégeant les traîtres, avons déclaré la guerre aux citoyens paisibles, érigé en crimes ou des préjugés incurables ou des choses indifférentes, pour trouver partout des coupables et rendre la révolution redoutable au peuple même ? Ce sont les monstres que nous avons accusés. Est-ce nous qui, recherchant des opinions anciennes, fruit de l’obsession des traîtres, avons promené le glaive sur la plus grande partie de la Convention nationale, et qui demandions dans les sociétés populaires la tête de six cents représentants du peuple ? Ce sont les monstres que nous avons accusés. » (8 thermidor)
Enfin, l’idée que la loi du 22 prairial instaura la Grande Terreur fait dire à certains que les députés tremblaient, comme s’ils avaient désormais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bouloiseau écrit à ce propos : « Tant de sièges vides hantaient les députés qui se demandaient quand viendrait leur tour ! ». Cette phrase semble vouloir dire que beaucoup de députés avaient été exécutés et que le restant craignait que Robespierre ne les élimine aussi grâce à la loi de prairial. Ceci n’a tout bonnement aucun sens.
Tout d’abord, Robespierre n’était pas plus maître des verdicts du Tribunal révolutionnaire qu’il n’était libre d’y envoyer qui il voulait. Il ne put même pas y traduire ses ennemis déclarés qui, pour la plupart, étaient des ordures notoires. (Après le 9 thermidor, Vadier déclara que « le comité de sûreté générale avait tout fait en faveur de Tallien, Fouché et autres, pour détourner l’effet des dénonciations portées contre eux, par la raison qu’ils étaient poursuivis par Robespierre. ») Il appartenait d’ailleurs toujours à la Convention d’y traduire ses membres.
Ensuite, que représentaient les places vides ? Aucun député ne fut arrêté durant la « Grande Terreur ». Osselin fut bien exécuté le 26 juin 1794 (et ce fut le seul député dans ce cas), mais il avait été arrêté en novembre 1793. Furent également exécutés les 19 et 25 juin, mais à Bordeaux, les Girondins fugitifs Guadet, Salle et Barbaroux (Buzot et Pétion s’étant suicidés). Manquaient donc les Girondins exécutés ou hors la loi, ceux incarcérés que Robespierre avait seul défendus, les Indulgents (qui, à l’exception de Desmoulins et Philippeaux, ne furent pas réhabilités par la Convention thermidorienne), quelques fripons condamnés par la Convention, et surtout les représentants en mission (plus d’une soixantaine) ou en congé ou décédés naturellement ou morts au combat ou assassinés. Excepté les amis de Danton, rares étaient donc les députés qui pouvaient voir dans les places vides des raisons de craindre pour eux-mêmes !
Quelques députés furent cependant effrayés à cette époque, non par cette loi, mais par les insinuations des ennemis de Robespierre et les fausses listes de proscription mises en circulation par Fouché. Encore ces manœuvres eurent-elles moins d’effet que prévu, puisque les comploteurs qui avaient si mauvaise réputation durent encore négocier dans la nuit du 8 au 9 thermidor le soutien de la Plaine pour la journée du lendemain, preuve que la Plaine participa moins au 9 thermidor par crainte que par intérêt politique. Pourquoi d’ailleurs, avec ou sans la loi du 22 prairial, les députés de la Plaine auraient-ils redouté Robespierre, lui qui professait un respect sans borne pour la Convention et avait pour ennemis personnels tous ceux qui la déshonoraient ? La loi du 22 prairial ne faisait qu’accélérer les procédures du Tribunal révolutionnaire ; l’important, pour un député, était donc de ne pas être décrété d’arrestation, ce qui ne pouvait se faire sans l’aval de la Convention. Or, de ce point de vue, la Plaine avait bien plus à craindre des ennemis de Robespierre qui avaient pour eux le nombre que de Robespierre lui-même qui n’avait que son prestige à opposer et qui était le plus en danger. Révolutionnaire éminent, il ne pouvait être atteint qu’après un long travail de sape auquel ses ennemis s’employèrent sans relâche durant des mois.
Finalement, Robespierre et ses amis furent les seuls députés exécutés selon la loi du 22 prairial qui fut abrogée le 14 thermidor an II (1er août) sur l’intervention de Lecointre (de Versailles).
La fin d’un « tyran »
« Le 9 thermidor, lasse de la dictature de Robespierre, de ses excès et de la Terreur, la Convention décrète Robespierre d’arrestation. » Telle est généralement la façon dont l’événement est présenté et expliqué dans le même temps. Robespierre fut arrêté et exécuté, logique, parce que c’était un tyran. L’affaire est entendue. Mais, comme dit un jour Cambacérès à Napoléon, « cela a été un procès jugé, mais non plaidé ». En effet, à y regarder de plus près, cette présentation n’est ni un résumé ni un raccourci mais une falsification des faits, un mensonge éhonté.
Cette explication suppose la pureté des intentions de la Convention, puisqu’elle renversa une tyrannie. Mais qui furent réellement les acteurs de l’événement ? qui étaient les ennemis de Robespierre ?
Au premier rang, Fouché, le futur ministre de la police de Napoléon, le suppôt de tous les régimes. Robespierre ne lui pardonnait pas les mitraillades de Lyon et l’oppression des patriotes lyonnais. Vadier, Amar, Jagot, Dubarran, les hommes du Comité de sûreté général, prêts à envoyer n’importe qui au Tribunal révolutionnaire pourvu que cela leur permette de nuire à Robespierre. Carnot, l’homme de la guerre de conquête, quand Robespierre voulait la paix dès que possible. Il était considéré par les Robespierristes comme leur plus grand ennemi. Tallien, outrancier et vénal de notoriété publique. Les compères de Marseille, Fréron, le futur leader de la Jeunesse dorée, méprisé de tous, et Barras, futur homme clé du régime le plus pourri que la France ait connu, à savoir le Directoire. Bernard (de Saintes), l’escroc, l’ennemi de Robespierre jeune qui distinguait l’erreur du crime et avait libéré ceux qu’il avait arrêtés dans le Jura. André Dumont, le tartuffe, futur proscripteur de ses collègues. Bourdon (de l’Oise), à propos du quel Robespierre avait écrit qu’il « s’est couvert de crimes en Vendée, où il s’est donné le plaisir, dans ses orgies avec le traître Tunck, de tuer des volontaires de sa main. Il joint la perfidie à la fureur… Cet homme se promène avec l’air d’un assassin qui médite un crime. Il semble poursuivi par l’image de l’échafaud et des Furies. » Les amis de Danton, aussi pourris que lui : Legendre, Guffroy, Courtois, Garnier (de l’Aube) qui tous persécuteront les Jacobins et les anciens membres des Comités. D’autres pourris tels que le ci-devant Rovère, coupable de concussion efferéne dans le Midi. Voilà quels étaient les ennemis personnels de Robespierre ; c’était la lie de la Convention.
Quant à la masse des députés de la Convention, la Plaine ou le Marais, c’est selon, elle était composée de bourgeois qui n’avaient soutenus la Montagne qu’en raison des circonstances, pour faire face au péril. Elle ne partageait pas l’idéal social, démocratique et égalitaire des Jacobins et de Robespierre dans lequel elle avait cependant trouvé un protecteur face à tous les furieux de caractère ou de posture. Elle était fondamentalement girondine, capitalo-libérale et accessoirement républicaine. Le Directoire lui convint, et l’Empire plus encore. Pour l’heure, elle était prise entre Robespierre et les Jacobins d’un côté, les terroristes et les pourris de l’autre. Arbitre de la situation, elle avait le choix entre soutenir les premiers et leur politique sociale contre les seconds qu’elle craignait et détestait, ou soutenir les seconds contre les premiers qui ne la menaçaient pas physiquement mais avec lesquels elle était fondamentalement, politiquement et économiquement en désaccord. En définitive, elle préféra s’entendre avec les pourris qu’écouter l’Incorruptible. Elle savait que ce dernier était l’âme de la Révolution et sentit qu’en l’éliminant elle n’aurait plus grand chose à craindre des excités.
Ces derniers, en présentant Robespierre comme un tyran, en lui reprochant leurs propres excès, en associant robespierrisme et terrorisme, firent de toute mesure de rigueur (de la part des révolutionnaires) et de toute revendication sociale un crime ; ils fournirent eux-mêmes à tous les contre-révolutionnaires le prétexte de dénoncer la Révolution et l’occasion de sortir impunément de l’ombre ; bref, ils provoquèrent une réaction inattendue qui balaya les plus sincères d’entre eux, les autres ayant aussitôt retourné leur veste. Ainsi, pour assouvir leurs intérêts particuliers ou leurs rancunes, ils compromirent l’intérêt général. Robespierre avait depuis longtemps signalé le danger de s’écarter de sa ligne. Ce n’est pas par vanité qu’il considérait ses ennemis personnels comme ceux de la Révolution. La suite lui donna raison, et nombre de ceux qui s’étaient acharnés à sa perte le reconnurent et exprimèrent des remords. Rien ne saurait être plus révélateur que ce mot de Cambon, chargé des finances, que Robespierre avait attaqué personnellement le 8 thermidor : « Nous avons tué la République au 9 thermidor, en croyant ne tuer que Robespierre ! Je servis à mon insu les passions de quelques scélérats. Que n’ai-je péri, ce jour-là, avec eux ! la liberté vivrait encore ! »
« Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. » Telle fut exactement la tactique utilisée par les Thermidoriens pour éliminer Robespierre et étouffer son souvenir. Il fut accusé de tout, chargé de tous les crimes, calomnié comme rarement quelqu’un l’a été. Mais le temps a passé et les passions devraient se calmer. Il n’est plus possible aujourd’hui de soutenir que Robespierre fut un dictateur, que la Terreur fut son œuvre, qu’il fut responsable de tous les excès et qu’il tyrannisa la Convention.
Ce qu’il avait dit des Montagnards, face aux Girondins, le 28 octobre 1792, était encore vrai le concernant le 8 thermidor an II : « Ils nous accusent de marcher à la dictature, nous, qui n'avons ni armée, ni trésor, ni places, ni parti ; nous, qui sommes intraitables comme la vérité, inflexibles, uniformes, j'ai presque dit insupportables, comme les principes ». C’est cette rigueur morale, cette impossibilité de l’attaquer honnêtement, cette capacité intrinsèque à froisser les amours propres qui lui attira sans doute les plus profondes haines. Il avait fait de la vérité son arme ; il ne laissait à ses adversaires que le mensonge pour l’atteindre. De fait, tout ce qu’il dénonçait était vrai ; toutes les vilenies dont il fut accusé étaient fausses. Ainsi, tout dans son discours du 8 thermidor, qu’il appela lui-même son testament de mort, est rigoureusement exact, qu’il s’agisse de ses positions ou des manœuvres de ses ennemis. Rien n’a jamais été démenti, malgré les diversions. Il suffit donc de lire ce discours pour savoir qui il était, ce qu’il voulait, à quoi il était confronté, qui étaient ses ennemis, ce qu’ils firent, et de juger entre lui et eux.
« Ils m'appellent tyran… Si je l'étais, ils ramperaient à mes pieds, je les gorgerais d'or, je leur assurerais le droit de commettre tous les crimes, et ils seraient reconnaissants. Si je l'étais, les rois que nous avons vaincus, loin de me dénoncer (quel tendre intérêt ils prennent à notre liberté !) me prêteraient leur coupable appui ; je transigerais avec eux. Dans leur détresse, qu'attendent-ils, si ce n'est le secours d'une faction protégée par eux, qui leur vende la gloire et la liberté de notre pays ? On arrive à la tyrannie par le secours des fripons ; où courent ceux qui les combattent ? Au tombeau et à l'immortalité. Quel est le tyran qui me protège ? Quelle est la faction à qui j'appartiens ? C'est vous-mêmes. Quelle est cette faction qui, depuis le commencement de la révolution, a terrassé les factions, a fait disparaître tant de traîtres accrédités ? C'est vous, c'est le peuple, ce sont les principes. Voilà la faction à laquelle je suis voué, et contre laquelle tous les crimes sont ligués. [...] Qui osera jamais servir la patrie, quand je suis obligé encore ici de répondre à de telles calomnies ? Ils citent comme la preuve d'un dessein ambitieux les effets les plus naturels du civisme et de la liberté ; l'influence morale des anciens athlètes de la révolution est aujourd'hui assimilée par eux à la tyrannie. Vous êtes, vous-mêmes, les plus lâches de tous les tyrans, vous qui calomniez la puissance de la vérité ! Que prétendez-vous, vous qui voulez que la vérité soit sans force dans la bouche des représentants du peuple français ? La vérité, sans doute, a sa puissance ; elle a sa colère, son despotisme ; elle a des accents touchants, terribles, qui retentissent avec force dans les cœurs purs, comme dans les consciences coupables, et qu'il n'est pas plus donné au mensonge d'imiter qu'à Salmonée d'imiter les foudres du ciel ; mais accusez-en la nature, accusez-en le peuple qui le sent et qui l'aime. »
« Comment pourrais-je ou raconter ou deviner toutes les espèces d’impostures qui ont été clandestinement insinuées, soit dans la Convention nationale, soit ailleurs, pour me rendre odieux ou redoutable ? Je me bornerai à dire que, depuis plus de six semaines, la nature et la force de la calomnie, l’impuissance de faire le bien et d’arrêter le mal, m’a forcé à abandonner absolument mes fonctions de membre du Comité de salut public, et je jure qu’en cela même je n’ai consulté que ma raison et ma patrie. Je préfère ma qualité de représentant du peuple à celle de membre du Comité du salut public, et je mets ma qualité d’homme et de citoyen français avant tout. [...] »
« On s'est attaché particulièrement à prouver que le tribunal révolutionnaire était un tribunal de sang, créé par moi seul et que je maîtrisais absolument pour faire égorger tous les gens de bien, et même tous les fripons ; car on voulait me susciter des ennemis de tous les genres. Ce cri retentissait dans toutes les prisons ; ce plan de proscription était exécuté à la fois dans tous les départements par les émissaires de la tyrannie. Ce n'est pas tout ; on a proposé dans ces derniers temps des projets de finance qui m'ont paru calculés pour désoler les citoyens peu fortunés et pour multiplier les mécontents. J'avais souvent appelé inutilement l'attention du Comité de salut public sur cet objet. Eh bien ! croirait-on qu'on a répandu le bruit qu'ils étaient encore mon ouvrage, et que, pour l'accréditer, on a imaginé de dire qu'il existait au Comité de salut public une commission des finances, et que j'en étais le président ? Mais comme on voulait me perdre, surtout dans l'opinion de la Convention nationale, on prétendit que moi seul avais osé croire qu'elle pouvait renfermer dans son sein quelques hommes indignes d'elle. On dit à chaque député revenu d'une mission dans les départements que moi seul avais provoqué son rappel ; je fus accusé par des hommes très officieux et très insinuants de tout le bien et de tout le mal qui avait été fait. On rapportait fidèlement à mes collègues, et tout ce que j'avais dit, et surtout ce que je n'avais pas dit. On écartait avec soin le soupçon qu'on eût contribué à un acte qui pût déplaire à quelqu'un ; j'avais tout fait, tout exigé, tout commandé ; car il ne faut pas oublier mon titre de dictateur. Quand on eut formé cet orage de haines, de vengeances, de terreurs, d'amours-propres irrités, on crut qu'il était temps d'éclater. Ceux qui croyaient avoir des raisons de me redouter se flattaient hautement que ma perte certaine allait assurer leur salut et leur triomphe ; tandis que les papiers anglais et allemands annonçaient mon arrestation, des colporteurs de journaux la criaient à Paris. Mes collègues devant qui je parle, savent le reste beaucoup mieux que moi ; ils connaissent toutes les tentatives qu'on a faites auprès d'eux pour préparer le succès d'un roman qui paraissait une nouvelle édition de celui de Louvet. Plusieurs pourraient rendre compte des visites imprévues qui leur ont été rendues pour les disposer à me proscrire. Enfin, on assure que l'on était prévenu généralement dans la Convention nationale qu'un acte d'accusation allait être porté contre moi ; on a sondé les esprits à ce sujet, et tout prouve que la probité de la Convention nationale a forcé les calomniateurs à abandonner ou du moins à ajourner leur crime. »
« Tous les fripons m'outragent ; les actions les plus indifférentes, les plus légitimes de la part des autres, sont des crimes pour moi. Un homme est calomnié dès qu'il me connaît. On pardonne à d'autres leurs forfaits ; on me fait un crime de mon zèle. [...] Je ne sais pas respecter les fripons : j'adopte bien moins encore cette maxime royale, qu'il est utile de les employer ; les armes de la liberté ne doivent être touchées que par des mains pures. Epurons la surveillance nationale, au lieu d'en pallier les vices. La vérité n'est un écueil que pour les gouvernements corrompus ; elle est l'appui du nôtre. »
« On veut détruire le gouvernement révolutionnaire, pour immoler la patrie aux scélérats qui la déchirent, et on marche à ce but odieux par deux routes différentes. Ici on calomnie ouvertement les institutions révolutionnaires, là on cherche à les rendre odieuses par des excès ; on tourmente les hommes nuls ou paisibles ; on plonge chaque jour les patriotes dans les cachots, et on favorise l'aristocratie de tout son pouvoir ; c'est là ce qu'on appelle indulgence, humanité. Est-ce là le gouvernement révolutionnaire que nous avons institué et défendu ? Non, ce gouvernement est la marche rapide et sûre de la justice, c'est la foudre lancée par la main de la liberté contre le crime ; ce n'est pas le despotisme des fripons et de l'aristocratie ; ce n'est pas l'indépendance du crime, de toutes les lois divines et humaines. Sans le gouvernement révolutionnaire, la République ne peut s'affermir, et les factions l'étoufferont dans son berceau ; mais s'il tombe en des mains perfides, il devient lui-même l'instrument de la contre-révolution. »
« Si l'on proposait ici de prononcer une amnistie en faveur des députés perfides, et de mettre les crimes de tout représentant sous la sauvegarde d'un décret, la rougeur couvrirait le front de chacun de nous : mais laisser sur la tête des représentants fidèles le devoir de dénoncer les crimes, et cependant, d'un autre côté, les livrer à la rage d'une ligue insolente, s'ils osent le remplir, n'est-ce pas un désordre encore plus révoltant ? C'est plus que protéger le crime, c'est lui immoler la vertu. »
Dans ce discours magnifique, Robespierre dévoilait tous les scandales, toutes les manœuvres de ses ennemis ; il rappelait ses positions modérées que, du reste, nul n’ignorait. Il mettait les révolutionnaires en garde à la fois contre le danger pour la Révolution de ne pas mettre eux-mêmes un terme aux excès et contre celui de le laisser seul les dénoncer. Il ne fut pas entendu. Passions, peurs et intérêts se mêlèrent pour l’immoler et, avec lui, la Révolution.
Rares sont les historiens qui ont relevé et senti l’importance d’une phrase qu’il avait écrite en juin ou juillet 1793 (après l'adoption de la constitution) dans son carnet et qu’il ratura aussitôt : « Quand leur intérêt [celui des riches] sera-t-il confondu avec celui du peuple ? Jamais. » Robespierre avait énoncé là une vérité qui lui apparut comme une impasse et qu'il raya comme pour la chasser de son esprit et ne pas se décourager lui-même. Inconsciemment, accidentellement, il avait mis le doigt sur le problème fondamental de la Révolution. Riches, pauvres : ces notions n’ont de sens que dans un système monétaire. Dans ce système, tout gravite autour de Largent, tout est façonné par lui. Qui ne court pas après est rattrapé par lui. Dans ce système, l’inégalité en fortune, et, partant, en droits, est une fatalité ; il y aura toujours des riches et des pauvres sous Largent. Jamais les « citoyens » ne seront donc égaux en droits dans un tel système, jamais les intérêts des individus composant la « société » ne seront confondus. Constat indéniable et inacceptable pour Robespierre, le champion de l’Egalité. Robespierre savait néanmoins que son rêve, dans ce monde-là, dans ce système-là, mais il n’en concevait pas d’autre, était une chimère ; il savait au fond de lui, même sans se l’avouer, que la Révolution était vouée à l’échec, qu’elle tournerait fatalement au profit des riches, au profit de l’aristocratie de Largent. L’Histoire l’a confirmé. Mais cette réflexion demeure la leçon essentielle de ce grand révolutionnaire pour les révolutionnaires futurs : l’Egalité, la Révolution sont une vue de l’esprit sous Largent (3). C’est donc Largent lui-même qu’il faut abattre, sous peine de tourner en rond. Robespierre qui était d’une logique implacable n’était pas parvenu à cette conclusion et, y serait-il parvenu, qu’il n’aurait rien pu faire. Mais ceci est une autre histoire.
Plongé dans l’action, Robespierre avait fait tout ce qui était au pouvoir d’un homme de bien, d’un homme honnête, raisonnable et généreux. Il n’était pas dans sa nature de baisser les bras. Il relevait les défis. Il finit néanmoins par désespérer. Les difficultés sans cesse renouvelées, des ennemis toujours plus nombreux, il sentait qu’au-delà des hommes une force mystérieuse s’opposait à la Révolution et l’emporterait. Sa confiance n’était plus que de façade. Alors, à disparaître, autant le faire avec panache. Tel était le sens de son discours du 8 thermidor.
Le 9 thermidor, il se débattit comme un diable à la Convention, par instinct de conservation. Mais la foi n’y était plus. L’insurrection spontanée de la Commune à l’annonce de son arrestation le surpris mais ne le ranima pas. Libéré, disposant des moyens d’écraser ses ennemis, il n’en fit rien. Il suivit ses partisans qui s’étaient levés, prêts à donner leur vie pour lui et pour la cause, mais la cause était perdue. Une victoire ce jour-là n’aurait rien changé. Il temporisa, tergiversa et se tua. Presque. Il avait la mâchoire fracassée quand il fut repris.
Le 10 thermidor, il fut exécuté avec 21 de ses partisans et amis. Les deux jours suivants, 82 municipaux, administrateurs de police, cadres de la garde nationale et Robespierristes divers furent exécutés. La Commune était anéantie. La Révolution, au sens social du terme (mais en a-t-elle un autre ?), était terminée.
Philippe Landeux
Janvier 2011
TEMOIGNAGES POSTHUMES DE CONTEMPORAINS
De son vivant, Robespierre reçut d’innombrables lettres qui attestent son patriotisme, son humanité, sa sagesse, sa douceur, sa générosité et sa popularité. Il est cependant facile de les présenter pour de la flagornerie même lorsqu’elles sont totalement désintéressées. Les témoignages en sa faveur en un temps où il était impératif d’exécrer sa mémoire sont déjà plus difficiles à contester, et carrément impossible lorsqu’ils émanent d’hommes qui concoururent à sa perte et qui démentent les légendes qu’ils fabriquèrent eux-mêmes.
Barras qui, dans la nuit du 9 au 10 thermidor, commandait les troupes de la Convention, laissa des mémoires dans lesquelles il rétablit la vérité sur Robespierre et donc sur ses ennemis :
« Robespierre se prononça contre les pillards, contre les fournisseurs, contre les échafauds. Il voulut arrêter ces exécutions, il s’opposa à l’arrestation de plusieurs députés, de grand nombre de citoyens recommandables, il fit hommage à la divinité, il parla clémence, il périt pour le retour aux principes de justice. » Il écrit ailleurs : « Toujours prompt à voler au secours des vainqueurs et à se déchaîner contre les vaincus, Barère, au nom des Comités, présenta un rapport aussi cruel que mensonger contre Robespierre ; il se déchaîna avec fureur contre ceux qui ne pouvaient plus se défendre : il eût même l’impudence d’accuser Robespierre d’avoir voulu rétablir le fils de Louis XVI sur le trône, et d’avoir, pour son propre compte, projeter d’épouser Madame, fille de ce monarque (aujourd’hui Mme la duchesse d’Angoulême). » Il déclara en outre à Alexandre Dumas qui le rapporta dans ses mémoires : « Je n’ai que deux regrets, je devrais dire deux remords, et ce seront les seuls qui seront assis à mon chevet le jour où je mourrai : j’ai le double remords d’avoir renversé Robespierre et élevé Bonaparte par le 13 vendémiaire. »
Barère avoua en 1832 :
« Depuis j’ai réfléchi sur cet homme ; j’ai vu que son idée dominante était l’établissement du gouvernement républicain, qu’il poursuivait en effet des hommes dont l’opposition entravait les rouages de ce gouvernement. Plût au ciel qu’il se trouvât actuellement dans la chambre des députés quelqu’un qui signalât ceux qui conspirent contre la liberté ! Nous étions alors sur un champ de bataille ; nous n’avons pas compris cet homme. [...] N’oubliez pas Robespierre ! C’était un homme pur, intègre, un vrai républicain. Ce qui l’a perdu, c’est sa vanité, son irascible susceptibilité, et son injuste défiance envers ses collègues... Ce fut un grand malheur ! »
Billaud-Varenne, membre du Comité de salut public, un des principaux adversaires de Robespierre le 9 thermidor, fut lui-même attaqué peu après et prépara un mémoire pour sa défense, dans lequel il rendit malgré lui hommage à Robespierre :
« Sous quels rapports eût-il pu paraître coupable ? S'il n'eût pas manifesté l'intention de frapper, de dissoudre, d'exterminer la représentation nationale, si l'on n'eût pas eu à lui reprocher jusqu'à sa popularité même... popularité si énorme qu'elle eût suffi pour le rendre suspect et trop dangereux dans un État libre, en un mot s'il ne se fût point créé une puissance monstrueuse tout aussi indépendante du comité de Salut public que de la Convention nationale elle-même, Robespierre ne se serait pas montré sous les traits odieux de la tyrannie, et tout ami de la liberté lui eût conservé son estime. » « Nous demandera-t-on, comme on l'a déjà fait, pourquoi nous avons laissé prendre tant d'empire à Robespierre ? Oublie-t-on que dès l'Assemblée constituante, il jouissait déjà d'une immense popularité et qu'il obtint le titre d'Incorruptible ? Oublie-t-on, que pendant l'Assemblée législative sa popularité ne fit que s'accroître...? Oublie-t-on que, dans la Convention nationale, Robespierre se trouva bientôt le seul qui, fixant sur sa personne tous les regards, acquittant de confiance qu'elle le rendit prépondérant, de sorte que lorsqu'il est arrivé au comité de Salut public, il était déjà l'être le plus important de la France ? Si l'on me demandait comment il avait réussi à prendre tant d'ascendant sur l'opinion publique, je répondrais que c'est en affichant les vertus les plus austères, le dévouement le plus absolu, les principes les plus purs. »
Banni de France et établi à Haïti, il se confia au docteur Chervin qui écrivit à son sujet : « La conversation de Billaud était riche de souvenirs nets et précis ; ses idées étaient originales, souvent bizarres, et quelques fois grandes et justes. Ses sentiments et ses opinions politiques n’avaient fléchi ni sur les hommes ni sur les choses, si ce n’est sur quelques points seulement. Par exemple, il avait changé d’opinion sur le 9 thermidor, qu’il appelait sa déplorable faute à lui, et il ajoutait : “Nous nous sommes bien trompés ce jour-là ! Nous avons recommencé, après cette journée, tous les chapîtres de la réaction anglaise ; on nous a infligé, comme on l’a fait à la mort de Cromwel, un système qui, sous l’apparence de la modération, nous a désignés comme des types de monstres, comme des loups à figure humaine, bons tout au plus à égorger. Ce système nous a conduits, à travers d’affreuses et implacables vengeances, des palinodies plus lâches encore, à la disette, la banqueroute, la vile banqueroute et les évènements du 1er prairial, à des torrents de sang patriote et pur !”
« “Oui, c’est au 14 germinal, date de la condamnation de Danton, et au 9 thermidor, que les patriotes on fait les deux fautes qui ont tout perdu. Nos divisions ont brisé ces jours-là l’unité du système révolutionnaire ; vous avez vu aussitôt l’influence revenir à des misérables, écartés pour vol, enfin à tous les fripons, les briseurs (des scellés), les oligarques, les royalistes. Les amis de Tallien ne s’endormirent pas : ils avaient vendu notre cause, et nous firent dénoncer par Lecointre, qu’ils proscrivirent ensuite avec nous, par Saladin et Goupilleau, qui avaient été nos séides, et qui offrirent nos têtes aux royalistes et à l’Europe. Nous étions pour les royalistes de lâches stupides, bien que nos actes fussent là ; bien que tout rayonnant de l’éclat terrible de notre dictature et de nos batailles. Ainsi nous, pauvres jacobins, nous qui avions châtié l’orgueil des rois, nous ne fûmes vaincus que par nos fautes et nos frères ; alors, nous fûmes jetés par eux aux flots de la mer en fureur, triste concession de l’ambition, de la cupidité et surtout de la peur.”
« “Je le répète : la Révolution puritaine a été perdue le 9 thermidor ; depuis, combien de fois j’ai déploré d’y avoir agi de colère ! Pourquoi ne laisse-t-on pas ces intempestives passions et toutes les vulgaires inquiétudes aux portes du pouvoir ? J’ai vu la réaction qui fit naître le 9 thermidor, c’était affreux ; la calomnie venait de partout. Cela dégoûte bien des révolutions. Nous, au moins, nous nous défendîmes avec dignité. Duhem leur tenait tête tous les jours. Les amis qui les secondaient étaient Lejeune, Fayau, Chasles, Goujon, Ruhl, etc., etc. Mais quelle tâche ! et puis nous avons disparu ! Mais l’ébauche révolutionnaire étaient sortie de nos mains et elle resta comme pierre tumulaire de l’ancien régime et plus forte que tous les partis réunis !”
« Hélas ! disait-il souvent, j’y ai trempé trop directement et avec une haine affreuse. Le malheur des révolutions, c’est qu’il faut agir trop vite; vous n’avez pas le temps d’examiner; vous n’agissez qu’en pleine et brûlante fièvre, sous l’effroi de ne pas agir; sous l’effroi, je m’entends, de voir avorter vos idées. Danton et ses amis étaient d’habiles gens, des patriotes invincibles à la tribune ou dans l’action publique, et nous les avons massacrés ! Ils n’avaient pas, comme nous, excepté le brave Westermann, le Murat de la République, les mains pures de trafics et de rapines; ils aimaient trop le luxe, mais ils avaient le cœur noble et révolutionnaire ; vous saurez leurs services un jour, quand on fera l’histoire sincère de notre époque. Celle de M. Lacretelle n’est qu’une œuvre sans faits, une œuvre fardée de rhéteur. Je reste avec la conviction intime qu’il n’y avait pas de 18 brumaire possible, si Danton, Robespierre et Camille fussent restés unis aux pieds de la tribune. »
Vadier retouva Baudot en exil. Ce dernier rapporta que « le seul acte qu’il [Vadier] se reprochait, était d’avoir pris un citoyen [Robespierre] pour un tyran. »
Sous le Directoire, Reubell confia à Carnot : « Je n'ai jamais eu qu'un reproche à faire à Robespierre, c'est d'avoir été trop doux. »
Choudieu qui, en l’an II, avait passé la plupart de son temps aux armées et qui y était encore le 9 thermidor écrivit dans ses mémoires :
« Robespierre est celui de tous les montagnards qui a été le plus exposé à des accusations de tout genre. Ses ennemis l’ont présenté comme un ambitieux sans talent. Il suffit de lire ses différents discours pour se convaincre combien il était supérieur à tous ceux qui l’accusèrent et qui n’ont pu le vaincre qu’en l’assassinant. Je n’aimais pas Robespierre parce qu’il n’était pas aimable, mais ce n’est pas une raison pour être injuste envers lui et pour me joindre à ses ennemis lorsqu’il n’est plus. Quant à son ambition, elle ne m’a paru jamais bien démontrée et je n’ai pu voir en lui pendant toute sa carrière politique qu’un républicain, trop austère peut-être, mais qui voulait sincèrement le triomphe de la liberté. [...] On aurait tort de croire que les hommes de cette coalition étaient dirigés par des vues d’humanité. Deux mobiles puissants les excitaient : la crainte d’expier eux-mêmes leurs forfaits sur l’échafaud et le désir de venger leurs amis. Et la preuve de ce que j’avance ici se voit dans leur conduite ultérieure. Après le 9 thermidor, ils continuèrent en effet le système de proscription auquel ils n’avaient jamais cessé de prendre part... »
Levasseur (de la Sarthe) qui, le 19 mars 1794, avait été dépêché par Robespierre dans la Seine-et-Oise pour réprimer les abus sans pour autant faire preuve de faiblesse, écrivit dans ses mémoires :
« [...] Les deux premières pièces [Lettres de Cadillot et de Jullien fils] que je viens de citer démontrent, je pense, jusqu’à la dernière évidence, qu’à Robespierre et à la partie du Comité de Salut public et de la Montagne qui votait avec lui ne doivent pas être attribuées les fureurs de quelques proconsuls qui ont souillé les fastes glorieux de la République. La dernière prouve aussi qu’au milieu d’une anarchie nécessaire les hommes de tête et de cœur songeaient à jeter les fondements d’un régime heureux et tranquille, mais assis sur l’égalité la plus complète, sur la liberté la plus absolue. “Pour fonder la république, il faut la faire aimer”, disait souvent Saint-Just. Il ne voulait donc ni l’avilir, ni l’ensanglanter. [...] Certains actes ont été cependant l’ouvrage de Robespierre et de ses adhérents. Tous étaient inflexibles, quand ils croyaient voir compromis le salut de la cause sainte. Aucun ne reculait devant les conséquences de ses principes, quelque déplorables qu’ils pussent être transitoirement et quelques actes douloureux qu’ils pussent entraîner. Ainsi ils ont frappé les chefs de la Gironde, les députés constituants qui rêvaient de la Constitution de 1791, et les fougueux compagnons d’Hébert et les amis corrompus de Danton. Mais de ces vengeances légales dont la nécessité leur semblait démontrée, aux sanglants holocaustes qui effrayèrent la France, il y a une distance immense ; il y a toute la distance d’un jugement qui frappe le crime, à l’assassinat qui déchire l’innocence au milieu de sa famille. La différence qui existait entre Robespierre, Saint-Just et un Carrier, un Collot, un Le Bon était celle qui sépare le magistrat juste, mais inflexible, d’un bourreau teint du sang qu’on l’a payé pour répandre.
« Robespierre et la Montagne excitaient, dit-on, aux excès. D’où vient qu’ils se sont séparés des vils et stupides démagogues de la Commune ? Robespierre et la Montagne brûlaient de répandre le sang. D’où vient qu’ils ont sévi contre un Vincent, un Ronsin et tant d’autres monstres sanguinaires ? D’où vient qu’à la tête des ennemis qui les ont renversés se sont placés les Collot-d’Herbois, les Billaud-Varenne, les Carrier, tous les hommes de meurtre, tous les tigres à face humaine de cette triste et glorieuse époque ? [...] »
Le docteur Souberbielle, juré au tribunal révolutionnaire, à la fois ami de Danton et intime de Robespierre :
« Pendant le procès de Danton, avec lequel j’étais très lié, je n’osai le regarder. J’étais décidé à le condamner, car j’avais la preuve certaine qu’il méditait le renversement de la République. Au contraire, j’aurais donné ma vie pour sauver Robespierre, que j’aimais comme un frère. Personne ne savait mieux que moi combien son dévouement à la République était sincère, désintéressé, absolu. Il a été le bouc émissaire de la Révolution ; mais il valait mieux qu’eux tous. »
Napoléon Bonaparte, Mémorail de Sainte-Hélène :
« Robespierre, disait Napoléon en présence de Gourgaud et de Mme de Montholon, a été culbuté parce qu'il voulait devenir modérateur et arrêter la Révolution. Cambacérès m'a raconté que, la veille de sa mort, il avait prononcé un magnifique discours qui n'avait jamais été imprimé. Billaud et d'autres terroristes, voyant qu'il faiblissait et qu'il ferait infailliblement tomber leurs têtes, se liguèrent contre lui et excitèrent les honnêtes gens soi-disant, à renverser le "tyran", mais en réalité pour prendre sa place et faire régner la terreur de plus belle. Le peuple de Paris, en jetant Robespierre à bas, croyait détruire la tyrannie, tandis que ce n'était que pour la faire refleurir plus que jamais. Mais, une fois Robespierre par terre, l'explosion fut telle que, quelque tentative qu'ils aient faite, les terroristes ne purent jamais reprendre le dessus. ». « Robespierre était incorruptible et incapable de voter ou de causer la mort de quelqu'un par inimitié personnelle ou par désir de s'enrichir. C'était un enthousiaste, mais il croyait agir selon la justice, et il ne laissa pas un sou à sa mort. Il avait plus de pitié et de conception qu'on ne pensait, et après avoir renversé les factions effrénées qu'il avait eu à combattre, son intention était de revenir à l'ordre et à la modération. On lui imputa tous les crimes commis par Hébert, Collot d'Herbois et autres. C'étaient des hommes plus affreux et plus sanguinaires que lui, qui le firent périr ; ils ont tout rejeté sur lui ». Selon Las Cases, Napoléon le pensait « le vrai bouc émissaire de la révolution, immolé dès qu'il avait voulu entreprendre de l'arrêter dans sa course (...). Ils [terroristes et thermidoriens] ont tout jeté sur Robespierre ; mais celui-ci leur répondait, avant de périr, qu'il était étranger aux dernières exécutions ; que, depuis six semaines, il n'avait pas paru aux comités. Napoléon confessait qu'à l'armée de Nice, il avait vu de longues lettres de lui à son frère, blâmant les horreurs des commissaires conventionnels qui perdaient, disait-il, la révolution par leur tyrannie et leurs atrocités, etc., etc. »
Nodier qui avait traversé la Révolution écrivit en 1829 dans la Revue de Paris :
« La nouvelle du 9 thermidor, parvenue dans les départements de l’Est, développa un vague sentiment d’inquiétude parmi les républicains exaltés, qui ne comprenaient pas le secret de ces événements, et qui craignaient de voir tomber ce grand œuvre de la Révolution avec la renommée prestigieuse de son héros, car derrière cette réputation d’incorruptible vertu qu’un fanatisme incroyable lui avait faite, il ne restait plus un seul élément de popularité universelle auquel les doctrines flottante de l’époque pussent se rattacher. Hélas ! se disait-on à mi-voix, qu’allons-nous devenir ? Nos malheurs ne sont pas finis puisqu’il nous reste encore des amis et des parents et que MM. Robespierre sont morts ! Et cette crainte n’était pas sans motif, car le parti de Robespierre venait d’être immolé par le parti de la Terreur. »
Détenu sous la Terreur, le royaliste Beaulieu écrivit un essai sur les causes et les effets de la Révolution. Le volume publié en 1808 commence par ces pages :
« On a vu dans le cours de cet ouvrage, que ceux qui firent la révolution du 9 thermidor, étaient fort loin d’être à l’abri des reproches dont ils chargeaient la mémoire de Robespierre. Ce n’était point immédiatement celui qu’on venait d’immoler, mais Collot-d’Herbois qui avait porté le ravage dans la ville de Lyon ; ce n’était point immédiatement Robespierre, mais M. Barrère qui avait faire rendre les épouvantables décrets qui devaient métamorphoser en ruines nos plus belles, nos plus opulentes cités ; et MM. Barrère et Collot-d’Herbois se joignirent à ceux qui ont écrasé Robespierre ; ils le proclamèrent tyran. Ce ne fut point Robespierre qui imagina de faire de la France une nation de sauvages, sans religion et sans foi ; on a vu qu’au contraire il prit le parti des prêtres, qu’une secte d’athées, suivant l’expression de Clootz, voulait septembriser, d’un bout de la France à l’autre.
Une chose qui a été sue de tout le monde, c’est que, six semaines avant la révolution du 9 thermidor, Robespierre ne paraissait plus aux comités ; et c’est à cette époque que les arrestations furent plus multipliées, et les exécutions plus épouvantables. On dira que le génie de cet homme affreux continuait d’y dominer par la présence de deux personnages qui lui étaient restés fidèles, MM. Couthon et Saint-Just. Mais comment pouvait-il se faire que des hommes qui faisaient trembler l’Europe entière, fussent forcés par la terreur d’un absent, les propos d’un paralytique, et d’un polisson aussi près de l’enfance que de l’âge viril, à rester les ministres d’un système d’horreurs dont l’imagination ne peut se faire une idée ?
Quoi qu’il en soit, il reste pour constant que les plus grandes violences depuis le commencement de l'année 1794, ont été provoquées par ceux-là mêmes qui ont écrasé Robespierre. Uniquement occupés, dans nos prisons, à rechercher dans les discours qu'on prononçait, soit aux Jacobins soit à la Convention, quels étaient les hommes qui nous laissaient quelque espoir, nous y voyions que tout ce qu'on disait était désolant, mais que Robespierre paraissait encore le moins outré.
Après l’exécution de Chaumette et autres, M. Tallien proposa de donner une nouvelle activité aux mesures contre les suspects. [Erreur. Référence à la séance du 21 mars, ou celle du 14 mars, qui, dans tous les cas, eut lieu avant l’exécution de Chaumette, le 13 avril, et même avant cette d’Hébert, le 24 mars.] Robespierre l’interrompit, et lui déclara que ce n’était point les suspects qu’il fallait craindre, qu’il y avait des hommes autrement dangereux ; et le persécuteur des suspects garda le silence. Les recueils du temps sont remplis de preuves de ce que j’avance ici : je ne les rapporterai pas, pour ne pas trop charger cet ouvrage ; il est facile de les consulter.
Aussi, si après le 9 thermidor l’opinion ne se fût pas prononcé d’une manière irrésistible, si quelques députés repentans de leurs fautes, ou moins coupables que leurs collègues, ne se fussent pas déterminés à faire cesser la tyrannie qui nous accablait, il est certain qu’on eût continué le système de destruction dont on a voulu supposer que Robespierre était l’unique directeur, ou au moins qu’on l’eût essayé.
A peine ce malheureux, à qui l’on a voulu faire jouer le rôle du bouc d’Israël, est-il immolé, que les déclamations contre tous ceux qui n’appartiennent pas à la secte des Jacobins, recommencent avec une nouvelle fureur. M. Barrère tonne contre les prétendus contre-révolutionnaires avec la même violence qu’auparavant, et leur déclare qu’il ne faut pas qu’ils s’imaginent que la victoire remportée contre Robespierre sera leur triomphe ; et les malheureux attendent encore la mort dans leurs tristes retraites. »
Babeuf, le futur organisateur de la conspiration dite des égaux, qui était incarcéré au moment du 9 thermidor, écrivit à Joseph Bodsonl e 28 février 1796 (9 ventôse An IV) :
« Mon opinion n’a jamais changé sur les principes, mais elle a changé sur quelques hommes. Je confesse aujourd’hui de bonne foi, que je m’en veux d’avoir vu autrefois en noir et le gouvernement révolutionnaire, et Robespierre, et Saint-Just, etc. Je crois que ces hommes valaient mieux à eux seuls que tous les révolutionnaires ensemble, et que leur gouvernement dictatorial était diablement bien imaginé. Tout ce qui s’est passé depuis que ni les hommes ni le gouvernement ne sont plus, justifie assez bien l’assertion. Je ne suis pas du tout d’accord avec toi qu’ils ont commis de grands crimes et bien fait périr des républicains. Pas tant, je crois : c’est la réaction thermidorienne qui en a fait périr beaucoup.
Je n’entre pas dans l’examen si Hébert et Chaumette étaient innocents. Quand cela serait, je justifie encore Robespierre. Ce dernier pouvait avoir à bon droit l’orgueil d’être le seul capable de conduire à son vrai but le char de la Révolution.
Des brouillons, des hommes à demi-moyens, selon lui, et peut-être aussi selon la réalité ; de tels hommes, dis-je, avides de gloire et remplis de présomption, tels qu’un Chaumette, peuvent avoir été aperçus par notre Robespierre avec la volonté de lui disputer la direction du char. Alors celui qui avait l’initiative, celui qui avait le sentiment de sa capacité exclusive, a dû voir que tous ces ridicules rivaux, même avec de bonnes intentions, entraveraient, gâteraient tout. Je suppose qu’il eût dit : “Jetons sous l’éteignoir ces farfadets importuns et leurs bonnes intentions”, mon opinion est qu’il fit bien.
Le salut de 25 millions d’hommes ne doit point être balancé contre le ménagement envers quelques individus équivoques. Un Régénérateur doit voir en grand. Il doit faucher tout ce qui le gêne, tout ce qui obstrue son passage, tout ce qui peut nuire à sa prompte arrivée au terme qu’il s’est prescrit. Fripons, ou imbéciles, ou présomptueux et ambitieux de gloire, c’est égal, tant pis pour eux ! Pourquoi s'y trouvent-ils ? Robespierre savait tout cela, et c’est en partie ce qui me le fait admirer. C’est ce qui me fait voir en lui le génie où résidaient de véritables idées régénératrices. Il est vrai que ces idées-là pouvaient entraîner toi et moi. Qu’est-ce que cela faisait si le bonheur commun fut venu au bout ?
Je ne sais, mon ami, si avec ces explications-là il peut encore être permis aux hommes de bonne foi comme toi de rester hébertistes.
L’hébertisme est une affection étroite dans cette classe d’hommes. Elle ne leur fait voir que le souvenir de quelques individus, et le point essentiel des grandes destinées de la République leur échappe.
Je ne crois pas encore avec toi impolitique, ni superflu, d’évoquer la cendre et les principes de Robespierre et de Saint-Just pour étayer notre doctrine. D’abord nous ne faisons que rendre hommage à une grande vérité sans laquelle nous serions trop au-dessous d’une équitable modestie. Cette vérité-là est que nous ne sommes que les seconds Gacques de la Révolution française.
N’est-il pas encore utile de démontrer que nous n’innovons rien, que nous ne faisons que succéder à de premiers généreux défenseurs du peuple qui, avant nous, avaient marqué le même but de justice et de bonheur auquel le peuple doit atteindre ? et en second lieu, réveiller Robespierre, c’est réveiller tous les patriotes énergiques de la République, & avec eux le peuple, qui autrefois n’écoutait et ne suivait qu’eux.
Ils sont nuls et impuissants, pour ainsi dire morts, ces patriotes énergiques, ces disciples de celui qu’on peut dire qui fonda chez nous la liberté. Ils sont, dis-je, nuls et impuissants depuis que la mémoire de ce fondateur est couverte d’une injuste diffamation. Rendez-lui son premier lustre légitime, tous les disciples se relèvent et bientôt ils triomphent. Le robespierrisme atterre de nouveau toutes les factions ; le robespierrisme ne ressemble à aucune d’elles, il n’est point factice ni limité. Le robespierrisme est dans toute la République, dans toute la classe judicieuse et clairvoyante, et naturellement dans tout le peuple. La raison en est simple, c’est que le robespierrisme est la démocratie, et ces deux mots sont parfaitement identiques : donc en relevant le robespierrisme, vous êtes sûr de relever la démocratie. »
NOTES
(1) Dans ses Mémoires et Notes, Choudieu déclare : « M. l’abbé Georgel, qui présente rarement les choses sous leur véritable jour, dit, tome II, page 490 de son “Histoire”, que les députés qui faisaient partie des Jacobins étaient obligés par les statuts de faire serment de porter à l’Assemblée nationale toutes les motions adoptées par la Société. J’ai fait partie de la société des Jacobins et je puis affirmer que je n’y ai jamais prêté aucun serment et qu’aucun de mes collègues n’eût voulu contracter une semblable obligation. Comment peut-on avancer de pareilles absurdités ? Les principes des sociétés populaires et leur raison d’être ont toujours été d’assurer les libertés publiques, et celle des opinions étant la première de toutes, comment peut-on supposer qu’on ait pu imposé de pareilles conditions à des hommes qui ont donné tant de preuves d’indépendance ? » (p. 463)
(2) Cet article fut adopté le 18 juin 1793. Un député Girondin interpella les Montagnards : « Vous flattez-vous d’être toujours victorieux ? Avez-vous fait un traité avec la victoire ? » Basire lui répondit : « Nous en avons fait un avec la mort ! », et les Montagnards de se soulever en signe d’approbation. Robespierre intervint alors et la Convention adopta l’article. Il déclara : « Je n’aurais jamais cru qu’un représentant du peuple Français osât professer ici une maxime d’esclavage et de lâcheté. Je n’aurais jamais cru qu’il osât contester la vertu républicaine du peuple qu’il représente. Où a-t-il vu, cet homme, que nous fussions inférieurs aux Romains ? Où a-t-il vu, cet homme, que la Constitution que nous allons terminer fût au-dessous de ce Sénat despotique, qui ne connut jamais la Déclaration des Droits de l’Homme ? Où a-t-il vu que ce peuple qui verse son sang pour la liberté universelle, fût au-dessous des Romains, qui furent, non pas les héros de la liberté, mais les oppresseurs de tous les peuples ? Mais il n’y a rien à répondre à un tel homme. Nous décrèterons un article que nous sommes dignes de soutenir, en dépit de lui et de ses pareils. Qu’ils sachent, tous ceux qui ne savent pas deviner l’énergie d’un peuple libre, qu’ils sachent que cet article est l’expression de sa volonté. Un peuple qui traite sur son territoire avec les ennemis, est un peuple déjà vaincu, et qui a renoncé à son indépendance. Jamais le peuple français ne sera couvert de tant de honte qu’un homme qui, sous le despotisme, après avoir paru faire quelques pas vers l’avenir, rétrograde aujourd’hui. Que la liberté règne en France, cela est facile à concevoir : mais qu’il sache, cet homme, que non-seulement nous décrèterons l’article auquel il s’oppose, mais encore que nous le soutiendrons. » Un siècle et demi plus tard, le même jour, alors que la France était de nouveau envahie, le général De Gaulle affirma à son tour ce principe. Peut-être ignorait-il qu’il allait être à la Résistance ce que Robespierre avait été à la Révolution et qu’il ne faisait que marcher dans les traces de ce dernier. Dans des contextes différents, ces deux géants de l’histoire de France se ressemblent comme deux gouttes d’eau tant par leurs caractères, leurs idées, que par leur vision de la France. Tous deux étaient au-dessus des partis. Leurs noms furent en leur temps le cri de ralliement de tous les patriotes. Le gaullisme n’est jamais que du robespierrisme.
(3) Saint-Just en était inconsciemment arrivé à cette conclusion dans son rapport du 8 ventôse (26 février 1794) : « La force des choses nous conduit peut-être à des résultats auxquels nous n’avons point pensé. L’opulence est dans les mains d’un assez grand nombre d’ennemis de la Révolution ; les besoins mettent le peuple qui travaille dans la dépendance de ses ennemis. Concevez-vous qu’un empire puisse exister, si les rapports civils aboutissent à ceux qui sont contraires à la forme du gouvernement ? Ceux qui font des révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau. » Tant que les révolutionnaires ne sauront ni ce qu’est exactement Largent ni comment l’abattre et élever à sa place l’Egalité, ils ne feront que des révolutions à moitié, vouées à l’échec.
12:52 Écrit par Philippe Landeux dans - REVOLUTION 1789-1794, 6. MON BLOG | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : robespierre, histoire | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 26 mars 2011
LES HEURES LES PLUS SOMBRES DE NOTRE HISTOIRE
Je n’ai jamais compris pourquoi la gaucherie affectionne particulièrement la phrase « cela rappelle les heures les plus sombres de notre histoire », alors qu’elle est la moins bien placée pour s’en servir. Chaque fois je me dis : comment ose-t-elle ? Mais, comme dit l’autre, les cons osent tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît.
Ces fameuses heures sombres sont les années noires 40-44 durant lesquelles la France était occupée par les Allemands, courbée sous le joug nazi, vendue à l’occupant par Vichy. Le peuple français, trahi, envahi, sonné, écrasé, grondait sourdement. Mais ces temps de ténèbres étaient aussi éclairés par la flamme de la Résistance. Les patriotes ardents s’organisaient dans l’ombre, défiaient l’occupant et les traîtres, entravaient leurs projets. Traqués, torturés, il se réchauffaient en chantant la Marseillaise et mourraient en criant Vive la France ! Les plus chanceux combattaient les armes à la main ; certains tombèrent en martyrs, les autres devinrent les héros de la patrie. Ils étaient la France. La vraie France était lumière. Et la lumière chasse les ténèbres.
C’est ne pas avoir une âme de Français que de ne retenir de cette époque que la noirceur au lieu d’y apercevoir le génie de la patrie dans tout son éclat, que de parler de ces temps, non comme d’une épopée terrible, glorieuse et exemplaire, mais comme les plus sombres de notre histoire. Certes, les individus souffrirent, mais que le peuple français fut grand au milieu de tant de trahisons et de souffrances !
C’est être aujourd’hui un émule des traîtres d’hier, et poignarder la France une nouvelle fois, qu’évoquer Vichy chaque fois que le patriotisme se manifeste ! Quelle une imposture, en effet, que d’établir une continuation entre les collabos passés et les patriotes présents ! La cause des patriotes de tous lieux et de tous temps est une. Ceux qui s’opposent aux envahisseurs de leur pays sont des patriotes ; ceux qui appellent à son invasion, se couchent devant les envahisseurs et persécutent « leurs » compatriotes pour complaire à l’occupant sont des lâches et des collabos. Des collabos ne reculent devant aucun procédé, aucune bassesse. Ils n’ont aucun honneur ; ils mentent comme ils respirent ; ils renversent le sens des mots.
Quoi qu’il en soit, « cela rappelle les heures les plus sombres de notre histoire » évoque un temps où des « Français » trahissaient la patrie et collaboraient avec l’ennemi. En quoi la situation actuelle permet-elle une telle comparaison ? En quoi est-il pertinent, de la part de la gaucherie, de la faire ? A quel propos la fait-elle d’ailleurs ?
A tout propos ! Quiconque exprime une idée patriotique, quiconque défend les traditions françaises, quiconque est partisan de l’indépendance nationale et de la souveraineté du peuple, quiconque s’inquiète de l’immigration-invasion que subit la France depuis 50 ans et qui menace son identité et son existence, bref, quiconque est Français, fier de l’être et désire le rester suscite l’ire des gauchistes qui le peignent en chœur comme un être abject, proposant des mesures rappelant les « heures les plus sombres de notre histoire ». Mais nous avons vu que ces « heures » furent assombries par les collabos, non par les résistants. Or quels dangers menacent aujourd’hui la France et le peuple français ? L’Europe, le mondialisme, l’immigration massive, l’islam, le communautarisme. Les résistants modernes sont ceux qui dénoncent ces dangers, proposent des mesures vigoureuses pour les contrer, revendiquent leur francité et sont prêts, le cas échéant, à se battre pour sauver la France ou du moins l’honneur. Oui, l’avenir est sombre, mais la faute à qui, si ce n’est à ceux qui créent ces dangers et bavent sur les Français, c’est-à-dire la gaucherie et la sarkozie ? Ce sont eux, les gauchistes et les euro-mondialistes, qui, pour le coup, sont des collabos (de « l’Empire » et des envahisseurs) et nous plongent dans une situation qui rappelle en effet les « heures les plus sombres de notre histoire ».
Quelle impudence donc, de la part de la gaucherie, d’appliquer à ses détracteurs une expression forgée par elle et pour elle en définitive ! De tous les responsables de notre situation, elle est la plus coupable. La gaucherie n’est pas la gauche, historiquement et intrinsèquement patriote, mais l’ensemble des traîtres à la patrie autoproclamés « de gauche ». Elle trahit à la fois le peuple français et les immigrés : le peuple français, en le vendant au mondialisme au nom de l’humanisme, en détruisant leur pays au nom du multiculturalisme, en cherchant même à éradiquer leur race au nom du métissage ; les immigrés, en leur faisant haïr les Français au nom de la haine de soi, en les laissant se stigmatiser, en les poussant à se communautariser au nom du droit à la différence, en provoquant leur rejet à force d’encourager l’immigration au nom de l’antiracisme. La différence, c’est qu’elle trahit les Français consciemment, et les immigrés involontairement, car elle croit servir leurs intérêts en leur étant complaisante. La différence, encore, entre les collabos d’hier et la gaucherie, c’est qu’elle a créé elle-même l’ennemi, sans raison, qu’elle le sert sans contrainte, et qu’elle expose la France au plus grand danger qu’elle ait jamais couru.
La gaucherie, c’est l’anti-France, le parti de l’étranger. Il y a donc une nouvelle impudence de sa part à parler de « notre » histoire à propos de l’histoire de France. Elle n’a rien à voir avec la France pour laquelle elle n’a que mépris. L’histoire de France n’est pas la sienne. Ce « notre » n’est qu’une habileté, un moyen de s’inclure dans le peuple français et de paraître légitime quand elle parle. Mais que fait-elle de ce droit de parole usurpé ? Elle s’en sert pour accabler la France et les Français, les rabaisser, les faire culpabiliser, les obliger à se repentir de tout et envers tous, étouffer en eux toute fierté, les appeler à se laisser piétiner. Jamais un mot en leur faveur. Tout pour les étrangers et les immigrés, quoi qu’ils fassent, sauf s’ils sont dignes d’être français. Elle ne fait pas inlassablement allusion « aux heures les plus sombres de notre histoire » pour que les Français soient en alerte et évitent les dangers, mais pour les anesthésier et les piéger plus sûrement, autrement dit pour les armer contre eux-mêmes. Elle ne s’intéresse à eux que pour les perdre, comme si leur sort ne la concernait pas. Elle ne jouit que de leur malheur. Elle n’est pas française de cœur ; elle n’est pas française tout court.
Enfin, aux heures les plus sombres de notre histoire, face au péril, les Français de tous bords politiques mettent de côté leurs différends, écoutent le bon sens, répondent à l’honneur et ne voient plus que l’intérêt supérieur de la patrie. Il est là le peuple de France, c’est-à-dire la France, la vraie. En dehors d’eux, il n’y a que des égarés, des apatrides et des traîtres, tous collabos par bêtise ou en conscience. Or on observe bien, aujourd’hui, un tel mouvement. Des Français de tous horizons se retrouvent sous la bannière du Front National. Que veut-il pour l’essentiel ? L’arrêt de l’immigration, la sortie de l’Europe, l’affirmation de la souveraineté nationale, la résurgence du patriotisme. Voilà les Français que la gaucherie, championne en calomnie, taxe de fascistes pour se donner le beau rôle ! Beaucoup de ces Français ont longtemps été dupes de la gaucherie et de ses mantras assassins et pourtant insipides. Faut-il que l’heure soit grave pour qu’ils se rallient à un parti qu’ils détestaient machinalement comme les fourbes le leur avaient inculqué ! Ils surmontent leur dégoût parce qu’ils réalisent que ce parti est le seul à défendre la patrie, que tous les autres sont ligués contre elle. Le sursaut national approche, comme aux heures les plus décisives de notre histoire.
De Munich à Montoire !
Philippe Landeux
18:00 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 8. GAUCHERIE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : heures, sombres, histoire, gaucherie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 25 janvier 2011
ROBESPIERRE Histoire (version courte)
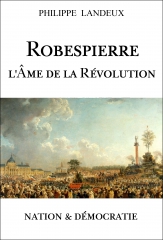 Robespierre fut un grand homme, un grand Français, le député le plus populaire et le plus grand révolutionnaire. En tant que tel, il fut l’objet d’attaques incessantes. Sa mémoire même fut souillée de calomnies. Même les raccourcis que l’histoire oblige parfois à faire transforment son portait du tout au tout. Ainsi, son nom est aussi célèbre que son histoire réelle et son œuvre sont méconnues du grand public.
Robespierre fut un grand homme, un grand Français, le député le plus populaire et le plus grand révolutionnaire. En tant que tel, il fut l’objet d’attaques incessantes. Sa mémoire même fut souillée de calomnies. Même les raccourcis que l’histoire oblige parfois à faire transforment son portait du tout au tout. Ainsi, son nom est aussi célèbre que son histoire réelle et son œuvre sont méconnues du grand public.
Il est pourtant primordial de connaître la véritable histoire et les idées de cet homme qui incarna la Révolution et inspira des générations de patriotes. Les Français ignorent tout ce qu’ils lui doivent ; la République elle-même a oublié qu’elle lui doit jusqu’à sa devise. Bien qu’il ait vécu et ait été exécuté il y a plus de deux cents ans, beaucoup de ses idées sont encore révolutionnaires, plus révolutionnaires que celles des révolutionnaires autoproclamés, et la vie de cet homme que l’on appelait l’Incorruptible reste un exemple.
Je me flatte d’être robespierriste. Et si l’on me demande pourquoi, ou pourquoi je tiens tant à défendre sa mémoire et à rappeler son souvenir dans toute son authenticité, qu’il me suffise de citer ce mot de Babeuf :
« Le robespierrisme est dans toute la République, dans toute la classe judicieuse et clairvoyante, et naturellement dans tout le peuple. La raison en est simple, c’est que le robespierrisme est la démocratie, et ces deux mots sont parfaitement identiques : donc en relevant le robespierrisme, vous êtes sûr de relever la démocratie. »
Il est impossible d’exposer ici la richesse de la pensée de Robespierre. Pour la connaître, il faut lire ses discours ou, au moins, de bonnes biographies (Jean Massin, Ernest Hamel) ou de bonnes histoires de la Révolution (Albert Mathiez, Albert Soboul, Georges Lefebvre). Mais pour se plonger ainsi dans l’étude, encore faut-il en sentir l’intérêt et ne plus avoir de lui l’image fausse et négative qui est généralement colportée.
Peindre Robespierre sous son véritable jour et anéantir les fausses idées reçues à son sujet pour donner envie de le lire est donc le but que je me propose. J'ai réalisé deux exposés dont le présent est la version courte. (version développée ici)
ROBESPIERRE Maximilien Marie Isidore (de) :
Né à Arras, le 6 mai 1758 – Exécuté à Paris le 28 juillet 1794 (10 thermidor an II). Avocat. Homme politique français. Figure emblématique de la Révolution française. Âme des Jacobins et de la Montagne.
Avant la Révolution
Sa mère meurt en couche alors qu’il n’a que six ans. Son père, avocat, bouleversé par la mort de sa femme, abandonne le foyer peu après. Ses deux sœurs, Charlotte et Henriette qui mourra à 22 ans, et son frère, Augustin Bon, surnommé Bonbon ou, plus tard, Robespierre jeune, sont recueillis par des parents, lui-même par son grand-père maternel. Studieux, remarqué par les autorités ecclésiastiques d’Arras, il se voit accordé une bourse d’étude au collège Louis-le-Grand à Paris. Elève brillant, il aura l’honneur de faire au nom du collège le compliment à Louis XVI au retour de son sacre. (11 juillet 1775) Reçu avocat le 2 août 1781 au barreau de Paris, il retourne à Arras où il est admis au barreau le 8 novembre. Ses débuts sont prometteurs. Admirateur de Rousseau, il se fait le défenseur des pauvres. En 1782, il se voit confié par l’Evêque d’Arras un siège de juge à la salle épiscopale. Cette même année, il est admis à la Société des Rosatis, « des jeunes gens réunis par l'amitié, le goût des vers, des roses et du vin ». En 1783, il entre à l’Académie d’Arras dont il sera élu président, à l’unanimité, le 4 février 1786. En 1784, il obtient le deuxième prix du concours de l'Académie de Metz, sur « l'origine de l'opinion qui étend sur tous les individus d'une même famille une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit un coupable ».
Première élection
La convocation des Etats Généraux par Louis XVI l’enflamme. En janvier 1789, il publie une brochure pragmatique qui rencontre un franc succès et est rééditée en avril : « Appel à la nation artésienne sur la nécessité de réformer les États d’Artois ». En mars, il rédige le cahier de doléances de la corporation des savetiers, la plus pauvre et la plus nombreuse d’Arras. Le 26 avril, il est élu député, un des huit députés du Tiers Etat d’Artois.
La Constituante
Inconnu du grand public, il n’a que peu de part aux premiers événements de la Révolution. Mais sa rigueur, sa constance, son intransigeance, son honnêteté vont rapidement faire de lui une des vedettes (du côté gauche) de l’Assemblée constituante issue des Etats Généraux. Ses principes qui ne varieront jamais sont : égalité des citoyens en droits, souveraineté du peuple. Ses opinions trop démocratiques ne prévaudront pas au sein de cette assemblée constituée pour moitié de bourgeois, pour l’autre de nobles et d’ecclésiastiques. Aucun article de la constitution de 1791 ne sera son œuvre. Mais son acharnement à défendre, souvent seul et en vain, la cause populaire fait de lui le héros du peuple et lui vaut rapidement d’être surnommé l’Incorruptible. Cela fait aussi de lui la bête noire des royalistes et des riches, de tous les honnêtes gens qui veulent le peuple nul et qui inaugurent les calomnies qui courent toujours sur son compte.
De tous les combats, il se prononce contre la loi martiale, contre le veto royal, contre le suffrage censitaire, contre le cumul des fonctions publiques, contre l’esclavage, contre la peine de mort (pour les crimes de droit commun), pour le rattachement d’Avignon à la France, pour le suffrage universel, pour l’institution de jurés, pour le droit de pétition, pour la liberté de la presse, pour le mariage des prêtres, pour la présence de soldats en nombre égal à celui des officiers dans les cours martiales.
Ni monarchiste ni républicain, peu lui importe la forme du gouvernement pourvu que les droits des citoyens et du peuple soient respectés. Dans un discours sur l’organisation des gardes nationales (décembre 1790), applaudi par toutes les sociétés patriotiques, il formule la devise que reprendra la IIIe république : Liberté Egalité Fraternité. Son seul véritable succès parlementaire est l’obtention de la non rééligibilité des députés sortants, quoique le décret, contrairement à sa proposition, limite cette non rééligibilité à la législature suivante. Au sortir de la dernière séance de la Constituante, le 30 septembre 1791, les Parisiens lui font un triomphe. Sa popularité et sa renommée sont immenses dans toute la France. En juin 1791, la municipalité de Toulon l’avait fait citoyen de la ville ; en mars, celle de Marseille lui avait demandé d’être son défenseur, comme il avait été celui des Avignonnais.
Les Jacobins
S’il n’a aucune influence sur l’Assemblée, il en a au contraire beaucoup au club des Jacobins qui réunit les députés les plus avancés (tous les personnages célèbres de la Révolution en font partie, La Fayette, Mirabeau, Siéyes, Talleyrand, Barnave, Lameth, Duport, Barère, Le Chapelier, Lanjuinais, Liancourt, etc.) et où la parole est plus libre. Les séances du club sont ouvertes au public, rapportées par les journaux et font l’objet d’un procès verbal envoyé aux sociétés affiliées partout en France. Mais c’est après la fuite du roi, en juin 1791, qu’il devient réellement et jusqu’à sa mort l’âme (non pas le maître) du club. C’est lui qui sauve son existence, le consolide et l’incarne aux yeux de l’opinion publique lorsque les divergences sur les suites à donner à la fuite du roi poussent la plupart des membres (246 députés) à faire défection et à fonder le club éphémère et impopulaire des Feuillants.
La Législative
Redevenu simple citoyen, Robespierre, après un bref séjour dans son pays, revient à Paris. Il pensait que la nouvelle Assemblée, dite Législative, travaillerait à corriger par de bonnes lois les défauts de la constitution. Mais déjà les nouveaux députés influents que l’on appelle Girondins — car originaires de Bordeaux mais aussi d’autres villes portuaires telles Nantes ou Marseille — n’ont que la guerre en tête, à l’instar de la Cour qui ne voit son salut que dans une défaite militaire. C’est aux Jacobins, dont les Girondins sont alors membres, qu’il va s’opposer de toutes ses forces à leur projet qu’il juge absurde et naïf (les véritables ennemis sont à l’intérieur, pas à Coblentz) et pressent dangereux pour la Révolution et désastreux dans tous les cas (risque de césarisme). Les Girondins, irascibles et intrigants, ne lui pardonneront pas cette opposition vigoureuse, d’autant plus qu’ils sont les champions de la bourgeoisie quand lui défend le peuple.
Quand la guerre est déclarée à l’Empereur d’Autriche (20 avril 1792), tout ce que Robespierre a annoncé se réalise ; elle tourne au désastre. Mais, malgré les trahisons, les Girondins ne songent qu’à sauvegarder leur pouvoir en passant des compromis avec la Cour. Robespierre, au contraire, prône le renversement de la monarchie, la convocation d’une convention nationale (dont doivent être exclus, selon lui, les ex-constituants, dont lui-même, et les députés en fonction) et appelle le peuple de Paris et les fédérés des départements à l’insurrection.
Le 10 août, le palais des Tuileries est pris d’assaut, l’Assemblée suspend le roi qui s’est réfugié auprès d’elle et convoque une convention nationale. Une nouvelle municipalité parisienne est mise en place par les sections de la capitale : la Commune insurrectionnelle. La section des piques désigne Robespierre pour y siéger.
La Législative étant discréditée et condamnée, c’est la Commune qui détient le pouvoir, assure l’intérim et prend les mesures de circonstance : envoi d’agents dans les départements pour informer de l’événement ou effectuer des réquisitions, perquisitions pour trouver des armes, recrutement des volontaires, arrestation des contre-révolutionnaires notoires (lesquels, à l’annonce des trahisons de Longwy et de Verdun, seront massacrés dans les prisons avant le départ des volontaires).
Le 20 septembre, à Valmy, l’armée française et les volontaires arrêtent les austro-prussiens qui, dès lors, battent en retraite. (Le caractère victorieux de cette rencontre est contesté. Le retrait des troupes austro-prussiennes serait le résultat de négociations menées par Danton. Il est néanmoins constant que les armées ennemies étaient dans un état lamentable et que les troupes françaises auraient pu les exterminer si elles n’avaient été retenues et obligées de suivre de loin leur retraite.) La Belgique tombe entre les mains des Français.
La Convention girondine
Les Girondins n’ont pas eu le panache des Constituants et n’ont pas suivi Robespierre : ils ne se sont pas fermés la porte de la réélection. Robespierre qui a déjà eu à les combattre sur un pied d’inégalité se représente donc. Le 5 septembre, il est le premier député désigné par Paris. Il est également élu spontanément par le Pas-de-Calais. De manière générale, Paris qui connaît bien les Girondins désigne des hommes populaires et énergiques qui formeront la base de la tendance opposée à la Gironde : la Montagne.
Pour l’heure les Girondins tiennent tous les ministères et tous les postes de la Convention. La session s’ouvre le 21 septembre. La monarchie est abolie en France. Dès le lendemain, les Girondins commencent à attaquer la députation de Paris et à semer la défiance contre cette ville. Leurs attaques incessantes et combinées sont de plus en plus pressantes et particulièrement dirigées contre Robespierre, Danton et Marat. Le summum est atteint lorsque, le 29 octobre, Louvet prononce un véritable réquisitoire contre Robespierre, accusé d’aspirer à la dictature, et la Commune de Paris.
Robespierre lui répond le 5 novembre et terrasse ses accusateurs en montrant l’insanité de leurs accusations, eux qui n’ont rien fait pour la Révolution et la République, et en rappelant les mérites de la Commune de Paris à l’heure du danger. L’impression de son discours est votée à la quasi unanimité. Les députés de province qui étaient prévenus contre Paris par la propagande girondine sont détrompés et ne veulent plus entendre les Girondins. La Convention, jusque-là paralysée par les querelles de personnes, peut enfin s’occuper du sort du roi.
Estimant qu’un procès présume Louis XVI innocent alors que le 10 août a tranché la question, Robespierre se prononce pour son exécution pure et simple. La majorité en décide autrement. Les Girondins dont le but est rien moins que clair multiplient alors les manœuvres dilatoires. Après avoir argué de l’inviolabilité du roi, puis proposé que le roi soit jugé par le peuple, ils proposent que le jugement de la Convention soit soumis à la ratification du peuple et votent finalement la mort, mais avec sursis. Leur échec est complet sur toute la ligne : la majorité de la Convention (malgré les entreprises de corruption) a suivi les Montagnards. Le ci-devant roi est condamné à mort le 20 janvier 1793 et exécuté le lendemain.
Les sujets à l’ordre du jour sont alors l’économie, la guerre et la constitution. Champions des riches et partisans du libre échange, euphémisme pour désigner la liberté d’accaparer et d’affamer pour s’enrichir, les Girondins refusent toute intervention autre que la répression alors que le peuple est confronté à la dévaluation de la monnaie et aux difficultés d’approvisionnement, voire à la faim. Cette politique de la part de ceux qui ont plongé la France dans la guerre, qui viennent de la déclarer à l’Angleterre (1er février) et à l’Espagne (7 mars), semble à beaucoup inconséquente. Un pays en guerre a besoin de son peuple pour la faire. Il faut donc satisfaire le peuple pour lui donner des raisons de se battre. En outre, les Girondins s’ingénient à prendre le contre-pied des Montagnards et défendent Dumouriez qui perd la Belgique, tente même de retourner ses troupes contre la Convention, comme La Fayette l’année précédente, et expose de nouveau la France à l’invasion. Enfin, ils n’ont rien perdu de leur haine contre les Montagnards et Paris contre laquelle ils excitent les départements. Le 13 avril, alors que 300 députés pour la plupart Montagnards sont en mission pour le recrutement, ils obtiennent l’arrestation de Marat et sa traduction au Tribunal révolutionnaire. Acquitté le 24 avril, les Parisiens le reconduisent triomphalement à la Convention.
Cet état de rivalité, alors que l’unité est plus que jamais nécessaire, ne peut plus durer. L’inconséquence, l’incompétence, l’égoïsme, l’orgueil, la malveillance et la mesquinerie des Girondins, leur puérilité qui confine à la trahison, leur défiance envers Paris qui les pousse au fédéralisme, gâtent tout et empêchent la Convention d’agir. Sans le sursaut du 10 août auquel ils se sont opposés de toutes leurs forces, la guerre était perdue et la Révolution avec elle. Maintenant, Marseille se soulève contre Paris à leur appel (29 avril). Bordeaux aussi. Le 4 mars, les paysans vendéens, déçus par la politique bourgeoise de la constituante et de la législative, se sont insurgés contre le recrutement, lui aussi conséquence de la politique guerrière girondine. Lyon s’apprête à lever l’étendard de la révolte (29 mai).
Le 13 mars, aux Jacobins, Robespierre avait rejeté toute idée d’insurrection partielle et avait appelé une dernière fois les Girondins à revenir à la raison. Il ne pensait pas les départements prêts à accepter une insurrection qui, par ailleurs, confirmerait la propagande girondine. Mais, le 27 mars, il appelle les sections qui devront bientôt se lever à bannir tous les traîtres. Les Jacobins adoptent sa proposition. Deux jours plus tard, il fixe le programme de salut public qui sera bientôt appliqué point par point par la Montagne. Le 3 avril, avec la trahison de Dumouriez qui ne fait plus aucun doute (il est décrété hors la loi le même jour et passe à l’ennemi deux jours plus tard), il appelle les sections à s’armer et, de son côté, renonce à ses fonctions de membre du Comité de défense générale, essentiellement composé de Girondins, auquel il avait été adjoint le 26 mars. A la tribune de la Convention, il demande un décret d’accusation contre les Girondins en général et Brissot en particulier. Le 2 juin, la garde nationale et les Sans-culottes cernent la Convention et l’obligent à décréter d’arrestation 22 Girondins ainsi que Clavière, ministre des contributions publiques, et Lebrun, ministre des affaires étrangères.
L’intention des Montagnards est simplement d’écarter les Girondins qui sont littéralement renvoyés chez eux, en détention. Mais beaucoup profitent de cette clémence pour s’enfuir et soulever les départements. Le 13 juillet, Charlotte Corday qui arrive de Caen où plusieurs d’entre eux se sont réfugiés poignarde Marat. Après Le Pelletier, le 20 janvier, c’est le deuxième Montagnard assassiné.
La Convention montagnarde / l’an II
Entre temps, la Convention a repris à zéro l’ouvrage constitutionnel et a adopté une constitution, la plus démocratique et la plus patriotique de l’histoire de France, le 24 juin. Le 18 juin, Robespierre a soutenu que le peuple français ne ferait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. Cette constitution est précédée, sur le vœux de Robespierre (10 mai), d’une déclaration des droits qui, à quelque chose près, est celle qu’il avait proposée et que les Jacobins avaient adoptée le 21 avril. N’y manque que ses conceptions sur la propriété qui, selon lui, est une institution sociale qui doit être limitée comme tout droit.
Le 27 juillet, à la faveur de la démission de Gasparin, il est proposé et élu membre du Comité de salut public qui s’occupe de la guerre, des relations internationales et de la politique générale. La situation est tragique. La France est attaquée de tous côtés et les deux tiers des départements sont en révolte contre Paris. Mais le prestige de Robespierre confère au Comité l’assurance et l’autorité et bientôt la confiance (25 septembre) et la stabilité qui lui sont nécessaires pour faire face, notamment pour soumettre les généraux au pouvoir politique et étouffer les factions.
Au Comité, dont les décisions ultimes sont collégiales, Robespierre s’intéresse à tout mais sa fonction est essentiellement politique. Son but, outre l’unité du Comité, est l’unité du peuple français. Il est partisan de mesures à la fois énergiques et raisonnables (modérées). Il abhorre la démagogie, les excès et la corruption qui déshonorent la République, la Révolution et la Convention.
Il mène son premier grand combat, fin nombre, contre la déchristianisation violente (fermeture des églises, renversement des croix, abdications volontaires ou forcées des prêtres, mascarades antireligieuses, oppression des fidèles, etc.), symbolisée par le culte de la Raison qu’il prend, à tort, pour un mouvement athée mais qui, effectivement, donnait du grain à moudre à la propagande contre-révolutionnaire et menaçait d’embraser la France. Inauguré à Nevers par Fouché, importé à Paris par Chaumette, procureur syndic de la Commune, applaudi par la Convention, relayé dans les départements par les représentants en mission, la vague semblait irrésistible. Illusion ! Les campagnes résistaient, se révoltaient. Des centaines de mouvements quasi insurrectionnels étaient signalés partout. Le 21 novembre, aux Jacobins, Robespierre se dresse et oppose tout son prestige et ses principes à ce courant furieux qui menace de désoler et de perdre la République ; il démontre que les déchristianisateurs sont des contre-révolutionnaires qui, au mieux, s’ignorent ; il appelle au respect de la liberté des cultes. Dès lors, le torrent reflue. Le 5 décembre (15 frimaire), la Convention adopte la réponse au manifeste des rois ligués contre la République qu’il lui présente au nom du Comité et dont le préambule est une nouvelle charge contre la déchristianisation. Le lendemain, sur un nouveau rapport de Robespierre, elle rappelle qu’elle a proclamé la liberté des cultes dans la constitution (art. 7) et défend toute violence à leur endroit, à moins qu’ils soient prétextes de troubles à l’ordre public. Ce décret ramena le calme partout dès lors qu’il fut connu et respecté.
Le 25 décembre (5 nivôse), Robespierre énonce les principes du gouvernement révolutionnaire institué le 4 décembre (14 frimaire) et théorise, de fait, la Terreur qui, elle, est en vigueur depuis le 5 septembre. Il n’a pas instauré la Terreur qui s’est imposée d’elle-même. Il n’a même en rien contribué à son instauration, contrairement à Merlin (de Douai), Billaud-Varenne ou Danton. Qu’il l’ait théorisée ne fait pas de lui son instigateur. De même, le gouvernement révolutionnaire fut l’œuvre de Billaud-Varenne et de Saint-Just. Robespierre n’était pas contre, mais il est bon de rappeler qu’il n’était pas seul, que tout ne fut pas son œuvre et qu’il faut rendre à César ce qui est à César.
Au reste, que signifiait ce grand mot de « Terreur » ? Que la République en guerre punirait désormais de mort ses ennemis déclarés. Cela n’avait rien de nouveau. Précisément, Robespierre ne fit que justifier la violence d’Etat en indiquant son but, ses principes, ses obstacles et ses dangers. La Terreur n’était finalement rien de plus que la reconnaissance du droit, pour un régime aux abois, de tuer ses ennemis mortels intérieurs, droit fondé sur le principe de légitime défense, à l’instar du droit, pour un Etat en guerre, de tuer ses ennemis extérieurs incarnés par les soldats étrangers. La Terreur n’était pas un but mais une nécessité passagère. Comme avait dit Saint-Just : « Il faut gouverner par le fer ceux qui ne peuvent l’être par la justice » (10 octobre). Mais Robespierre ajoutait :
« Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur : La vertu, sans laquelle la Terreur est funeste ; la Terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. » « Ces notions suffisent pour expliquer l’origine et la nature des lois que nous appelons révolutionnaires. Ceux qui les nomment arbitraires ou tyranniques sont des sophistes stupides ou pervers qui cherchent à confondre les contraires : ils veulent soumettre au même régime la paix et la guerre, la santé et la maladie, ou plutôt ils ne veulent que la résurrection de la tyrannie et la mort de la patrie. S'ils invoquent l'exécution littérale des adages constitutionnels, ce n'est que pour les violer impunément. Ce sont de lâches assassins qui, pour égorger sans péril la République au berceau, s'efforcent de la garrotter avec des maximes vagues dont ils savent bien se dégager eux-mêmes. [...] Il [le gouvernement révolutionnaire] doit se rapprocher des principes ordinaires et généraux, dans tous les cas où ils peuvent être rigoureusement appliqués, sans compromettre la liberté publique. La mesure de sa force doit être l'audace ou la perfidie des conspirateurs. Plus il est terrible aux méchans, plus il doit être favorable aux bons. Plus les circonstances lui imposent de rigueurs nécessaires, plus il doit s'abstenir des mesures qui gênent inutilement la liberté publique, et qui froissent les intérêts privés, sans aucun avantage public. »
Au passage, Robespierre brosse une fois de plus le portrait des factions.
« Il [le gouvernement révolutionnaire] doit voguer entre deux écueils, la faiblesse et la témérité, le modérantisme et l'excès ; le modérantisme, qui est à la modération, ce que l'impuissance est à la chasteté, et l'excès qui ressemble à l'énergie, comme l'hydropisie à la santé. Les tyrans ont constamment cherché à nous faire reculer vers la servitude, par les routes du modérantisme ; quelquefois aussi ils ont voulu nous jetter dans l'extrêmité opposée. Les deux extrêmes aboutissent au même point. Que l'on soit en-deça ou en-delà du but, le but est également manqué. Rien ne ressemble plus à l'apôtre du fédéralisme, que le prédicateur intempestif de la République une et universelle. L'ami des rois et le procureur du genre humain s'entendent assez bien. Le fanatisme couvert de scapulaires, et le fanatique qui prêche l'athéisme, ont entr'eux beaucoup de rapports. Les barons démocrates sont les frères des marquis de Coblentz ; et quelquefois les bonnets rouges sont plus voisins des talons rouges qu'on ne pourrait le penser. Mais c'est ici que le gouvernement a besoin d'une extrême circonspection, car tous les ennemis de la liberté veillent pour tourner contre lui, non-seulement ses fautes, mais même ses mesures les plus sages. Frappe-t-il sur ce qu'on appelle exagération ? Ils cherchent à relever le modérantisme et l'aristocratie. S'il poursuit ces deux monstres, ils poussent de tout leur pouvoir à l'exagération. Il est dangereux de leur laisser les moyens d'égarer le zèle des bons citoyens ; il est plus dangereux encore de décourager et de persécuter les bons citoyens qu'ils ont trompés. Par l'un de ces abus, la république risquerait d'expirer dans un mouvement convulsif ; par l'autre, elle périrait infailliblement de langueur. »
Il a déjà dit tout cela à plusieurs reprises, notamment le 25 septembre et le 5 décembre. Les factieux sont prévenus ; les égarés sont invités à se ressaisir avant que le Comité ne sévisse.
La première faction, celle des ultra-terroristes, est représentée d’abord par Hébert et sa feuille Le Père Duchesne puis par les Cordeliers ; la seconde, celle des Indulgents, par Fabre, Danton, Desmoulins et sa feuille Le Vieux Cordelier. Tous sont Jacobins. Malgré Robespierre qui ne cesse de présenter à chacun les dangers de leur attitude, ils persistent à se déchirer et à attaquer, pour des raisons opposées, la politique du Comité. On ne se refait pas ! Les premiers sont essentiellement inconséquents et ambitieux : ils veulent la Terreur pour s’élever. Le seconds sont essentiellement jouisseurs et corrompus : ils ne veulent plus de la Terreur pour ne pas monter eux-mêmes à l’échafaud. Tous guettent le faux pas.
Les Cordeliers croient le moment venu d’agir lorsque Robespierre qu’ils appellent l’endormeur tombe malade en février 1794 (du 13 février au 12 mars). Ils s’agitent et appellent à l’insurrection le 4 mars (appel que, du reste, les sections n’entendent pas). Mais les collègues de Robespierre font front, notamment Collot-d’Herbois. Le 13 mars, c’est Saint-Just qui dénonce à la Convention la faction de l’Etranger et donne le signal à Fouquier-Tinville, l’accusateur public, pour arrêter les meneurs Cordeliers qui sont arrêtés le soir même et exécutés le 24 mars (4 germinal). Le Comité peut dès lors mettre un terme à certains abus. Il fait notamment supprimer l’armée révolutionnaire (7 germinal) et remanie la Commune de Paris (8-9 germinal).
Il n’a pas pour autant l’intention de se laisser déborder par les Indulgents qui croient à leur tour le moment venu d’agir. Dans la nuit du 30 au 31 mars, les Comités réunis de salut public et de sûreté générale ordonnent leur arrestation. Robespierre qui connaît Danton depuis le début de la Révolution et Camille Desmoulins, depuis son enfance (il fut le témoin de son mariage et est même le parrain de son fils), a longtemps hésité. Mais, pressé par ses collègues (Barère, Collot-d’Herbois, Billaud-Varenne, Saint-Just, Vadier), il s’est laissé fléchir — ses collègues auraient fini par se passer de son consentement dans le cas contraire. Deux rencontres avec Danton, la dernière le 29 mars, lui ont ôté ses derniers scrupules. Le 31 mars, c’est lui qui fait taire les amis de Danton à la Convention qui, sur le rapport de Saint-Just, « décrète d’accusation Camille Desmoulins, Hérault, Danton, Philippeaux, Delacroix, prévenus ce complicité avec d’Orléans et Dumouriez, avec Fabre d’Eglantine et les ennemis de la République, d’avoir trempé dans la conjuration tendant à rétablir la monarchie, à détruire la représentation nationale et le gouvernement républicain. En conséquence, elle ordonne leur mise en jugement avec Fabre d’Eglantine. » Le procès des Indulgents est avant tout celui de Fabre, ami de Danton, impliqué dans la conspiration de Batz dont l’affaire dite de la Compagnie des Indes n’est que la partie visible. Les Indulgents sont exécutés le 5 avril (16 germinal).
Pour Robespierre, rien n’est changé. Il n’a ni plus ni moins de pouvoir qu’avant ; il est simplement un membre du Comité de salut public. Son prochain grand sujet sera l’organisation des fêtes décadaires.
Au lendemain de l’exécution des Indulgents, le 6 avril, Couthon annonce à la Convention que le Comité lui présentera d’ici peu « un projet de fête décadaire dédié à l’Eternel, dont les Hébertistes n’ont pas ôté au peuple l’idée consolante ». L’adoption du calendrier républicain, le 5 octobre 1793, a bouleversé le temps. Le décadi a remplacé le dimanche et supprimé la messe. De partout, les lettres affluent demandant que la Convention et le Comité pallient au vide ainsi créé. Le Comité d’instruction publique s’est saisi dès le mois de janvier du dossier et a déjà présenté aux députés, fin février-début mars, sous forme d’imprimé, le projet de Mathieu (de l’Oise). C’est ce projet, simplifié, précédé d’un long rapport, que Robespierre présente à la Convention le 7 mai (18 floréal). Ce rapport, au terme duquel la Convention décrète que le peuple français reconnaît l’existence de l’Etre suprême et l’immortalité de l’âme (tout en confirmant le décret du 18 frimaire sur la liberté des cultes) et fixe les thèmes auxquels seront consacrés les décadis, est accueilli par la Convention et la France entière avec un enthousiasme extraordinaire. Il semble que l’heure de la réconciliation nationale soit venue. La première fête est fixée au 20 prairial (8 juin). Elle est spécialement dédiée à l’Etre suprême, contrairement aux autres qui sont simplement placées sous ses auspices. C’est un acte politique après les désordres provoqués par la déchristianisation et l’ambiguïté du culte de la Raison. Il ne s’agit cependant en rien d’un nouveau culte ou d’une nouvelle religion.
Le 4 juin (16 prairial), la Convention porte Robespierre à sa présidence à l’unanimité afin qu’il préside la fête qui doit avoir lieu quatre jours plus tard. (Ce n’était pas la première fois que Robespierre présidait. Un président de la Convention n’avait rien à voir avec un actuel président de la République. Il changeait tous les quinze jours et n’avait d’autre fonction que de diriger les débats de l’Assemblée ou, à l’occasion, de présider des fêtes officielles à Paris.) Cet honneur se révèle empoisonné. La fête de l’Etre suprême est grandiose, majestueuse, populaire (400.000 participants à Paris, selon un témoin), mais la position de Robespierre prête aux calomnies de la part de ses ennemis. Car il en a, beaucoup : les amis de Danton, les amis d’Hébert, les athées, les corrompus, les terroristes, les hommes violents et sans moralité. Il les entend dans son dos qui murmurent, qui l’insultent. Quand il rentre chez lui le soir, il sait qu’ils auront sa peau.
Deux jours plus tard, Couthon présente à la Convention la loi plus controversée, celle du 22 prairial qui réorganise le Tribunal révolutionnaire, accélère ses procédures et précise les motifs qui en sont passibles. Quelques députés protestent. Robespierre intervient pour la faire adopter article par article. Son nom est désormais associé à cette loi qui, appliquée ou plutôt dénaturée par ses ennemis personnels, va devenir entre leurs mains un moyen de le discréditer.
En fait, cette loi n’avait rien d’incongru ni de nouveau. Elle était liée aux lois de ventôse, à celle du 27 germinal et à l’institution de la Commission d’Orange, le 21 floréal.
Les 8 et 13 ventôse (26 février, 3 mars), sur des rapports de Saint-Just, la Convention avait décrété que les biens des condamnés seraient distribués aux indigents d’après le tableau qu’en ferait le Comité de sûreté générale. Dans cette optique, elle avait décrété, le 23 ventôse (13 mars), l’établissement de six Commissions populaires qui seraient chargées de juger les ennemis de la Révolution détenus dans les prisons. Le 27 germinal (16 avril), toujours sur rapport de Saint-Just, elle avait voté les mesures de police générale d’après lesquelles tous les prévenus de conspiration devaient être transférés à Paris. C’était suspendre de fait tous les tribunaux révolutionnaires de province et donner un travail énorme à celui de Paris, ce qu’un arrêté du Comité de salut public du 22 avril (3 floréal) précise textuellement. (Pour être tout à fait exact, quelques tribunaux révolutionnaires furent maintenus ou rétablis en mai : celui d’Arras, jusqu’au 10 juillet, de Bordeaux, de Nîmes, de l’armée de la Moselle et, à l’Ouest, celui de Noirmoutier, de Laval-Vitré-Rennes et de l’armée de l’Ouest. La Commission d’Orange qui n’existait pas alors fut elle aussi établie en mai, le 10.) Le 8 mai (19 floréal), sur le rapport fait par Couthon au nom des Comités de salut public et de législation réunis, la Convention décréta encore que, en exécution de l’article premier de la loi du 27 germinal, tous les crimes contre-révolutionnaires, définis par les lois antérieures, seraient du ressort du Tribunal révolutionnaire de Paris, où qu’ils aient été commis dans la République.
Le 13 et 14 mai (24 et 25 floréal), les Comités de salut public et de sûreté générale réunis instituèrent à Paris les deux premières Commissions populaires, chacune composée de cinq membres dont certains étaient jurés au Tribunal révolutionnaire et qui tous, d’après un arrêté du Comité du 24 mai (5 prairial), reçurent le même traitement que les juges dudit Tribunal. Le 22 mai (3 prairial), Robespierre les dota de tous les moyens pour enquêter. Le 10 mai, le Comité institua une Commission révolutionnaire à Orange. Le 18 mai, le Comité lui adressa une instruction qui était manifestement inspirée par le fonctionnement des Commissions populaires et qui inspira à son tour les articles 8 et 16 de la loi du 22 prairial. Tous les membres du Comité de salut public avaient participé à l’établissement de ces différentes Commissions. Tous en partageaient l’esprit.
Les Commissions populaires commencèrent à produire des listes de détenus à condamner, à déporter ou à libérer le 19 prairial. Trois jours plus tard, Couthon présentait la loi du 22 prairial qui accélérait les procédures du tribunal révolutionnaire. C’était une conséquence directe de toutes les lois et dispositions précédentes auxquelles les Comités et la Convention avaient souscrit. La raison d’être de cette loi est claire et les controverses à son sujet sont le fait d’ignorants ou de partisans.
C’est également une imposture que de présenter cette loi comme l’origine d’une Grande Terreur, donc Robespierre comme un grand terroriste. S’il est vrai que le nombre d’exécutions augmente après son adoption, il faut préciser que cette augmentation ne concerne que Paris et que leur nombre a déjà fortement augmenté depuis la loi du 27 germinal qui a supprimé les tribunaux révolutionnaires de province. En réalité, si le nombre d’exécutions explose à Paris, c’est parce que la Terreur a quasiment cessé partout en France. La période dite de la Grande Terreur est en fait celle qui vit chuter le nombre d’exécutions au niveau national. Et, même à Paris, les chiffres sont dérisoires. De l’instauration du Tribunal révolutionnaire en mars 1793 au 27 juillet 1794 (9 thermidor), il n’y eut que 2639 exécutions à Paris (pour 1218 libérations et 258 autres peines), dont seulement 1075 Parisiens. Ainsi, pour une ville qui comptait 600.000 habitants, moins de 0,2 % d’entre eux furent exécutés. Que les victimes n’aient pas été à la fête est une chose ; croire que les Parisiens étaient terrorisés en est une autre !
Le vrai scandale de cette période réside dans le principe des « fournées », c’est-à-dire de la traduction simultanée de plusieurs dizaines de détenus devant le Tribunal révolutionnaire. Or cette pratique n’était pas prescrite par la loi du 22 prairial. Elle incombait sans doute à Fouquier-Tinville que Robespierre essaya en vain de faire destituer fin juin. Par ailleurs, les procédures du Tribunal révolutionnaire étaient expéditives parce que les détenus devaient être pré-jugés par les Commissions populaires, instruments des lois de ventôse. Or non seulement les Comités de salut public et de sûreté générale rechignaient à instituer les quatre autres Commissions prévues mais ne validaient même pas les listes dressées par les Commissions en vigueur. Le sabotage des lois de ventôse sur la distribution des biens des condamnés aux indigents et le détournement de la loi du 22 prairial furent la raison profonde de la rupture entre Robespierre et ses collègues des Comités.
A ce désaccord de fond s’en ajoutaient d’autres. Le Comité n’étant plus menacé de l’extérieur par les factions, ses membres donnèrent de plus en plus libre cours à leurs divergences sur le plan militaire, social, politique ou personnel. Carnot conduisait seul la guerre et voulait une guerre de conquête, alors que Robespierre désirait y mettre fin dès que le territoire serait libéré, ce qui était sur le point d’être réalisé. Par ailleurs, Robespierre voulait modérer la Terreur et était exaspéré par les arrestations tous azimuts. Il était cerné d’ennemis, visé par mille intrigues et désespérait de rencontrer une opposition systématique chez ses collègues des Comités. Ne pouvant plus rien faire, il cesse, à partir du 1er juillet (13 messidor), de participer au Comité.
Cette absence de plusieurs semaines ne passe pas inaperçue, d’autant plus que Robespierre en expose les motifs aux Jacobins. Pour se réconcilier avec lui, les Comités ratifient les listes des Commissions populaires les 2 et 3 thermidor (20 et 21 juillet) — ils en font même porter une chez lui, qu’il signe — et décident la création des quatre dernières Commissions le 4 thermidor. Le 5 thermidor, Robespierre assiste à la séance des Comités. Mais il ne croit pas en leur bonne foi. Il sait que le Comité de sûreté générale a pris des contacts avec les Girondins détenus (qui d’ailleurs lui doivent la vie). Il sait que Fouché complote contre lui, qu’il répand des listes de proscription présentées comme son ouvrage. Il sait que ses ennemis sont nombreux et unis par leur haine contre lui. Il sait que, s’ils l’emportent, la Révolution est perdue. Il prend l’initiative d’attaquer, à découvert comme il l’a toujours fait. Il n’a pas d’autre choix de toute façon.
Le 8 thermidor, il se présente à la Convention armé d’un discours qu’il appelle lui-même son testament de mort. Il dénonce tous les disfonctionnements du gouvernement, tous les excès de la Terreur, toutes les intrigues, tous les coups bas dont il est l’objet, tous les dangers qui menacent la République. L’impression de son discours est décrétée. Mais les hommes qu’il a dénoncés à demi-mot font rapporter le décret. Le soir, aux Jacobins, il relit son discours qui transporte l’assemblée d’émotion. Il reprend confiance. Mais, pendant ce temps, ses ennemis, les hommes de sang et de rapines, rallient les bourgeois du Marais en leur promettant tout et son contraire et adoptent une tactique pour le lendemain : l’empêcher de parler.
Le 9 thermidor, c’est Saint-Just qui monte à la tribune pour lire un rapport (modéré) qu’il a eu le tort de ne pas présenter à ses collègues. A peine a-t-il prononcé quelques phrases que Tallien l’interrompt. Le signal est donné. La meute se déchaîne. Les ennemis de Robespierre se succèdent à la tribune sans qu’il puisse leur répondre. Le voyant lynché, son frère insiste pour partager son sort. Lebas se joint à eux. Ils sont tous décrétés d’arrestation, ainsi que Couthon.
Quand la Commune apprend cette nouvelle incroyable, elle se proclame aussitôt en insurrection, non contre la Convention, mais contre les députés corrompus. Elle sonne le tocsin et fait battre la générale. Elle réunit des milliers d’hommes des faubourgs. Elle parvient à faire libérer les députés arrêtés, surpris par cette mobilisation. Mais elle hésite à marcher sur la Convention qui se ressaisit et réunit des troupes de son côté. Robespierre temporise. Il n’a jamais été dictateur et ne veut pas en devenir un malgré lui. Il avait prédit sa mort depuis longtemps et sait que la Révolution est dans une impasse, que les temps ne sont pas mûrs pour un ordre des choses plus juste. Aussi, bien qu’il ait fini par rejoindre l’Hôtel de Ville, il n’agit pas, pas plus que ses amis qui ont conduit les armées de la République à la victoire. Laissées sans ordre et effrayées par la mise hors la loi dont sont frappés les rebelles, les troupes de la Commune finissent pas se disperser. Surgissent alors les troupes de la Convention qui embarquent tout le monde. Lebas s’est tiré une bale dans la tête. Robespierre aussi, mais s’est manqué et a la mâchoire fracassée. Son frère s’est jeté du premier étage et s’est estropié. Couthon, paralytique, a chuté dans des escaliers et est à moitié mort.
Le lendemain, Robespierre est guillotiné avec 21 de ses partisans. Les deux jours suivants, 82 municipaux, administrateurs de police, cadres de la garde nationale et Robespierristes divers sont exécutés. La Commune est anéantie. La Révolution, au sens social du terme, est terminée. La bourgeoisie capitalo-libérale reprend les rênes du pouvoir et ne les lâchera plus. La Terreur change de camp.
Résumant les pensées de beaucoup de ses contemporains, Cambon, chargé des finances sous la Convention, attaqué personnellement par Robespierre le 8 thermidor, dira plus tard : « Nous avons tué la République au 9 thermidor, en croyant ne tuer que Robespierre ! Je servis à mon insu les passions de quelques scélérats. Que n’ai-je péri, ce jour-là, avec eux ! la liberté vivrait encore ! »
Philippe Landeux
Janvier 2011
Exemple de désinformation : Le Petit Larousse illustré (1998)
Sont marqués en gras les mots et les passages tendancieux qui dénaturent le rôle et le caractère de Robespierre.
ROBESPIERRE (Maximilien de) :
Arras 1758 – Paris 1794, homme politique français. De petite noblesse, orphelin, il est d’abord avocat à Arras. Député aux Etats Généraux, orateur influent puis principal animateur du club des Jacobins, surnommé l’« Incorruptible », il s’oppose fermement à la guerre. Membre de la Commune après l’insurrection du 10 août 1792, puis député à la Convention, il devient de le chef des Montagnards. Hostile aux Girondins, il provoque leur chute (mai-juin 1793). Entré au Comité de salut public (juill.), il est l’âme de la dictature, affirmant que le ressort de la démocratie est à la fois la terreur et la vertu ; il élimine les hébertistes (mars 1794) et les indulgents menés par Danton (avr.), puis inaugure la Grande Terreur (juin). Enfin, il impose le culte de l’Etre suprême (8 juin). Mais une coalition allant des membres du Comité de salut public aux conventionnels modérés décide le 9 thermidor an II (27 juil. 1794) de mettre fin aux excès de Robespierre, qui est guillotiné le 10 thermidor avec ses amis Saint-Just et Couthon.
12:49 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : robespierre, histoire | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |