mardi, 22 janvier 2013
LES LIMITES DE LA DEMOCRATIE
« Jamais dans une monarchie, l’opulence d’un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince ; en revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. »
Jean-Jacques Rousseau, lettre à d’Alembert
Il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas en démocratie. Malgré les partis politiques et les médias dominants qui parlent à longueur de temps de défendre la démocratie, qui nous vendent la « démocratie » représentative comme la panacée de la démocratie, de plus en plus de gens réalisent que notre système n’a rien de démocratique.
La démocratie ne consiste pas à avoir le droit de voter, une fois tous les cinq ans, pour des personnes que l’on n’a pas choisi de présenter et qui, une fois en poste, auront le droit à peu près illimité d’agir à leur guise. La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Il n’y a de souverain que le peuple. Il n’y a de constitutionnelle que la volonté du peuple. Tout subterfuge permettant de mettre une volonté particulière à la place de la volonté du peuple est un crime de lèse-nation. Prétendre qu’un système politique fondé sur un pareil crime est démocratique est une escroquerie.
Un des pères de la démocratie, Jean-Jacques Rousseau, a écrit : « La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. » (Du Contrat Social, Livre III, Chap. 15, Des députés ou représentants) Ces idées furent portées notamment par Marat, assassiné, et Robespierre, exécuté. Elles furent inscrites dans la constitution de 1793, enterrée avec Robespierre.
Déjà la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, rédigée par une assemblée aristo-bourgeoise, nia le principe en faisant mine de l’adopter. L’article 3 porte : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Jusque-là tout va bien. Mais l’article 6 stipule : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. » Cet ajout anodin renverse tout l’édifice. Il suffit en effet d’instituer de soi-disant représentants du peuple sans laisser aux citoyens de moyens constitutionnels de concourir personnellement à la formation des lois ou de s'opposer légalement à l'ouvrage des élus pour que le système politique soit exclusivement représentatif, la souveraineté confisquée et la volonté du peuple nulle. Or la même Assemblée adopta le 10 août 1791 l’article « constitutionnel » suivant : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible ; elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ; mais la nation, de qui émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. » Toujours ce mélange de belles intentions et d'arnaque. Robespierre protesta : « On ne peut dire que la nation ne peut exercer ses pouvoirs que par délégation ; on ne peut dire qu’il y ait un droit que la nation n’ait point. On peut bien régler qu’elle n’en usera pas, mais on ne peut pas dire qu’il existe un droit dont la nation ne peut pas user si elle le veut. » Vaine protestation. Le peuple et les principes n’ont que peu de défenseurs parmi les ci-devant nobles, les bourgeois, les nantis, ceux qu’à l’heure de la novlangue nous appelons les élites. L’esprit du système adopté alors perdure de nos jours. La fallacieuse Déclaration de 1789 est le préambule de la constitution de la Ve République. Ainsi les Constituants ont institué un système qui n’était pas démocratique, et leurs successeurs ont eu l’impudence de l’appeler « démocratie ».
Toute l’astuce de cette pseudo démocratie repose sur l’octroi aux « citoyens » d’un droit de vote illusoire. Les citoyens ne votent rien ; ils élisent. Et ils n’élisent pas qui ils veulent, mais qui est candidat. Or être candidat n’est pas à la portée du premier venu, mais seulement des hommes de parti et d’argent. Les programmes présentés par les candidats, d’après lesquels les électeurs sont censés les départager, ne sont pas moins illusoires puisqu’il n’y a pas de mandat impératif, puisque le mandat impératif est même illégal en France. Le mandat impératif consiste à être mandaté, c’est-à-dire élu, pour accomplir une chose bien précise. L’absence de mandat impératif signifie donc que les élus ne sont tenus en rien d’appliquer leur "programme", qu’ils sont même libres de faire tout le contraire. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ! L’élection ne légitime donc pas les actes des élus. Ceci est évident s’ils trahissent leurs promesses. Mais elle ne les légitime pas non plus s’ils les tiennent toutes. En effet, comment savoir si les électeurs étaient d’accord avec l’ensemble des mesures proposées ? Peut-être étaient-ils malgré tout en désaccord avec certaines ! Peut-être même ont-il « voté » que par défaut ! Une élection ne vaut pas référendum. Elle n’autorise pas les élus à faire ce qu’ils ont annoncé et moins encore à improviser. Dans les deux cas, cela reviendrait à remplacer en tout ou partie la volonté du peuple par celle des élus, ce qui est par définition contraire à la démocratie.
Remarquons bien que les élections reposent sur le principe de la souveraineté du peuple : les élus tirent leur légitimité du vote populaire. Mais, dans les conditions actuelles, elles violent aussitôt ce même principe, puisque les élus sont indépendants du peuple. Autrement dit, les élus estiment que le peuple fait de bons choix quand il les désigne, mais ferait des choix malheureux s’il était davantage impliqué dans la chose publique. Quelle hypocrisie ! Ils le courtisent pour accéder aux fonctions publiques et le traitent de bon à rien sitôt en place. Par suite, ils accusent les vrais démocrates de populisme, c'est-à-dire de démagogie.
Remarquons également que des mandats à durée déterminée et longs excluent le principe du mandat impératif car les élus, confrontés à la réalité des problèmes, sont tôt ou tard obligés d’improviser. Il est donc évident que l’élection justifie à peine les nominations et ne légitime en rien les actes. Dès lors qu’un peuple immense ne peut gérer ses affaires sans une forme de représentation et doit procéder à des élections, il faut en tenir compte. Des référendums sur certains sujets doivent être obligatoires de par la constitution, les citoyens doivent pouvoir en provoquer à volonté et des contre-pouvoirs populaires (non composés d’élus mais de citoyens nombreux tirés au sort, pour échapper aux vices de l’élection) doivent être prévus afin que le peuple, quand il ne décide pas lui-même, puisse au moins ratifier ou s’opposer aux décisions des élus et les faire ainsi siennes. On voit qu’il est facile de pallier aux inconvénients de l’élection. L’absence de tels contre-pouvoirs est donc voulue et a pour but de favoriser et même d’organiser l’abus de pouvoir.
En résumé, la démocratie est le système politique dans lequel les lois et les actes du pouvoir exécutif sont l’ouvrage direct du peuple (ensemble des citoyens admis au droit de cité) ou l’objet de son consentement explicite.
C’est en parvenant à de telles conclusions que certains prônent comme solution miracle l’établissement de la démocratie directe. (Cette expression qui se veut le pendant de démocratie représentative est une double maladresse puisqu’elle qualifie inutilement la démocratie et valide de ce fait le caractère soi-disant démocratique du système soi-disant représentatif.) Il est certain que cela fait partie de la solution et qu’une Révolution digne de ce nom l’instaurerait. Mais peut-on se contenter d’un tel projet ? Est-il seulement envisageable dans le contexte actuel ?
Comment instaurer la démocratie quand le système est verrouillé et est parvenu à faire croire à la plupart des gens qu’ils sont déjà en démocratie ? Sans un soulèvement, c’est un vœu pieux. Les apparatchiks n’y consentiront jamais, ils écraseront les bons apôtres et quand bien même ces derniers échapperaient à leurs coups et parviendraient à rallier l’opinion publique, le peuple est nul dans ce système. Le peuple ne s’exprime que lorsqu’il y est invité, sur des questions imposées, et pour répondre comme on lui dit. Le système peut, au choix, ne pas l’interroger ou s’asseoir sur sa réponse si elle ne convient pas, comme en 2008 avec le référendum de 2005.
Mais, admettons que cette revendication sortent les Français de leur léthargie et qu’une vague d’indignation populaire ébranle le gouvernement qui dispose de toutes les forces de répression et terrifie les élites qui disposent de tous les moyens de lobotomisation. Admettons que le système consente à instaurer une véritable démocratie, à laisser la parole au peuple. Aurait-il pour autant le pouvoir en dernière analyse ? Certes le pouvoir politique confère du pouvoir. Mais, dans un système monétaire, le véritable pouvoir est conféré par Largent, et il y a nécessairement des riches qui l’ont et des pauvres qui le subissent. Des pauvres dotés de pouvoir politique n’en demeurent pas moins pauvres. Or, si l’égalité politique n’apporte pas l’égalité économique (impossible dans un système monétaire de par les lois de Largent et le fonctionnement de la monnaie), quel est l’intérêt ? qu’y a-t-il de réellement changé, en admettant que ce changement superficiel soit possible ? Sans doute la démocratie proscrirait-elle certains abus et réduirait-elle les inégalités à coup d’interdictions, de prélèvements et de redistribution. Ceci n’est pas négligeable. Il reste que la marge de manœuvre du peuple serait étroite et que son pouvoir atteindrait vite sa limite.
Alors, trois politiques s’offriraient en théorie : 1) se contenter d’un plus faute de mieux et laisser les riches dominer économiquement, 2) écraser les riches, donc maintenir tout le monde dans la pauvreté, 3) faire la révolution, c’est-à-dire renverser Largent au nom de l’Egalité (le comment n’est pas le sujet de cet article). Mais la logique purement démocratique n’est pas en soi révolutionnaire et dénote un manque d’audace intellectuelle. Elle est plus tournée vers le passé (nostalgie de la Grèce antique) que vers l’avenir. Elle mise tout sur la volonté et l’omnipotence de l’Homme et néglige l’existence et le pouvoir de Largent. De ces trois choix théoriques, il n’en resterait que deux et en réalité qu’un seul, qui ne serait donc plus un choix mais une impasse.
En effet, la deuxième possibilité, écraser les riches, serait également du déjà vu. Le souvenir du communisme qui a toujours viré au drame et à la dictature condamnerait probablement le recours à une politique similaire. En supposant néanmoins que les hommes n’aient toujours pas retenu la leçon et proscrivent la richesse par un ensemble de mesures contre-nature (contre la nature du système monétaire), le système égalitariste, étatique, liberticide et sclérosé qui en résulterait s’effondrerait rapidement sous le poids de ses contradictions. Dans le meilleur des cas et avec beaucoup d’optimisme — car ce serait sans compter avec les dégâts moraux et économiques occasionnés —, lesdites mesures seraient abandonnées pour revenir à la première option. Il s’agirait, en somme, de ne plus peser sur les riches, donc de les laisser agir à leur guise et de faire leurs quatre volontés, donc d’admettre que les lois de Largent priment sur la volonté du peuple. La démocratie apparaîtrait alors pour ce qu’elle est dans ces conditions : une illusion. Et ce serait-là le meilleur des cas ! Dans le « pire », l’échec de la politique égalitariste démoraliserait le peuple autant qu’il regonflerait les riches qui se verraient offrir le pouvoir politique ou s’en empareraient de leur propre chef. Le système deviendrait ouvertement ploutocratique comme le veut l’ordre des choses. Or quand l’aristocratie de Largent est au pouvoir, Largent est roi par définition.
Reste donc la première option d’une authentique démocratie ne faisant pas de vagues, brassant de l’air, se voilant la face. Ne pouvant résoudre le problème fondamental de l’inégalité faute de s’attaquer à Largent, cautionnant même l’inégalité pour éloigner le spectre du communisme, elle ménagerait les riches et laisserait le peuple sur sa faim. Cet état conviendrait assez aux riches qui auraient le pouvoir — économique et indirectement politique, grâce aux moyens d’influence et de corruption que procure Largent — sans être exposés aux critiques, quoiqu’ils pourraient, à la faveur d’une crise inévitable, préférer la lumière de la scène à l’ombre des coulisses. De son côté, le peuple, déçu et las d’attendre, pourrait être tenté de se radicaliser contre les riches, ce qui, comme on vient de le voir, ne peut que ramener, à terme, au point de départ.
Ainsi, par quelque bout que l’on prenne le problème, un système monétaire est toujours in fine à l’avantage des riches, quelle que soit la forme du gouvernement. La démocratie seule est un piège. Non seulement elle n’est pas en elle-même une réponse aux problèmes concrets, mais son incapacité à les résoudre ne peut que susciter le rejet de son principe. C’est là la grande faute des chantres de la démocratie : en misant tout sur elle dès aujourd’hui, en espérant qu’elle aura le génie qu’ils n’ont pas, ils lui confient une mission vouée d’avance à l’échec et usent une bonne cartouche à mauvais escient. En fait, ils mettent la charrue avant les bœufs.
L’idée des démocrates est que la démocratie permettra, grâce à des lois de plus en plus justes, d’instaurer petit à petit l’Egalité, de réaliser l’égalité sur le plan économique comme elle est sensée l’avoir déjà réalisée sur le plan politique. Mais ceci est une vue de l’esprit !
D’une part, aspirer à l’Egalité signifie que l’Egalité n’est pas et que les hommes ne savent pas en quoi elle consiste. S’ils le savaient, s’ils savaient pourquoi elle n’est pas et comment l’instaurer, ils l’instaureraient eux-mêmes au lieu de la renvoyer à la Saint-Glinglin et de compter qui sur l’évolution, qui sur la révolution permanente, qui sur les petits bonshommes verts. D’autre part, attendre de la démocratie qu’elle apporte un jour l’Egalité prouve que l’inégalité règne présentement et que, dans ces conditions, il n’y a pas de véritable démocratie, puisque le pouvoir réel est fatalement détenu et exercé ouvertement ou discrètement par les bénéficiaires de l’inégalité qui ne travailleront évidemment jamais à instaurer l’Egalité. Un système égalitaire serait démocratique par la force des choses. Mais un système intrinsèquement inégalitaire est oligarchique voire tyrannique par définition et malgré les apparences dont le peuple est dupe. Voilà les raisons théoriques pour lesquelles espérer que la démocratie apporte l’Egalité est une vue de l’esprit.
Même si une véritable démocratie était possible dans l’inégalité, elle n’apporterait jamais l’Egalité car les démocrates utopiques la considèrent eux-mêmes comme une chimère. Ils veulent moins d’inégalités (au nom de quoi si ce n’est de l’Egalité ?), mais n’osent pas exiger l’Egalité elle-même. Pourquoi ? Parce qu’ils n’y croient pas. Parce qu’ils font des vérités du système monétaire des vérités absolues. Parce qu’ils subordonnent les Principes à Largent auquel ils se soumettent sans même en avoir conscience. Deux exemples :
Les articles 13 et 15 de la Déclaration de 1789, qui sert toujours de référence, portent : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. » Ces deux articles entérinent Largent sans discussion et affirment que le système est et sera à jamais monétaire. L’idée que Largent soit antisocial et incompatible avec l’Egalité proclamée par ailleurs n’a pas effleuré les législateurs d’antan, pas plus que cela n’empêche les contemporains de dormir. Que le système monétaire réduise cette Déclaration à un ramassis de foutaises n’interpelle apparemment personne.
Deuxième exemple. « Loin de regarder la disproportion énorme des fortunes qui place la plus grande partie des richesses dans quelques mains, comme un motif de dépouiller le reste de la nation de sa souveraineté inaliénable, je ne vois là pour le législateur et pour la société, qu’un devoir sacré de lui fournir les moyens de recouvrer l’égalité essentielle des droits, au milieu de l’inégalité inévitable des biens. » (décembre 1790) « Il ne fallait pas une révolution sans doute, pour apprendre à l’univers que l’extrême disproportion des fortunes est la source de bien des maux et de bien des crimes ; mais nous n’en sommes pas moins convaincus que l’égalité des biens est une chimère. » (24 avril 1793) Ainsi pensait et parlait Robespierre qui était pourtant le champion de l’Egalité. Il n’a pas vu ce qui pourtant crève les yeux : « l’inévitable inégalité des biens » à laquelle il fait allusion renvoie en réalité à la monnaie qui permet aux individus d’acquérir des biens selon leurs facultés financières, mais qui, de par sa nature et son fonctionnement, se répartit fatalement inégalement entre eux. Autrement dit, l’« inévitable inégalité des biens » n’est que le reflet de la « fatale inégale répartition de la monnaie ». Déclarer que l’égalité en biens est impossible, ce qui est vrai en soi, n’est donc ici qu’un moyen inconscient de cautionner le système monétaire et l’inégalité tout court. De même, dénoncer l’« extrême inégalité des fortunes » et sous-entendre que l’on aspire à moins d’inégalités semble progressiste alors que c’est admettre malgré tout le principe de l’inégalité et cautionner inconsciemment Largent qui en est la cause.
Tout le monde suit le même raisonnement. Les idées sur ce point n’ont pas avancé d’un pouce depuis la Révolution. Ce n’est pas parce que Largent n’est pas un problème qu’il n’est pas dénoncé, mais parce qu’il fait partie des meubles, parce qu’il passe pour un paramètre naturel et éternel alors qu’il est conjoncturel (La notion de valeur marchande est liée au mode de production artisanal qui ne permet pas un autre mode d’échange que le troc direct ou indirect via la monnaie.), parce que ses mécanismes et ses conséquences ont été intégrés et transformés en préjugés et, au final, parce que les hommes, prisonniers de sa logique, ne conçoivent aucune alternative, c’est-à-dire une forme d’échange conforme, et non plus contraire, aux Principes de l’ordre social. Négliger ce paramètre fausse tous les raisonnements. Agir sans tenir compte du fait que le système monétaire a des incidences condamne à tourner en rond, comme en prison, et à tirer des plans sur la comète. Qu’on le veuille ou non, Largent est la limite ou le facteur limitant non seulement de la démocratie mais encore de toute mesure concernant de près ou de loin la société.
Occulter le problème ne le résout pas. On ne peut pas éradiquer tout ou partie des conséquences de Largent, dont l’inégalité, sans anéantir Largent lui-même. Le croire et poursuivre des leurres est soit de l’aveuglement, soit de la lâcheté, soit de la mauvaise foi, dans tous les cas de la bêtise car il est d’avance certain que cela ne mènera à rien, des siècles d’expérience en attestent. Or le but de la politique est précisément de résoudre ces problèmes. Proposer des réformes institutionnelles de quelque nature que ce soit — démocratiques ou autre — sans assigner aux nouvelles institutions la mission d’anéantir Largent pour instaurer l’Egalité, voire faire de telles propositions pour justement détourner l’attention de Largent et le conserver, est une entreprise artificielle et dilatoire. C’est la politique du coup de peinture. C’est la position de tous les profiteurs du système. C’est depuis toujours l’erreur des amis du peuple.
De même qu’une Constitution organise les pouvoirs publics pour garantir les droits reconnus dans la Déclaration, une organisation politique est un moyen pour mettre en œuvre une politique, elle n’est pas un but en soi. Proposer simplement une réorganisation politique ne répond donc pas à la question : pour quoi faire ? Mais ne pas répondre à cette question n’est-il pas l'intérêt de ceux qui n’y répondent pas ? Qui regarde Largent comme l’ennemi à abattre a tout à refonder, d’abord sur le plan économique, et considère l’organisation politique à mettre en place à terme comme une chose importante, certes, mais secondaire. En revanche, En revanche, qui parle exclusivement d’organisation politique ou de tout autre chose que Largent sera à coup sûr réduit à l’impuissance et au charlatanisme, il tournera autour du pot comme ses prédécesseurs, et mieux vaut pour lui ne pas voir aussi loin ni en dire trop.
Ce discours ne répond sans doute pas à toutes les questions, notamment à celle concernant la façon de procéder pour anéantir Largent. Comment s’y prendre (cf. le Civisme) ? Qui prendra la décision ? dans quelles circonstances ? Personne ne peut prévoir les conditions exactes d’une révolution — car il s’agirait bien d’une révolution, la plus grande de l’Histoire, celle tant attendue. Tout ceci n’est au fond qu’un détail. Comme le disait Victor Hugo : « Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c’est une idée dont l’heure est venue ». Quand les opinions auront massivement évolué — et il appartient à tous les gens éclairés et courageux de diffuser leurs lumières —, des circonstances favorables se présenteront tôt ou tard, la révolution éclatera sans coup férir et Largent tombera comme un fruit mûr. Alors, pour la première fois, la révolution tiendra ses promesses. Mais il n’y aura pas de révolution sans révolutionnaires.
Philippe Landeux
02 janvier 2012
17:49 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : démocratie, limites | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 04 février 2012
PENSEE DU JOUR : le monde à l'envers
De nos jours, qui est contre le mondialisme et le capitalisme, pour la nation et la démocratie, est traité de facsiste par ceux qui sont contre la souveraineté du peuple, pour l'euro-mondialisme et l'ultra-libéralisme (liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des hommes). Mais que sont ces derniers ? des démocrates ? des révolutionnaires ? Non, des traîtres en sursis.
12:00 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.6. sur les TRAITRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mondialisme, capitalisme, fasciste, démocratie, souveraineté | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 19 décembre 2011
UNE VRAIE DEMOCRATIE
ATTENTION : L'organisation politique ci-après n'a de sens que dans une Cité, c'est-à-dire dans un système non-monétaire dans lequel les Citoyens sont réellement égaux en Devoirs et en Droits, dans lequel ils jouissent tous d'un droit indéfini d'accéder au marché et, enfin, dans lequel Citoyenneté et Nationalité sont deux notions distinctes et bien définies, chacune impliquant des devoirs et conférant des droits. Il est impossible d'instaurer une véritable démocratie dans l'inégalité, au milieu d'hommes corrompus et corruptibles, quand les intérêts particuliers s'opposent à l'intérêt général. Il est même dangereux de l'établir alors que la "nationalité" ne veut rien dire et que, de ce fait, les droits politiques ne sont pas le monopole des patriotes, c'est-à-dire des Citoyens fidèles à la Nation, ardents à préserver son identité et sa souveraineté.
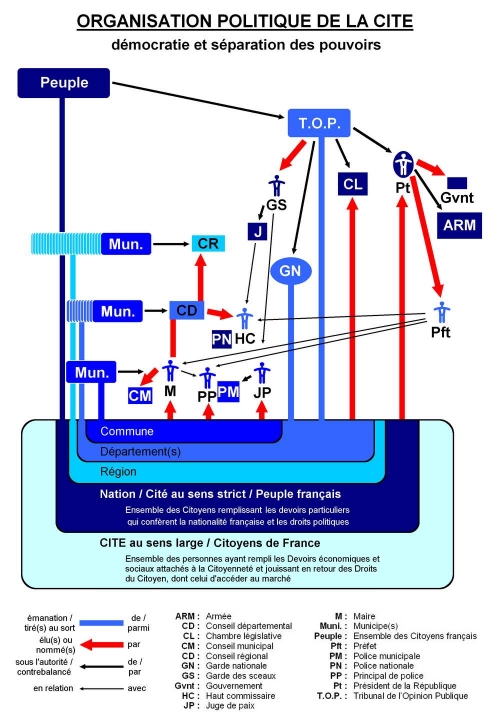
Lire le texte explicatif

Lire le texte explicatif
12:10 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vraie, démocratie, schémas, civisme, cité | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 11 novembre 2011
PENSEE DU JOUR : le nouveau démocrate
Le démocrate des temps moderne est contre les référendums et pour le droit de vote des étrangers. Il crache sur son peuple, bade les "experts" et sacralise les immigrés. Il fait de la préférence étrangère la priorité nationale. C'est un traître à la nation. Dans une véritable démocratie, il serait pendu ou pour le moins chassé.
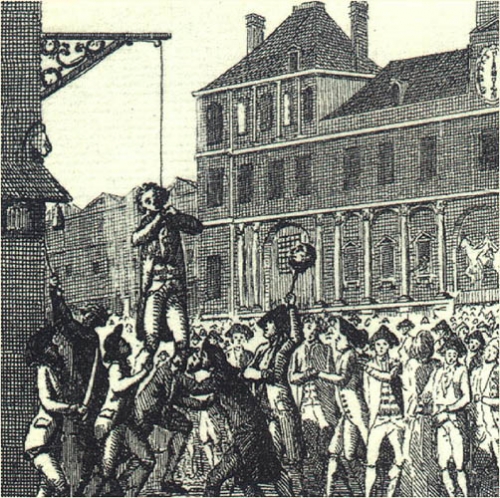
Foulon de Doué, pendu le 22 juillet 1789
à la lanterne de la place de Grève,
en face de l'Hôtel de Ville
15:00 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.6. sur les TRAITRES, 8. GAUCHERIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, démocrate, traître, préférence, nationale, nation | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 05 novembre 2011
PENSEE DU JOUR : la mascarade
- immigration massive
- naturalisation des immigrés
- régularisation des clandestins
- préférence étrangère
- droit de vote des étrangers
Arrêtons la mascarade ! Ne consultons plus les Français. Ne faisons plus venir d’immigrés. Organisons les élections directement et exclusivement à l’étranger pour que les choses soient claires et puisque c’est, en définitive, le but des immigrationnistes et sera, à terme, le résultat de l’immigration.
Mais suis-je bête ! Les oligarques font déjà mieux. Ils ont mis la France sous tutelle de commissions non élues et la vendent par petits bouts.
15:01 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.6. sur les TRAITRES, 7.7. sur l'IMMIGRATION | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : immigration, immigrationnisme, immigrés, souveraineté, démocratie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 15 octobre 2011
ORGANISATION POLITIQUE DE LA CITE
ATTENTION : L'organisation politique ci-après n'a de sens que dans une Cité, c'est-à-dire dans un système non-monétaire dans lequel les Citoyens sont réellement égaux en Devoirs et en Droits, dans lequel ils jouissent tous d'un droit indéfini d'accéder au marché et, enfin, dans lequel Citoyenneté et Nationalité sont deux notions distinctes et bien définies, chacune impliquant des devoirs et conférant des droits. Il est impossible d'instaurer une véritable démocratie dans l'inégalité, au milieu d'hommes corrompus et corruptibles, quand les intérêts particuliers s'opposent à l'intérêt général. Il est même dangereux de l'établir alors que la "nationalité" ne veut rien dire et que, de ce fait, les droits politiques ne sont pas le monopole des patriotes, c'est-à-dire des Citoyens fidèles à la Nation, ardents à préserver son identité et sa souveraineté.
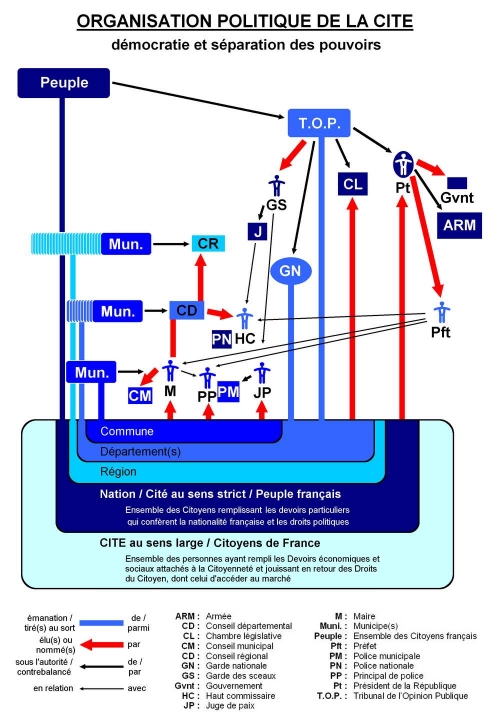
La Cité au sens large est l’ensemble des Citoyens. Elle ne se confond pas avec la population de France qui, elle, comprend les enfants et les non-Citoyens, lesquels sont sous la protection voire à la charge de la Cité.
La Cité au sens strict, la Nation, le Peuple français, est l’ensemble des Citoyens de France ayant désiré et mérité la Nationalité française.
Les simples Citoyens de France, nés en France ou d’origine étrangère, n’ont aucun droit politique mais n’en sont pas « privés » : ils ont choisi en connaissance de cause de ne pas s’acquitter des devoirs particuliers qui confèrent la Nationalité à laquelle sont attachés les droits politiques. Ils ont jusqu’à l’âge de 40 ans pour choisir.
Le peuple, c’est-à-dire les Citoyens de nationalité française, est souverain à tous les niveaux. Entraver la liberté d’action et de parole des Citoyens français comme usurper des droits politiques est sévèrement puni.
Au niveau communal :
Chaque Commune élit son Maire (M), qui s’entoure d’un Conseil municipal (CM), et le Principal de Police (PP), chef de la police municipale (PM). Le Maire, élu pour 10 ans, n’a pas autorité sur le Principal, élu pour 5 ans, mais ils sont néanmoins en relation. Ils sont tous les deux en relation avec le Préfet (Pft), représentant de l’Etat au niveau départemental.
Les arrondissements électoraux sont appelés « Municipes ». Chaque Municipe dispose d’un lieu où les électeurs, c’est-à-dire les Citoyens français résidants, peuvent se réunir à volonté. Leurs séances sont ouvertes au public qui ne peut cependant ni intervenir ni prendre part aux votes. Tous les Municipes de la Commune, du Département, de la Région et de France peuvent entretenir des relations entre eux afin de provoquer des référendums (selon les règles établies par la Constitution) aussi bien au niveau communal, pour contrer la politique du Maire ou lui imposer des mesures, que départemental, pour contrer ou forcer le Conseil départemental (CD), qu’au niveau régional, pour contrer ou forcer le Conseil régional (CR). La même chose est possible en théorie au niveau national, mais les décisions conformes à l’opinion publique sont généralement prises autrement, avant que les Municipes aient le temps de provoquer un référendum.
Les Municipes élisent en outre, tous les 5 ans, un Juge de paix (JP) chargé de connaître toutes les affaires relevant de la Justice (J) et de régler les conflits à l’amiable autant que faire se peut. Il est en relation avec les pouvoirs judiciaires et a autorité sur le Principal.
Au niveau départemental et régional :
Tous les Maires d’un Département se réunissent au moins deux jours par mois et forment le Conseil départemental. Les Maires de chaque Département élisent 10 d'entre eux qui constituent avec les autres Maires des autres Départements de la Région, choisis de la même manière, le Conseil régional qui se réunit quand bon lui semble et élit, pour 10 sommets, un président de séance.
Communes, Départements et Régions ont en charge la gestion administrative de leurs territoires respectifs et peuvent adopter, chacun à leur niveau et sous réserve d’approbation populaire, des règlements et des lois qui ne dérogent pas aux lois nationales.
Le Conseil départemental élit ou nomme le Haut Commissaire (HC), responsable de la police nationale au niveau départemental. Le Haut Commissaire est désigné pour une durée indéterminée. Il est en relation avec le Préfet (Pft).
Les Députés à la Chambre législative (CL) sont élus au niveau départemental.
Tous les Citoyens français d’un Département ayant effectué un service national militaire sont réservistes pendant au moins 15 ans et forment la Garde nationale (GN), laquelle est naturellement en relation avec les autorités locales mais ne connaît d’autorité supérieure que celle du T.O.P..
Les Censeurs qui composent le Tribunal de l’Opinion Publique (T.O.P.) sont tirés au sort dans tous les départements (en proportion de leur population), parmi les Citoyens français ayant au moins 10 ans de Citoyenneté effective et étant volontaires pour siéger durant un an.
Au niveau national :
Le Peuple français est la base et le sommet de l’édifice. Lui seul peut modifier la Constitution approuvée par lui et décider par référendum les questions relevant de l’intérêt national. Il peut être appelé à se prononcer par le Président de la République (Pt), par le T.O.P., par les Municipes, par des pétitions ou par la Constitution.
Le T.O.P. est la plus haute institution de la Cité. Il n’est pas le Peuple, mais presque. Il prend ses décisions à une majorité de deux tiers. Son rôle premier est de valider ou de rejeter par défaut les lois proposées par la Chambre législative qui, de par leur nature et d’après la Constitution, ne doivent pas être obligatoirement soumises à référendum. Lui seul peut interpréter la Constitution. Il est un recours pour tout Citoyen victime d’abus ou d’injustice. Il a toute autorité sur tous les sujets dont il se saisit ; il a tous les pouvoirs pour faire ce que la Constitution ne lui défend pas expressément.
Le Garde des sceaux (GS), ministre de la Justice, est nommé pour une durée indéterminée par le T.O.P., de sorte qu’il est indépendant de tout autre pouvoir.
La Chambre législative a pour seule vocation d’élaborer des lois qui, pour entrer en vigueur, doivent être approuvées soit par le T.O.P. soit directement par le Peuple. Elle peut proposer des lois de sa propre initiative ou sur demande.
Seul le Président de la République (Pt), chef des armées (ARM), est élu au niveau national, pour un mandat de 10 ans non renouvelable. Il forme un Gouvernement à sa convenance (Gvnt) et nomme les Préfets. Il gouverne selon les lois et sous la vigilance du T.O.P. qui n’a pas à valider ses décisions mais peut, le cas échéant, s’y opposer. Le Président et son Gouvernement peuvent proposer des lois soit au T.O.P. soit directement au Peuple.
Ainsi les trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) sont réellement séparés. Ils ne sont pas mélangés sous prétexte de se contrebalancer. Il n’y a de contre-pouvoir, dans la Cité, que le Peuple souverain qui est la source de tout pouvoir.
08:49 Écrit par Philippe Landeux dans 5. SCHEMAS, 6. MON BLOG | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : organisation, politique, souveraineté, démocratie, président, gouvernement | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 07 octobre 2011
PENSEE DU JOUR : l’aristocratie
La démocratie, le gouvernement du peuple, est impossible sous Largent.
L’aristocratie, le gouvernement des meilleurs, est impossible par nature.
Aucun système ne peut permettre aux meilleurs de chaque discipline d’être élevés systématiquement au rang de maîtres et de former ensemble le gouvernement de la cité. (Cette idée, me semble-t-il, était celle d’Auguste Comte et du « positivisme ».) Le talent, le désintéressement, le désir de commander, l’art du commandement et le souci du bien commun qui sont les conditions de l’aristocratie au vrai sens du terme sont rarement réunis dans une même personne, de sorte que ne parviennent réellement au pouvoir, non pas les meilleurs, mais ceux qui, médiocres voire mauvais dans leur discipline, lui courent après et ne reculent devant rien pour y parvenir et s’y maintenir. Si l’aristocratie est officiellement le gouvernement des meilleurs, elle est fatalement l’empire des intrigants dénués de talent et assoiffés de pouvoir.
Talent et pouvoir sont des passions différentes. Les meilleurs en toute chose sont parmi ceux qui se consacrent à leur art avec passion. Mais la passion est absolue. Qui en est possédé lui sacrifie tout. Le fait d’être le meilleur, témoigne en soi d’une passion exclusive pour son sujet. Les meilleurs dans un domaine ne courent pas après le pouvoir et n’en ont probablement pas les qualités. Même s’ils étaient appelés, ils le refuseraient. Et s’ils acceptaient, d’autres deviendraient meilleurs qu’eux.
Ne parviennent donc au pouvoir que les arrivistes qui le désirent et lui sacrifient leur art. Or, pour le conserver, ils doivent se poser comme les meilleurs, puisqu’ils sont sensés l’être, et casser ceux qui les dépassent et pourraient leur faire ombrage. Ils imposent donc des modes pour être eux-mêmes à la page et étouffer le génie ; ils faussent les règles du jeu et vident les mots de leur sens pour régner par la tricherie et le mensonge ; ils substituent la morgue au talent et le politiquement correct à l’intérêt général.
Ainsi, sous l’empire des zélites autoproclamées qui s’auto-congratulent, l’aristocratie se transforme par la force des choses en médiocratie, en voyoucratie, en oligarchie, bref en aristocratie au sens classique et, à raison, péjoratif.
08:59 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.2. sur LARGENT, 7.4. sur la POLITIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aristocratie, démocratie, démocrature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 18 avril 2011
PENSEE DU JOUR : démagogues
Les démagogues ne sont pas ceux qui veulent l’Egalité et la démocratie qui doivent régner dans une Société digne de ce nom, mais bien ceux qui acceptent ou prônent l’inégalité au nom de Largent et défendent la tyrannie au nom de la Liberté.
20:30 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.2. sur LARGENT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démagogue, démagogie, largent, liberté, inégalité, démocratie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 14 mars 2011
PRINCIPES UNIVERSELS DE L’ORDRE SOCIAL
OU
LES BASES DE LA SOCIETE A USAGE UNIVERSEL
I. De la Société
II. Sécurité & universalisme
III. De l’Egalité
IV. De la Liberté
V. Participer à la vie de la Cité / Profiter des bienfaits de la Cité
VI. De la Propriété
VII. Des lois & de la Démocratie
VIII. Citoyenneté / Nationalité
IX. Gouvernement & régime politique
X. Définitions & conclusion
Tous les Principes de l’ordre social sont bafoués. Cela est inévitable dans un système monétaire (1). Mais, aujourd’hui, le désordre est encore aggravé par la perte du simple bon sens, ce bon sens populaire exprimé par les adages ancestraux. Certains ne jurent plus que par l’argent, d’autres par l’Humanité virtuelle ou l’Homme désincarné. Que le commun des mortels déraisonne passe encore ! Mais que l’aberration soit dans les lois elles-mêmes est pire que tout !
Il est temps de remettre un peu d’ordre dans les idées, en commençant par les idées élémentaires : Qu’est-ce qu’une Société ? Qu’est-ce qu’un Citoyen ? Qu’est-ce qu’un droit ? Un devoir ? Quels sont les Principes fondamentaux de l’ordre social ? Qu’est-ce qu’une loi ? Un législateur qui ne maîtriserait pas ces notions serait un charlatan tyrannique : non content de déblatérer en permanence, il condamnerait les autres à le suivre dans son délire et à être les instruments de leur perte. Quelque sujet de société que l’on traite, force est de reconnaître que ces notions sont aussi incontournables que les chiffres, les lettres, les notes ou les couleurs pour calculer, écrire, faire de la musique ou peindre, et que quiconque expose en la matière des conclusions qui supposent leur ignorance ou leur négation, conclusions qui sont donc fondées sur des sophismes et non sur les Principes, est un prodige de bêtise ou d’hypocrisie, dans tous les cas un fléau social.
I. De la Société
Qu’est-ce donc qu’une Société digne de ce nom ? (Il faut bien préciser « digne de ce nom » pour ne pas prendre pour tel ce que l’on désigne ainsi aujourd’hui et que l’on qualifie parfois de « société individualiste ».)
Le mieux, pour comprendre ce qu’est une Société, est de commencer par se demander ce qu’est son contraire : l’absence de Société, le règne de la solitude, du plus fort et du chacun pour soi, ce que les philosophes ont appelé l’état de Nature. Quoi que soit une Société, il va de soi que des individus qui n’en forment une sous aucun rapport vivent chacun de leur côté, s’assument seuls, ne peuvent compter que sur leurs propres forces pour se nourrir et se défendre, n’ont de compte à rendre à personne, ne sont à l’abri de rien, peuvent faire tout ce qu’une force supérieure ne les empêche pas, autrement dit pas grand chose ; ils ont de nombreuses obligations, mais aucune assurance, aucun droit ; le prix de leur liberté illusoire est d’être en permanence en danger et sans cesse aux aguets. Les raisons qui poussent des individus à s’unir pour échapper à l’état de Nature sont donc aussi évidentes que les avantages qu’ils cherchent à retirer des Sociétés qu’ils constituent.
Première remarque : Si des individus se constituent en Société, les Sociétés ne sont constituées que des individus qui ont fait le choix de s’unir. Ensuite, lorsqu’une Société est constituée, ne peuvent l’intégrer que les individus désireux de le faire et acceptés par ceux qui en font déjà partie. Ainsi, une Société est constituée d’individus d’une même espèce animale (voir la deuxième remarque) mais ne comprend pas nécessairement tous les individus de cette espèce. D’ailleurs, plus les individus de cette espèce sont nombreux, éparpillés et fatalement différents sous divers rapports moins le cas d’une Société unique est probable, et on peut même dire que, sans ennemi commun universel provenant d’un espace externe, il est impossible, car l’union est moins le fruit de la volonté que celui de la nécessité. Un ensemble se définit par opposition ; sans opposition, sans raison supérieure d’occulter les différences, il se divise. Il peut même, quand l’égoïsme l’emporte sur l’intelligence, être divisé alors que l’union s’impose.
Deuxième remarque : La Société proscrit certains rapports entre ses membres, mais elle ne peut réunir des individus par trop dissemblables et aux intérêts opposés. Un prédateur ne peut pas s’unir avec sa proie, et vice versa. Or les individus d’une espèce sont naturellement et inévitablement dans l’une ou l’autre de ces positions vis-à-vis des individus des autres espèces. Au mieux n’y a-t-il entre eux qu’indifférence tant qu’ils ne sont pas en concurrence. Inversement, la Société oblige ses membres à collaborer pour satisfaire leurs besoins vitaux : se nourrir, se défendre. L’union n’a donc de sens qu’entre individus se nourrissant des mêmes choses et exposés aux mêmes dangers. Si l’on ajoute le besoin de se reproduire, qui ne peut être assouvi qu’avec des individus de son espèce (génétiquement compatibles), voire de la même race (vivant à proximité et dotés des bons appâts de séduction), et si l’on observe que la famille est la plus petite forme de Société, il est indiscutable que les Sociétés ne peuvent être constituées, au début, que d’individus de la même race et, dans tous les cas, appartenant à la même espèce. (2)
Troisième remarque : Dans l’état de Nature règne la loi du plus fort. C’est donc pour être moins faibles que les individus unissent leurs forces. Une Société est une force collective destinée à soutenir les rapports de force avec le reste du monde. Cette force collective peut être employée à tort ou à raison, par intérêt objectif ou mauvais calcul, pour se défendre ou attaquer, pour bâtir ou détruire ; elle peut être contenue, surpassée, écrasée, mais il ne sert à rien, aux faibles, de la dénoncer au lieu de se renforcer et de la combattre, et, aux forts, de la condamner après l’avoir vaincue, puisque seule la force fait loi et que la victoire a déjà tranché.
Quatrième remarque : Les individus se constituent en Société pour échapper à l’état de Nature. Il s’établit donc entre eux de nouveaux rapports, mais eux et leur Société sont toujours dans l’état de Nature vis-à-vis de tout ce qui les entoure. Ainsi, tant que les individus d’une même espèce ne constituent pas une seule Société, les diverses Sociétés sont entre elles dans l’état de Nature : les faibles agissent avec prudence faute de mieux, les fortes et celles qui se croient telles agissent en maîtres, bons ou mauvais. Même une Société unique serait encore dans l’état de Nature vis-à-vis du reste de la nature. Les rapports que des hommes établissent entre eux ne concernent qu’eux ! Les Sociétés et l’appartenance à une Société n’arrêtent pas les agressions isolées ou massives des autres animaux et n’empêchent pas les éléments de se déchaîner.
Cinquième remarque : Le plus grand inconvénient de l’état de Nature est d’être en permanence en danger de mort, ce qui, pour des êtres vivants, n’est pas la moindre des choses. Il s’ensuit que le plus grand bienfait que des individus recherchent en se constituant en Société est, non pas l’immortalité, mais une plus grande sécurité. On peut donc dire que des individus se constituent en Société par instinct de conservation.
Sixième remarque : Dans l’état de Nature règne la force. Il s’ensuit que les rapports entre individus appartenant à une même Société ne reposent pas sur la force, mais sur ce que les hommes appellent le droit, c’est-à-dire sur des conventions au moins tacites que tous les membres de la Société reconnaissent, respectent et garantissent. L’état de droit est le contraire de l’état de Nature. Or nous avons vu qu’une Société est dans l’état de Nature vis-à-vis de tout ce qui l’entoure. Le droit international est donc illusoire : c’est une belle fiction qui ne résiste pas aux coups de force. Chassez le naturel…
Ces remarques permettent de cerner ce qu’est une Société, mais pas de la définir convenablement. (C’est l’erreur des philosophes du XVIIIe siècle, et de Rousseau en particulier, d’avoir procédé ainsi mais de s’être arrêtés à ce stade.) Pour ce faire, il faut pousser plus avant la réflexion, lire entre les lignes et tirer toutes les conséquences logiques de l’union vitale, c’est-à-dire de l’association politique.
II. Sécurité & universalisme
Si des individus se constituent en Société pour accroître leur sécurité, la Société a le devoir de les protéger afin que la Sécurité leur soit garantie en tant que droit. Cette Sécurité qui consiste à ne pas être agressé par d’autres membres et à être défendu contre des ennemis extérieurs est à la mesure des moyens de la Société.
Conséquences :
1) La Sécurité est un droit fondamental et le premier des droits.
2) Les droits fondamentaux découlent de l’acte d’association politique et sont invariables d’une Société à une autre (c’est uniquement dans ce sens qu’ils sont universels), puisque toutes les Sociétés ont la même raison d’être.
3) Il appartient à chaque Société de garantir et d’étendre la portée des droits de ses membres.
4) L’étendue d’un droit — sa garantie et ses déclinaisons — est fonction de l’espèce des individus et des capacités de la Société, donc aussi de l’époque en ce qui concerne les hommes.
5) Les Principes de l’ordre social sont universels, mais leur application est locale, nationale.
6) Les droits reconnus et garantis à l’intérieur d’une Société sont nuls et non avenus à l’extérieur, ou du moins illusoires.
7) Il n’y a de droits qu’en Société, puisqu’elle seule peut en reconnaître et les garantir.
III. De l’Egalité
Maintenant, puisque la Société doit garantir la Sécurité de ses membres, et vu qu’elle se confond avec eux, c’est en définitive à eux, les membres, les Citoyens, de la garantir.
Conséquences :
8) La Sécurité d’un Citoyen est le fait, non de ses moyens de défense personnels, mais de la protection que ses Concitoyens lui assurent.
9) Les Citoyens n’ont le devoir de protéger que les individus qui se sentent la même obligation envers eux.
10) La Sécurité individuelle et collective est une conséquence du devoir que les Citoyens ont de se protéger mutuellement.
11) « Défendre la Cité et ses Concitoyens » est le premier devoir du Citoyen,
12) « Etre solidaire de ses Concitoyens dans toute la mesure de ses moyens » est une autre façon de définir ce premier devoir en lui donnant un sens plus large.
13) Il n’y a de devoirs que dans la réciprocité qui engendre pour tous les mêmes droits.
14) Il n’y a de devoirs et de droits que dans l’Egalité.
15) L’Egalité (des Citoyens en devoirs et en droits) est le Principe fondamental de l’ordre social.
16) Il n’y a d’égalité, dans la Nature, que devant la mort ; il n’y a de droits et d’égalité en droits qu’en Société ; il n’y a pas de droits naturels.
17) Les droits naturels, innés, humains, appelés aussi le droit des gens, sont une fiction inventée par des êtres civilisés et supposent une Société pour les reconnaître et les garantir (aux individus à sa portée), preuve qu’ils n’existent pas par eux-mêmes.
18) Seuls les individus qui remplissent leurs devoirs envers la Cité sont et demeurent Citoyens ; ceux qui ne les remplissent pas, soit parce qu’ils ne sont pas ou plus en état de le faire, soit parce qu’ils ne veulent pas ou les remplissent envers une autre Cité, n’ont aucun droit dans la Cité, du moins ne peuvent-ils jouir des droits du Citoyen ; si des droits leurs sont malgré tout reconnus, ce n’est que par la grâce de la Cité, en fonction de ses capacités et en vertu de son humanité (3).
19) La Citoyenneté s’acquiert par des devoirs et se conserve par l’observation permanente de ces devoirs et le respect des droits d’autrui ; elle n’est pas innée, elle peut donc être retirée ; tout Citoyen qui manque à ses obligations enfreint voire rompt le pacte social, compromet l’Egalité et s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à la perte de la Citoyenneté.
20) Le droit qu’ont les Citoyens d’être protégés par la Cité ne leur enlève pas celui de défendre leur personne et leurs biens (cf. § 44) par tous les moyens en leur pouvoir lorsqu’ils sont seuls face à un agresseur et plongés, à cause de lui, dans l’état de Nature. — Un Citoyen ne peut être moins en sécurité sous les lois de la Cité, enchaîné par elles face un agresseur qui s’est affranchi de toutes, que dans l’état de Nature où, si aucune loi ne le protège, puisqu’il n’y en a pas, aucune ne l’empêche non plus de se défendre autant qu’il peut. La Cité qui a manqué à son devoir une fois ne peut y manquer une seconde fois en poursuivant un Citoyen qui a eu la chance d’avoir le dessus sur son agresseur sous prétexte que ce dernier aurait aussi des droits. Les lois sont faites pour renforcer, protéger et venger ceux qui les respectent, non pour assurer la puissance, l’impunité et la vengeance des hors la loi.
Ces observations peuvent prêter à quelques confusions et soulever des interrogations. Faute de pouvoir deviner toutes les questions et objections possibles, voici au moins quatre points qu’il est important d’éclaircir.
Tout d’abord, il est apparu qu’il y a un lien direct entre les devoirs et les droits, ces derniers étant les fruits des premiers. Il est vrai qu’un droit est généré par un devoir précis. Pour autant, ce constat est faux d’un point de vue individuel. Un Citoyen ne génère pas ses propres droits puisqu’il les tient des devoirs que ses Concitoyens remplissent envers lui. Bien sûr il a les mêmes obligations envers eux. Il remplit donc bien les devoirs qui génèrent les droits de la nature de ceux dont il jouit, mais il n’est pas l’auteur direct des droits dont il jouit personnellement. Mais on se tromperait encore si l’on pensait qu’un Citoyen ne désirant jouir que de certains droits pouvait se contenter de remplir les devoirs a priori correspondants. Etre membre de la Société, appartenir à la Cité, confère un ensemble d’obligations. Il n’y a pas de Citoyens au rabais ; il n’y a que des Citoyens à part entière, égaux en devoirs et en droits, ou des étrangers. En d’autres termes, les droits du Citoyen sont l’apanage de la Citoyenneté qui, elle, s’obtient et se conserve par l’accomplissement d’un faisceau de devoirs.
Dans la lignée de cette réflexion, notons que les devoirs précèdent les droits et qu’une Société remplit parfaitement son rôle dès lors qu’elle garantit à tous ses Citoyens tous les droits que leurs devoirs génèrent. L’Egalité n’est ni plus ni moins que cela. Il ne faut donc pas confondre les actes qui relèvent du droit et ceux qui ne le concernent pas tant qu’ils ne compromettent pas les droits d’autrui. Il ne faut pas non plus croire qu’une Société est inégalitaire ou injuste parce que, pour des raisons de capacités individuelles ou collectives, les droits de ses Citoyens sont moins étendus que ceux d’une autre : l’Egalité et la justice ne se mesurent pas par comparaison entre Sociétés, mais à l’aune des devoirs que remplissent et des droits dont doivent conséquemment jouir les Citoyens d’une même Société. Ces remarques permettent de comprendre que toutes les Sociétés animales appliquent les Principes à la lettre et sont égalitaires (4) contrairement aux concentrations humaines dites sociétés qui, toujours le mot droit à la bouche, sont toutes inégalitaires et ignorent le B. A. BA. de l’Egalité.
Ensuite, l’objection la plus courante contre l’Egalité (en droits) est qu’elle serait inconcevable du fait que tout est différent, que rien n’est égal dans la nature. Ceux qui tiennent de tels propos pour soutenir leurs privilèges ou accepter leur oppression parlent tous néanmoins de droits, de société. Or la notion de droit est inséparable de celle de devoir qui, elle-même, n’a aucun sens dans l’inégalité. Comme nous l’avons vu, un individu n’a de devoir envers un autre, ne lui garantit un droit, que parce que ce dernier remplit le même devoir envers lui. Etant égaux en devoirs, ils se garantissent mutuellement le ou les mêmes droits. L’Egalité est mathématique ! Cela est évident si l’on raisonne avec deux individus et reste vrai quand la Société en compte des millions, puisque les Citoyens, aussi nombreux soient-ils, ont toujours les uns envers les autres les mêmes devoirs et, partant, se garantissent les mêmes droits. On peut également dire que, si un Citoyen a des devoirs envers la Cité, qui est l’ensemble de ses Concitoyens, celle-ci, donc l’ensemble de ses Concitoyens, a les mêmes devoirs envers lui, chacun ayant bien les mêmes droits. Qu’un Citoyen ait un unique Concitoyen ou qu’il en ait une multitude représentée par la Cité, le schéma est fondamentalement le même, ses conséquences aussi. (La question n’est pas ici de savoir pourquoi, comment, l’inégalité s’est introduite dans les sociétés humaines, accouchant ainsi d’un état inédit, d’un état intermédiaire entre celui de Nature et de Société, à savoir l’état d’Oppression qui, de loin, a l’apparence d’une Société mais où, de près, règne la loi du plus fort.)
Pourtant, il est exact que les individus sont naturellement différents. Mais les différences empêchent-elles les associations ? L’adage « l’union fait la force » est-il absurde ? Les associations, les unions existent bien. Force est donc d’admettre qu’elles existent malgré les inévitables différences naturelles entre individus, parce que chaque individu, homme ou femme, fort ou faible, apporte quelque chose et y trouve son compte. Loin d’être un obstacle à l’union, les différences de capacités et de talents, gages de complémentarité entre les individus, sont un atout pour le groupe ; elles sont même indispensables à la réalisation de toutes les tâches et à l’existence de la Société. Bref, on ne peut parler de droits, de Citoyens, d’Egalité, comme s’il était toujours question de l’état de Nature dans lequel rien de tout cela n’existe, alors que ces sujets concernent manifestement l’état de Société dans lequel toutes ces notions sont consubstantielles. Un Citoyen est plus qu’un individu, plus qu’un homme, plus qu’un être naturel réduit à ses seules forces ; c’est un être moral doté de droits, le fruit de la Société et de ses lois fondées sur l’Egalité. L’Egalité est le propre de la Société ; c’est ce qui la distingue de l’état de Nature (qui n’est même pas inégalitaire puisque les notions d’Egalité et de droits n’y existent pas). Les différences naturelles ne sont donc pas un argument recevable contre l’égalité sociale ; elles ne sont invoquées, pour maintenir ce qui est, que par les ignorants, les tyrans et leurs valets.
Enfin, pour en terminer avec la question de l’Egalité, dont nous disons qu’elle s’applique aux devoirs et aux droits, il est impératif d’introduire des nuances sans lesquelles les applications donnent lieu à des aberrations et donc à des interprétations erronées de ce qu’est l’Egalité. En réalité, il y a plusieurs niveaux de devoirs et de droits, trois exactement : fondamental, indirect et particulier. L’Egalité s’applique bien sûr aux devoirs et aux droits fondamentaux, et aussi aux droits indirects ; elle ne s’applique ni aux devoirs indirects ni aux devoirs et droits particuliers. Pour le comprendre, il faut tout d’abord comprendre pourquoi il y a par nature différents niveaux de devoirs et de droits.
La raison est simple : en ce qui concerne les devoirs, un devoir fondamental est purement théorique et se décline de plusieurs façons d’un point de vue pratique, de sorte que remplir un devoir fondamental d’une certaine façon est un devoir indirect qui confère des obligations particulières. En ce qui concerne les droits, un droit fondamental est lui aussi théorique et désigne en un seul mot l’ensemble des droits qui contribuent à jouir dudit droit fondamental et dont l’exercice individuel peut, dans certains cas, générer des droits particuliers. (Des droits particuliers peuvent aussi être le pendant de devoirs particuliers.) On voit donc bien que certains devoirs découlent d’autres et que, par définition, tous ne se situent pas sur le même plan. De même pour les droits. La grosse différence entre les devoirs et les droits est qu’il suffit que les Citoyens remplissent un devoir indirect découlant d’un devoir fondamental pour s’acquitter chacun à leur façon dudit devoir fondamental (4), alors que tous les Citoyens doivent jouir de tous les droits indirects attachés à un droit fondamental pour être réellement égaux dans la jouissance de ce droit fondamental. L’égalité en devoirs indirects n’a pas de sens, car elle est impossible et inutile pour que les Citoyens soient égaux en devoirs fondamentaux (tous les gens qui travaillent, quelle que soit leur profession, travaillent), alors que, inversement, l’égalité dans un droit fondamental n’a de sens que si les Citoyens sont aussi égaux dans tous les droits indirects qui découlent de ce droit fondamental (les gens ne peuvent être également libres sans jouir réellement des mêmes libertés). Par contre, l’égalité en droits particuliers est aussi insensée qu’impossible puisque ces droits découlent soit du libre exercice de droits indirects dans lesquels les Citoyens doivent être égaux, soit de l’accomplissement de devoirs particuliers que tous les Citoyens ne sont pas tenus de remplir.
Sans trop anticiper, signalons dès à présent que la Propriété ou le droit de posséder existe (de par la Société) et doit être reconnu, mais est un droit particulier auquel, en vertu de ce que nous venons de dire, l’Egalité ne s’applique pas. La Propriété, d’un point de vue individuel, porte sur des biens produits pour soi-même ou acquis à des fins personnelles. Dans le cas d’une production individuelle pour un usage personnel, il est évident que les productions — sur lesquelles le droit de propriété n’est pas fondé sur le travail fourni, mais sur la possession non contestée ou antérieurement reconnue des matériaux utilisés — varient en nature, qualité et quantité d’un individu à un autre, de sorte que la notion d’Egalité n’a pas de sens. Même constat lorsque les individus échangent entre eux des biens qu’ils possèdent et opèrent ainsi des transferts de droit de propriété qui ne changent rien au final. Dans le cas des acquisitions, le droit de propriété sur les biens résulte de l’exercice d’un autre droit, un droit indirect (l’accès au marché), et est donc bien un droit particulier auquel l’Egalité ne s’applique pas par définition. Non seulement l’égalité en droits (système égalitaire) n’est pas l’égalité en biens (système égalitariste), mais la Liberté en condamne même le principe autant que la nature des choses la rend à jamais impossible. Ainsi, la Propriété n’est pas un droit fondamental comme l’affirment les bourgeois, pas plus que les propriétés ne sont susceptibles d’égalisation comme le voudraient les communistes.
IV. De la Liberté
Nous avons évoqué à plusieurs reprises la notion de Liberté. Cette notion, comme celle de Sécurité, est intrinsèque à l’acte d’association politique.
Raisons :
21) Des individus qui s’associent pour se protéger mutuellement ne peuvent s’associer que librement, c’est-à-dire sans contrainte (6),
22) De même que les individus doivent intégrer librement et volontairement une association, les individus déjà associés sont libres d’accueillir en leur sein, de refuser et d’en exclure qui il leur plait,
23) Il appartient à l’association de fixer les conditions non négociables que chaque individu doit satisfaire pour pouvoir l’intégrer s’il le veut, conditions qui, même satisfaites, n’obligent pas l’association à l’accueillir, ce qui, dans le cas contraire, permettrait aux étrangers de lui forcer la main et placerait leurs désirs au-dessus de la volonté des Citoyens qu’ils prétendent devenir,
24) Dans la mesure où nul ne peut adhérer librement à un groupe qui exigerait plus de lui que des autres membres, des associés ne peuvent exiger plus d’un nouveau venu que d’eux-mêmes,
25) Dans la mesure où nul ne peut sans contrainte se constituer esclave, des associés, en position de force, ne peuvent accorder à un nouveau venu des avantages dont ils se privent,
26) Dans la mesure où nul ne peut renoncer délibérément à un état pour un autre moins avantageux, des associés qui ont renoncé à une certaine liberté doivent trouver au sein de l’association, malgré ses contraintes, une liberté plus grande encore, autrement dit plus de libertés,
27) Une libre association politique exclut l’esclavage, l’oppression, l’exploitation et la tyrannie et suppose l’égalité en devoirs et en droits des Citoyens anciens et récents.
28) La Liberté est le complément et même une extension de la Sécurité ; sans Sécurité, la Liberté est un privilège pour quelques-uns, une illusion de courte durée pour tous les autres ; sans Liberté, la Sécurité est une oppression permanente et donc un danger en elle-même.
29) La Liberté qui n’est un droit qu’en Société ne peut consister à faire tout ce que l’on veut ou peut comme dans l’état de Nature (que les individus ont fui), mais à jouir des mêmes libertés, c’est-à-dire des mêmes droits (fondamentaux et indirects) que ses Concitoyens et à pouvoir faire tout ce qui n’est pas contraire à ses devoirs, aux droits d’autrui et aux lois légitimes (cf. § 61).
30) La Liberté étant l’ensemble des libertés connues et reconnues dans une Société, les libertés étant le fait de la Société, autrement dit le fruit des devoirs que les Citoyens remplissent envers elle, une liberté dans un domaine consiste à jouir à l’égal de ses Concitoyens de toutes les possibilités qu’offre la Cité dans ce domaine, et non à exercer simplement ses facultés naturelles.
La Liberté qui est un droit fondamental, à l’instar de la Sécurité, est subordonnée à l’Egalité qui est le Principe fondamental de l’ordre social. Loin d’être contraires, il ne peut y avoir l’une sans l’autre. Sans Egalité, il n’y a plus de Citoyens, plus de Société, et la « Liberté » n’est que la loi du plus fort sous une forme ou une autre : sans Liberté, la Société n’est plus une libre association mais une prison pour la masse, un cheptel pour des privilégiés, et « l’Egalité » sur quelque plan que ce soit est au mieux un slogan.
V. Participer à la vie de la Cité / Profiter des bienfaits de la Cité
Plus des Citoyens sont nombreux, plus une Société est puissante, plus la Sécurité est grande, moins les attaques extérieures sont à redouter, moins les Citoyens ont l’occasion de remplir leur premier devoir qui est de défendre la Cité et leurs Concitoyens. La Citoyenneté ne peut donc plus reposer sur l’accomplissement de ce seul devoir ; elle doit être conférée par autre chose.
Remarquons déjà que défendre la Cité et ses Concitoyens n’est pas le seul devoir. Les Citoyens ont aussi celui d’être solidaires les uns des autres, devoir qui contient le premier. La solidarité prend certaines formes en matière de protection physique, de défense au sens littéral, mais les formes qu’elle peut prendre sont beaucoup plus nombreuses. La Sécurité elle-même ne se réduit pas à être protégé des attaques extérieures, mais concerne toutes les formes de dangers contre lesquels la Société peut intervenir et qu’elle ne doit pas elle-même créer. Ces dangers peuvent être naturels ou externes, comme la faim, la maladie, le froid, le vent, le climat de manière générale, ce qui amène la Société à reconnaître et à garantir, si elle le peut, des droits indirects tels que celui d’être nourri, abrité, vêtu, soigné, etc., et, en amont, à instaurer ou à reconnaître comme devoirs indirects toutes les activités qui conjurent ces dangers et génèrent ou garantissent lesdits droits. Ces dangers peuvent aussi provenir de dérèglements internes quand les prétentions et les prévarications de certains, au lieu d’être condamnées, ont libre cours aux dépens de la Sécurité et de la Liberté des autres, quand elles anéantissent l’Egalité entre les Citoyens et sont donc porteuses d’oppression et d’exploitation. La Société doit donc proscrire tout ce qui porte atteinte à ce qu’elle reconnaît comme des droits, même aux droits les plus insignifiants en apparence, car les petites inégalités annoncent les grandes. Ainsi les devoirs et les droits peuvent se décliner et leur champ d’application s’étendre aussi loin que les capacités de l’espèce et de la Société à un moment donné le permettent.
Conséquences :
31) Lorsqu’une Société se développe, que ses activités se multiplient, que les tâches à remplir dans l’intérêt général sont de plus en plus nombreuses, que les Citoyens ne peuvent plus être unis par le seul fait de se défendre mutuellement et d’assurer leur sécurité au sens littéral, car ils n’en ont plus que rarement l’occasion, la Citoyenneté doit être conférée par l’accomplissement d’un devoir plus large que les précédents, elle doit résider dans l’accomplissement d’actes quotidiens utiles directement ou indirectement à la Cité, en un mot, elle doit consister à « participer à la vie de la Cité » sous une forme reconnue par elle,
32) Toutes les tâches dont la Cité reconnaît l’utilité sociale, même indirecte, toutes les tâches qui dispensent les autres Citoyens de les accomplir pour se consacrer à d’autres tâches tout aussi utiles sont un devoir envers la Cité : quiconque les remplit en satisfaisant aux exigences de la Cité participe à la vie de la Cité, est Citoyen et doit être l’égal en droits de ses Concitoyens (7).
33) La Cité n’assigne pas de tâches ; les Citoyens se les répartissent librement, c’est-à-dire en fonction de leurs désir, de leurs capacités et des possibilités.
34) Les Citoyens peuvent s’acquitter individuellement ou en groupe de leur devoir de Participer à la vie de la Cité ; lorsqu’ils s’en acquittent en groupe, ils forment une personne morale dont le devoir est à la mesure de son potentiel, une personne que tous les Citoyens qui la composent représentent également aux yeux de la Cité et qui sont donc solidaires dans les récompenses comme dans les sanctions, une personne qui seule a des comptes à rendre à la Cité et qui est seule responsable de sa gestion interne.
35) La Cité définit ses exigences selon ses intérêts et en fonction du nombre de Citoyens concernés, à charge pour les Citoyens ou les groupes de Citoyens de se débrouiller pour les satisfaire. Participer à la vie de la Cité procure les droits du Citoyens aux intéressés mais a avant tout pour but de pourvoir aux besoins de la Cité qui dirige le jeu.
36) Lorsqu’une forme de participation engendre une production, l’intérêt de la Cité n’est pas tant dans les quantités produites que dans les quantités écoulées : la Cité n’exige pas seulement de produire, elle exige avant tout que cette production agrée une quantité non négligeable de Citoyens. (Il en est de même pour les services pour lesquels la précision est inutile puisque, sans demande, une offre de service ne donne lieu à aucun service réel et constitue donc une activité nulle aux yeux de la Cité.)
37) Le fruit d’un devoir envers la Cité est par définition destiné à la Cité et appartient donc à cette dernière, du moins en premier lieu : produire dans le cadre d’un devoir n’a pas pour contrepartie, pour le producteur, la propriété de la production en question, mais la Citoyenneté, c’est-à-dire les droits du Citoyen. (Etre propriétaire de ce que l’on produit revient à produire pour soi, ce qui ne peut être un devoir envers la Cité.)
38) Quand tous les Citoyens ont le devoir de participer à la vie de la Cité sous une forme reconnue par elle, ils ont en retour le droit de profiter de tous ses bienfaits, fruits de leurs efforts globaux.
39) Profiter des bienfaits de la Cité est un droit fondamental, au même titre que la Sécurité et la Liberté qu’en fait il contient ; sans lui ou dans l’inégalité, la Citoyenneté n’a aucun sens, voire aucun intérêt.
40) Le droit de profiter des bienfaits de la Cité appliqué aux productions matérielles (car tous les bienfaits ne sont pas d’ordre matériel) consiste soit à partager le produit général ou collectif sinon en parts égales du moins en parts convenables, procédé qui relève davantage d’un système égalitariste que d’un système égalitaire, soit à reconnaître aux Citoyens le droit d’y accéder, c’est-à-dire d’accéder librement au marché en raison de leur Citoyenneté, ce qui est la perfection de l’Egalité.
41) Le partage équitable du produit général ou collectif convient aux petites Sociétés peu productives qui ne peuvent faire autrement ; la répartition du produit collectif par l’exercice du droit d’accéder au marché n’est possible que dans les Sociétés développées, industrialisées et informatisées.
42) Le droit d’accéder au marché découle de celui fondamental de profiter des bienfaits de la Cité ; c’est donc un droit indirect, un droit conféré par la Citoyenneté dont tous les Citoyens doivent jouir également, un droit qui n’a d’autres bornes que les besoins, les goûts et les envies du Citoyen qui l’exerce, le respect des droits d’autrui, l’exercice par les autres Citoyens de ce même droit, la nature des choses et éventuellement la loi, elle aussi égale pour tous.
VI. De la Propriété
Les animaux sont des êtres physiques. Ils ont des besoins concrets que seules des choses matérielles peuvent assouvir. Ces choses, périssables ou durables, à usage individuel ou collectif, peuvent être trouvées dans la nature ou fabriquées par un individu ou un groupe. La question est de savoir ce que sont ces diverses choses du point de vue du droit, sachant que, dans tous les cas, elles ne peuvent être des objets de droit que dans le cadre d’une Société.
Participer à la vie de la Cité consiste parfois à produire des choses, à fabriquer des biens. Profiter des bienfaits de la Cité passe, en grande partie, par l’accès à des choses matérielles constituant le produit collectif.
Conséquences :
43) Toutes les choses matérielles constituant le produit collectif, dont les Citoyens ont besoin pour vivre ou jouir de certains de leurs droits, sont inséparables des droits que la Cité doit garantir à ses Citoyens et deviennent, une fois entre les mains de ces derniers, ayant été reçus en partage ou retirés du marché pour leur usage personnel, leurs propriétés.
44) La Propriété — ou le droit de posséder — consiste, pour une personne physique ou morale, à détenir ou à pouvoir user personnellement, librement et exclusivement des biens reconnus comme siens par la Cité ou sur lesquels la celle-ci ne conteste pas ce droit.
45) Il n’y a pas de Propriété sans Société : toute propriété est relative (8) et doit son existence sinon physique du moins morale à la Société ; il appartient donc à la Cité d’indiquer les biens qui peuvent ou non être possédés, par qui, à quelles conditions et éventuellement dans quelles quantités, du moins pour les biens dont la nature n’indique pas par elle-même qui en est propriétaire (9) ; le droit de propriété, la détention et l’usage des propriétés, est borné par l’accomplissement de ses devoirs en amont, le respect des droits d’autrui en aval, par la nature des choses et au besoin par la loi.
46) Un bien ne peut être converti en propriété que de trois façons : 1) suite à l’acquisition par l’exercice du droit d’accéder au marché, 2) par l’obtention suite à la répartition par la Cité du produit collectif, 3) par la récupération ou la trouvaille qui, à moins d’être illégale, donne lieu à une possession de fait, reconnue ou non contestée.
47) Un bien ne devient pas une propriété entre les mains d’un individu sous prétexte que celui-ci l’a fabriqué personnellement ou obtenu par échange : il n’en est une que s’il l’a fabriqué avec des matériaux qui étaient déjà ses propriétés ou sur lesquels la Propriété ne lui était pas contestée, ses efforts ne rentrant donc pas en ligne de compte, ou si ce bien était déjà une Propriété entre les mains de celui de qui il l’a reçu, lequel a usé de son droit en le cédant, ce qui serait toujours le cas même si lui-même n’avait rien donné en échange.
48) Les Citoyens doivent être égaux dans le droit d’accéder librement au marché (cf. § 42) ; ils ne peuvent conséquemment en retirer et posséder les mêmes choses et dans les mêmes quantités, même si cela est possible en théorie, d’autant plus que toutes leurs propriétés ne proviennent pas du marché.
49) Les droits des Citoyens dépendent de la Citoyenneté, pas de ce qu’ils possèdent ; la possession d’un bien est un droit particulier qui peut être cédé ou échangé mais qui ne confère pas elle-même de droits, notamment celui d’accéder au marché (droit indirect) et d’acquérir ainsi des biens, puisque c’est la Propriété qui, le plus souvent, découle de lui.
50) Les choses immatérielles ne peuvent en aucun cas être des propriétés ; la propriété intellectuelle est une monstruosité ; la Cité ne peut reconnaître à leurs auteurs, leurs inventeurs, leurs découvreurs, etc., davantage que la paternité, et ce dans le meilleur des cas.
51) Une production individuelle ou collective produite dans le cadre du devoir de participer à la vie de la Cité et destinée au marché ne peut être la propriété des producteurs. (cf. § 37)
52) Même acquis individuellement — toute acquisition suppose une autorisation au moins tacite de la Cité —, les biens collectifs ou communs ne sont pas, par définition, des propriétés personnelles : ils sont soit la propriété collective ou commune du groupe des utilisateurs, soit la propriété inaliénable de la Cité qui a permis l’accès audits biens en n’en concédant que l’usage.
53) La Terre est en théorie la Propriété de l’Humanité, elle appartient à tous les hommes en général et à aucun en particulier ; en pratique, et d’ici à ce que les hommes forment une unique Cité, le principe vaut pour chaque Cité installée sur un territoire fixe et assez forte pour le conserver (cf. note 8) : son sol appartient à tous les Citoyens collectivement et à aucun personnellement.
54) Les portions de sol que la Cité confie à ses Citoyens à quelque fin que ce soit restent sa propriété, même si les utilisateurs et occupants temporaires passent pour des propriétaires aux yeux de leurs Concitoyens (10).
55) Les ressources naturelles du sol et du sous-sols de la Cité sont de même sa propriété et ne peuvent être exploitées qu’avec son accord et dans l’intérêt général : leur exploitation ne procure aux exploitants d’autre avantage que la Citoyenneté, c’est-à-dire les droits du Citoyen.
VII. Des lois & de la Démocratie
La Cité est une libre association politique (association dans le but initial de survire) entre Citoyens égaux en devoirs et en droits. L’Egalité est la clé de voûte de l’édifice social ; la Sécurité et la Liberté en sont le ciment.
Conséquences :
56) Les lois fondamentales ou Principes de l’ordre social découlent de l’acte d’association politique ; elles ne sont pas inventées par les Citoyens mais dictées par la nature de leur union : il s’agit moins d’en convenir et de les exprimer que de les constater et de les respecter.
57) Les Principes de l’ordre social sont intemporels et universels ; ils fondent toute Société, de quelque espèce que soient ses membres et à quelque époque que ce soit ; ne sont temporaires et/ou spécifiques que les lois en rapport avec les besoins particuliers d’une Société donnée à un moment donné.
58) Les lois temporaires et/ou spécifiques, générales ou particulières, doivent être exprimées voire écrites contrairement aux lois fondamentales qui peuvent être tacites, et ne doivent pas contrarier ces dernières quand elles n’en sont pas un simple prolongement.
59) Dans la mesure où les lois doivent être conformes aux Principes, elles doivent être les mêmes pour tous les Citoyens, tous doivent également y être soumis, afin qu’aucun n’ait plus ou moins de droits que les autres, que nul ne soit de fait maître ou esclave, que la Sécurité et la Liberté de chacun soient assurées et le plus étendues possible.
60) Lorsque les lois sont égales pour tous les Citoyens, que tous y sont également soumis, y compris le législateur, et que les Citoyens sont réellement égaux en droits, l’intérêt particulier se confond avec l’intérêt général : chacun désire pour lui, donc pour les autres, tous les droits, toutes les libertés dont nul ne pourra jouir aux dépens d’autrui, pas même lui.
61) Quand les lois sont égales pour tous les Citoyens, elles sont justes (11) ; quand elles sont l’œuvre de ceux qu’elles régissent, elles sont légitimes ; quand elles profitent à tous ou du moins à la majeure partie des Citoyens, sans nuire fondamentalement à l’autre partie, elles sont bonnes ; quand elles ne profitent qu’à une minorité de « Citoyens » aux dépens de la majorité, elle sont inégales, antisociales et injustes ; quand elles ne profitent objectivement à personne ou ne satisfont pas l’objet que le législateur se proposait ou affaiblissent la Cité, elles sont mauvaises ; quand les Citoyens y sont soumis sans leur consentement, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont nulles ; quand elles sont nulles et injustes, elles sont tyranniques.
62) L’idéal est que les lois soient bonnes, ce qu’elles ne peuvent être sans être justes, ce qu’elles ne peuvent être sans être légitimes.
63) Sachant que légiférer est différent de gouverner, on peut distinguer trois formes de système législatif : 1) la démocratie, où tous les Citoyens contribuent à la formation des lois et ne sont soumis qu’à celles qu’ils ont collectivement consenties, 2) l’oligarchie (aristocratie, théocratie, ploutocratie) où le pouvoir est monopolisé sous divers prétextes par quelques-uns et exercé avant tout à leur profit, 3) le despotisme, où le pouvoir législatif appartient à un seul, ce qui est une vue de l’esprit dans la mesure où une telle autorité ne peut exister sans assises dans la Cité et n’est plus despotique au sens propre dès lors qu’elle en a une quelle qu’elle soit (cf. note 21).
64) Aucun système législatif ne peut garantir de bonnes lois ; l’important est donc que le système soit par nature vertueux, qu’il soit capable et ait en lui le besoin de corriger ses erreurs, ce qui ne peut être le cas que si l’intérêt du législateur rejoint celui des sujets, si le législateur se confond avec les Citoyens, si tous les Citoyens sont réellement égaux en droits.
65) Les règles édictées par une oligarchie sont des diktats, elles sont par nature illégitimes et n’ont d’une loi que le nom ; elles sont fatalement inégalitaires ou n’ont que l’apparence de l’Egalité, et sont donc injustes ; elles sont délibérément mauvaises du point de vue général.
66) Seule la démocratie convient à une Société digne de ce nom : les lois qu’elle produit, œuvres de tous les Citoyens, sont naturellement légitimes, nécessairement égalitaires et rapidement rectifiées ou abrogées s’il apparaît qu’elles ne sont pas bonnes.
67) Pour que les lois soient réellement l’œuvre des Citoyens, tous les Citoyens doivent pouvoir en proposer selon des règles établies, et toutes celles qui sont envisagées, quels qu’en soient les concepteurs, doivent être ratifiées par eux. Un système dans lequel les Citoyens n’ont pas le droit de proposer de lois ou en sont astucieusement empêchés et dans lequel ils n’ont pas été consultés d’une manière ou d’une autre sur celles auxquelles ils sont soumis n’est pas démocratique. Ainsi le régime représentatif est une négation de la démocratie (12) : c’est de fait une oligarchie.
68) Une loi est ratifiée par les Citoyens lorsqu’elle est soumise à leur approbation et recueille au moins la majorité des suffrages exprimés. Les Citoyens qui ne se prononcent pas laissent les autres décider pour eux et ne sont pas fondés à contester le verdict. Les Citoyens qui se sont prononcés différemment de la majorité doivent de même accepter le verdict et respecter la loi, quitte à la critiquer.
69) Lorsqu’il est impossible de soumettre toutes les lois à l’approbation de l’ensemble des Citoyens, une voie intermédiaire entre le référendum permanent et l’imposture de la représentation, mais qui ne s’écarte pas du Principe, doit être trouvée.
70) Toute Société, tout système égalitaire est par nature démocratique (13) ; tout système intrinsèquement inégalitaire est incompatible avec une authentique démocratie. Attendre de la démocratie qu’elle apporte l’Egalité est la preuve que l’Egalité n’est pas (donc que les intérêts des citoyens divergent et que certains ont le pouvoir de faire prévaloir leurs intérêts particuliers) et que l’on est au mieux dans l’illusion de la démocratie.
VIII. Citoyenneté / Nationalité
Les lois doivent avant tout satisfaire les intérêts de la Cité et doivent être ratifiées par les Citoyens qu’elles vont régir.
Conséquences :
71) Le droit de contribuer à la formation des lois de la Cité, à sa direction et à la gestion de ses intérêts les plus chers, implique de vivre en son sein, de raisonner en fonction de ses intérêts, d’être incapable de la quitter par convenances personnelles et moins encore de l’abandonner dans l’adversité, en un mot d’être attaché viscéralement à elle et prêt la défendre au péril de sa vie si besoin est.
72) Quand, sauf exception, les hommes naissent, vivent et meurent au même endroit, ils ne choisissent par leur Cité, ils ne conçoivent pas d’appartenir à une autre, leur allégeance est naturelle et totale, ils sont destinés à devenir et à demeurer Citoyens, ils sont liés à leurs Concitoyens par le sang et l’esprit, par le passé et le futur ; la Cité se confond alors avec la Nation, la Citoyenneté est synonyme de Nationalité (cf. note 7).
73) Quand les hommes deviennent mobiles, que les Citoyens arrivent de tous les horizons et peuvent partir à tout moment, qu’ils n’ont souvent en commun que leur présence au même endroit au même moment, qu’ils se considèrent comme des « citoyens du monde », des « êtres humains » ou des « gens d’ailleurs » si bien que leurs « Concitoyens » ne sont rien à leurs yeux, que la Cité n’est pour beaucoup d’entre eux qu’une aubaine, une étape ou un carcan, la Citoyenneté n’est plus en soi un lien indéfectible avec la Cité qui ne peut plus accorder sa confiance et confier ses intérêts sur cette base ; il faut alors distinguer la Nationalité de la Citoyenneté et la Cité au sens strict (l’ensemble des Citoyens nationaux) de la Cité au sens large (l’ensemble des Citoyens).
74) L’existence physique et morale, l’honneur, la culture, l’avenir de la Cité, ses lois, les droits qu’elle reconnaît dépendent des Citoyens ayant le droit de cité et de l’usage qu’ils en font ; ce droit ne peut donc être reconnu à des Citoyens de hasard ou de fortune, ici aujourd’hui, ailleurs demain, indifférents au sort de la Cité ou prêts à la trahir ; il ne peut être conféré par la Citoyenneté facile à obtenir ; il doit être attaché à la Nationalité, laquelle doit témoigner d’un profond sentiment d’appartenance à la Nation et d’un désir farouche de la préserver.
75) La Nationalité s’ajoute à la Citoyenneté : la Citoyenneté, obtenue en s’acquittant du devoir de participer à la vie de la Cité d’un point de vue social ou économique, confère les droits fondamentaux indispensables au Citoyen ; la Nationalité confère le droit particulier de participer à la vie politique de la Cité.
76) La Citoyenneté est indépendante de la Nationalité : un Citoyen peut ne pas avoir de Nationalité, il peut même avoir la Nationalité d’une autre Cité si celle-ci est assez stupide pour accorder un poids politique à un déserteur, mais il ne peut avoir plusieurs Nationalités qui seraient autant de trahisons avérées ou potentielles envers chacune des Cités correspondantes. (14)
77) L’ensemble des Citoyens constitue la Cité au sens large et fait partie de la population ; l’ensemble des Citoyens nationaux constitue la Cité au sens strict, c’est-à-dire la quintessence de la Cité, la Nation, le Peuple.
78) La Cité ne pouvant connaître les sentiments des individus qu’à travers des signes et des actes éloquents, la Nationalité doit être méritée individuellement et constamment ; elle suppose, pour pouvoir y prétendre, de satisfaire à des conditions préalables attestant l’état d’esprit, voire des connaissances et des capacités (14) ; elle implique, pour l’acquérir, de s’acquitter volontairement et correctement de devoirs particuliers qui, de par leur nature, éprouvent la fidélité envers la Cité et l’allégeance envers la Nation ; elle exige, pour la conserver, de répondre à tous les appels de la Cité et de ne jamais déshonorer la Nation.
79) Citoyens ordinaires et Citoyens nationaux sont égaux en droits, puisque les droits particuliers qui les séparent n’entrent pas dans la balance de l’Egalité, d’autant plus que les Citoyens ordinaires n’en jouissent pas parce qu’ils n’ont pas voulu remplir les devoirs particuliers qui les confèrent.
80) Quoique n’étant pas l’œuvre de l’ensemble des Citoyens, les lois conçues par les seuls Citoyens nationaux n’en sont pas moins légitimes dans le mesure où les Citoyens ordinaires, en refusant la Nationalité en connaissance de cause, ont tacitement accepté que les premiers légifèrent sans eux et pour eux.
81) A moins d’être iniques, les lois ne peuvent distinguer les Citoyens nationaux des Citoyens ordinaires que pour des objets relevant exclusivement de la Nationalité ; elles ne peuvent réserver aux Citoyens nationaux des droits qui sont le pendant des devoirs du Citoyen, qui sont donc attachés à la Citoyenneté et appartiennent par nature à tous les Citoyens.
IX. Gouvernement & régime politique
Des Citoyens sont des individus ayant unis librement leurs forces pour accroître leurs chances de survie. Ils constituent un corps social qui, comme tout corps, a besoin d’une tête, d’un chef, pour réaliser l’unité (15) et diriger la force collective dans l’intérêt de tous, en un mot pour gouverner.
Conséquences :
82) Le rôle d’un chef est de diriger la Cité selon les lois de la Cité, dans l’intérêt et selon le vœu des Citoyens .
83) Le chef est un Citoyen comme les autres ; sa fonction est une fonction comme une autre et est soumise aux règles communes de la participation (cf. § 32) ; comme toute fonction, elle confère des devoirs et des droits particuliers nécessaires pour accomplir la mission mais qui ne compromettent pas l’Egalité, puisque celui qui l’occupe n’a, en tant que Citoyen, ni plus ni moins de droits fondamentaux et indirects que ses Concitoyens. (cf. note 5)
84) Le chef, institué par la Cité, pour la Cité, doit être consenti autant que ses décisions doivent être approuvées par le Peuple (l’ensemble Citoyens nationaux) qui est l’unique source de la légitimité des pouvoirs et des choses faites en son nom. — Autrement dit, il faut distinguer la fonction de chef de la manière d’exercer le pouvoir (ceci est vrai pour toute fonction). Un chef est légitime quand son accession à cette fonction ainsi que ses actes sont légitimes. La légitimité est un tout : les imposteurs n’en ont pas plus que les tyrans.
85) Un chef peut être établi de plusieurs façons : par l’élection directe ou indirecte, par auto-proclamation, par hérédité, pour une durée déterminée, indéterminée ou à vie ; les Principes condamnent certaines combinaisons (notamment le pouvoir à vie obtenu sans consentement populaire et exercé de manière tyrannique) mais n’en prescrivent aucune d’autant plus que toutes présentent des avantages et des inconvénients théoriques qui, en pratique, varient selon les circonstances, les hommes et leur manière d’exercer le pouvoir ; la meilleure combinaison est celle qui, à un moment donné, assure le mieux l’existence de la Cité et les droits des Citoyens.
86) Peu importe le titre officiel du chef (16) dès lors qu’il est élu, plébiscité ou tacitement reconnu et que ses actions et décisions reçoivent chacune, une à une, non en bloc (cf. note 12), l’aval du Peuple.
87) La reconnaissance populaire sous une forme ou sous une autre ne confère pas une légitimité éternelle au chef ; sa légitimité est nulle dès lors que le Peuple ne le reconnaît plus pour tel — soit parce qu’il agit sans le consulter, soit parce que sa personne apparaît indigne d’occuper cette fonction, soit parce que les Citoyens ne croient plus que son action sert leurs intérêts et l’intérêt général tels qu’ils les conçoivent —, même et à plus forte raison s’il n’a pas la possibilité légale de s’exprimer et de le remplacer.
88) Lorsqu’une Cité est importante, un Citoyen ne suffit plus à la fonction de chef et doit appeler des Concitoyens pour l’aider à la tâche : il constitue avec eux le Gouvernement.
89) Un système social repose essentiellement sur deux pouvoirs, sans compter celui du Peuple qui les coiffe tous : 1) le pouvoir exécutif, celui du chef et de son Gouvernement, qui est de diriger selon les vœux et dans l’intérêt du Peuple, 2) le pouvoir législatif, celui du Parlement, constitué des députés, qui est de légiférer, c’est-à-dire de formuler des projets de lois à présenter au Peuple (cf. § 67).
90) La fonction de chef est constitutive de la Cité (cf. note 16) ; elle est de toute éternité et, partant, bien antérieure à celle de législateur, laquelle est inutile tant que les Citoyens sont assez peu nombreux pour faire les lois eux-mêmes, sans intermédiaire. (17)
91) Les fonctions de chef et de législateur sont par nature distinctes et doivent être séparées et subordonnées à la volonté du Peuple — d’autant plus que chef et législateur ont par nature tendance à se prendre pour le Peuple, à considérer la Cité comme leur chose et à vouloir concentrer entre leurs mains tous les pouvoirs, de sorte que, si ces fonctions sont confondues, si l’une absorbe l’autre, le danger est grand que celui qui cumule ainsi les pouvoirs ne connaisse plus de frein à sa puissance et en abuse aux dépens du Peuple qu’il est censé servir.
92) Quand les pouvoirs législatif et exécutif trouvent l’un dans l’autre leur contre-pouvoir, au lieu de n’avoir chacun d’autre maître que le Peuple, ils ne sont pas séparés l’un de l’autre : ils sont séparés du Peuple et au-dessus de lui.
93) Qu’ils soient strictement séparés, ouvertement confondus ou sournoisement entremêlés, les pouvoirs exécutif et législatif sont fatalement dans la même position vis-à-vis du Peuple, soit qu’ils lui obéissent, soit qu’ils lui en imposent : ou le Peuple est le maître des deux, ou il ne l’est d’aucun et alors toutes les combinaisons qui d’une manière ou d’une autre le dépouillent de la souveraineté sont égales et perverses aux yeux des Principes.
94) La vraie nature d’un système politique — le régime d’une Société — est définie par la façon dont les lois sont élaborées, c’est-à-dire par qui les fait réellement (18) : la véritable nature du pouvoir législatif détermine celle du pouvoir judiciaire, relativement neutre, qui applique les lois, et celle du pouvoir exécutif qui est établi par la loi et dirige la Cité conformément aux lois (19).
95) Dans la mesure où tout individu, tout corps, est égoïste et agit avant tout dans ses intérêts et l’intérêt des siens, celui qui fait les lois les fait avant tout dans son intérêt et celui de ses pareils : il n’y a qu’en étant faites réellement par le Peuple qu’elles sont faites pour le Peuple, que le chef et le législateur (le Gouvernement et le Parlement) lui sont soumis et qu’un régime est politiquement démocratique (20).
96) Abstraction faite des nuances, il n’y a objectivement que trois types de systèmes politiques : la Démocratie, la dictature et la démocrature.
Quand les Citoyens sont réellement égaux en droits, le Peuple est réellement souverain, les pouvoirs exécutif et législatif, quels que soient leurs formes et les rapports entre eux, lui sont subordonnés, et le système est authentiquement démocratique. En revanche, dans l’inégalité, quels que soient les formes des pouvoirs exécutif et législatif, les rapports entre eux et le rapport du tout au Peuple, le régime oscille entre la dictature et la démocrature, la première étant ouvertement antidémocratique, la seconde étant prétendument démocratique.
Quand le pouvoir exécutif — entre les mains d’un homme ou d’un parti — étouffe, s’empare ou est revêtu du pouvoir législatif et dicte ses lois au Peuple, le système est une dictature. Ceci étant, le terme dictature n’indique ni l’origine ni le but du Gouvernement, mais qualifie ses méthodes, c’est-à-dire le fait qu’il agisse avec fermeté voire violence et sans consulter le Peuple, et, bien qu’une dictature soit rarement dans l’intérêt du Peuple, une dictature légitime et éphémère peut parfois s’avérer nécessaire pour le salut public. Ainsi, un Gouvernement dictatorial peut être démocratique en vertu de la légitimité de son origine ou de son but, et antidémocratique au regard de ses méthodes extraordinaires. Dans ce cas, c’est l’exception qui confirme la règle, si toutefois ce constat résiste à l’épreuve du temps. (21)
Quand le pouvoir législatif prévaut autant sur l’Exécutif que sur le Peuple dont il se réclame à tort ou à raison, ce qui n’est possible que dans l’inégalité et au milieu de classes, le système est une démocrature. Une démocrature n’est en définitive qu’une oligarchie astucieuse validée par un Peuple naïf. Que les prétendus représentants du Peuple soient élus, désignés ou autoproclamés, dès lors qu’ils parlent en son nom sans lui soumettre leurs décisions, il est clair qu’ils cherchent auprès de lui une caution qu’ils ne méritent pas. Ils ne sont pas le Peuple et entendent que chacun reste à sa place, eux et leurs pareils en haut. La démocrature la plus accomplie est bien sûr la démocratie strictement représentative qui, en permettant au Peuple de désigner à la fois le chef et les députés qui vont le bafouer en toute légalité (c’est eux qui font les lois), lui donne l’illusion d’être important et l’envie de défendre ce système. Cela dit, autant un système strictement représentatif est antidémocratique, autant un système simplement représentatif, ne permettant pas aux mandataires du Peuple de s’en dire les représentants et de substituer leur volonté à la sienne, est démocratique d’un point de vue politique. Pourtant, même un système politiquement démocratique, difficile à atteindre dans l’inégalité, n’est pas une authentique démocratie, mais seulement la forme la moins perverse de démocrature.
X. Définitions & conclusion
Cette étude, pour répondre à des questions précises, nous a entraînés bien plus loin que prévu. Il est en effet apparu que tout était lié et qu’une réponse simple, même sans être simpliste, serait lourde de sous-entendus et exposerait à des incompréhensions, des contresens, à toutes les interprétations farfelues et frauduleuses. Il fallait donc avoir une vision globale de l’ordre social pour cerner correctement les éléments et les paramètres particuliers de la Société. Mais cette vision globale, pour être juste et échapper aux passions, ne pouvait être un simple constat de ce qui est ou de ce qui fut ; elle ne pouvait procéder que d’une étude théorique et rigoureuse en partant de la forme de Société la plus basique et en allant toujours plus loin dans les développements logiques. Ce travail est fait. A l’avenir, toutes les questions sociales doivent être abordées de cette manière, voire s’appuyer directement sur ces conclusions, et beaucoup, dont les plus importantes, trouvent déjà leur réponse dans cet exposé.
Nous pouvons maintenant répondre aux questions initiales et poser les définitions des concepts clés de l’ordre social. Ces définitions ne se trouvent évidemment pas, du moins telles quelles, dans le dictionnaire ni même dans les livres de « droit ».
Société, Cité, Association politique : Ensemble d’individus appelés Citoyens, unis librement dans le but originel d’accroître leurs chances de survie, donc pour être en sécurité, et qui, de ce fait, ont les uns envers les autres les mêmes devoirs et se garantissent mutuellement les mêmes droits (de sorte que leur relation est égalitaire et que l’Egalité est le principe fondamental de l’ordre social). — Selon le Petit Larousse illustré : Mode de vie propre à l’homme et à certains animaux, caractérisé par une association organisée d’individus en vue de l’intérêt général.
Citoyen : Individu admis à faire partie de la Cité, reconnu comme tel par la Cité, participant effectivement à la vie de la Cité et selon ce qu’elle considère comme une participation, faisant en un mot ce qu’elle attend de lui, la défendant au besoin, et jouissant en retour des mêmes droits fondamentaux et indirects que ses Concitoyens (dont celui de profiter des bienfaits de la Cité), étant ainsi leur égal en devoirs et en droits. — Selon le Petit Larousse illustré : Membre d’un Etat considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits civils et politiques.
Cité : Ensemble des Citoyens (sens large). Voir Société. / Ensemble de Citoyens nationaux, Nation (sens strict). / Toute personne ou toute institution représentant ou chargée de représenter légitimement, aux yeux des individus, les Citoyens ou les Concitoyens, l’intérêt général ou la volonté nationale. / Territoire sur lequel vivent des Citoyens sédentaires (au sens de pays, de patrie). — Selon le Petit Larousse illustré : Dans l’Antiquité et au Moyen Age, unité politique et économique constituée par une ville et son territoire.
Devoir : Pendant d’un droit. / Obligation dans le cadre d’une relation réciproque ; il n’y a pas de devoir sans réciprocité, dans l’inégalité en devoirs ou en droits. / Obligation envers la Cité et ses Concitoyens pour mériter soi-même et conserver la Citoyenneté et les droits qui vont avec. Obligation de la Cité envers ses Citoyens afin de leur garantir leurs droits et justifier qu’ils aient des obligations envers elle. / Les devoirs peuvent être d’ordre fondamental (dictés par l’acte d’association : défendre la Cité, être solidaire de ses Concitoyens, participer à la vie de la Cité), indirect (découlant de devoirs fondamentaux théoriques et les traduisant en pratique) ou particulier (découlant de devoirs indirects ou indépendants de la Citoyenneté, comme ceux liés à la Nationalité). — Selon le Petit Larousse illustré : Ce à quoi on est obligé par la loi, la morale, etc..
Droit : Pendant d’un devoir. Liberté, possibilité, capacité conférée par la Citoyenneté en contrepartie de l’acquittement des devoirs du Citoyen et garantie par la loi (la Cité). Il n’y a de droits au sens propre qu’en Société, dans l’Egalité entre Citoyens. / Liberté, possibilité, capacité conférée par le dévouement et la volonté des Citoyens à la Cité (et à ses représentants) afin que celle-ci remplisse les missions que les Citoyens lui ont confiées. / Liberté, possibilité, capacité reconnue par la Cité en vertu de son humanité à des individus n’étant pas Citoyens ou indépendamment de leur Citoyenneté. / Les droits peuvent être d’ordre fondamental (pendant des devoirs fondamentaux, conséquence immédiate, but suprême de l’acte d’association pour les Citoyens : Sécurité, Liberté, profiter des bienfaits de la Cité), indirect (découlant des droits fondamentaux, comme celui d’accéder au marché de la Cité) ou particulier (découlant de l’exercice d’un droit indirect, tel que la Propriété, ou pendant d’un devoir particulier). — Selon le Petit Larousse illustré : Faculté d’accomplir ou non quelque chose, d’exiger quelque chose d’autrui, en vertu des règles reconnues, individuelles ou collectives. Ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux, et qui servent à établir des règles juridiques. Ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société.
Egalité : Principe fondamental de l’ordre social ; elle ne concerne que les Citoyens d’une Cité donnée ; elle s’applique aux devoirs fondamentaux et aux droits fondamentaux et indirects, de sorte que les Citoyens sont réellement égaux en devoirs et en droits, dont celui de profiter des bienfaits de leur Cité. — Selon le Petit Larousse illustré : Rapport entre individus, citoyens égaux en droits et soumis aux mêmes obligation.
Loi : Règle sociale reconnaissant des droits, découlant de l’acte d’association politique (synonyme alors de Principe) ou adoptée par les Citoyens (nationaux) et égale pour tous les Citoyens. Toute règle formée autrement, c’est-à-dire sans l’aval des Citoyens, n’est pas une loi ou n’en a que le nom. — Selon le Petit Larousse illustré : Prescription établie par l’autorité souveraine de l’Etat, applicable à tous, et définissant les devoirs et les droits de chacun.
Principe : Règle, rapport, devoir, droit découlant de l’acte d’association politique, intrinsèque à l’ordre social, fondé sur l’Egalité, et antérieur à toute conceptualisation. — Aucun équivalent dans le Petit Larousse illustré.
Démocratie : Système économico-politique dans lequel les Citoyens réellement égaux en devoirs et en droits, dont celui de profiter des bienfaits de leur Cité, sont soumis à des lois expressément approuvées par eux, faisant d’eux en corps, c’est-à-dire du Peuple, le véritable souverain. / Seul régime possible d’une Société digne de ce nom. Il ne peut y avoir de véritable démocratie dans l’inégalité ; une Société fondée sur l’Egalité ne peut être autre que démocratique. / La démocratie strictement représentative qui dépouille de facto le Peuple de la souveraineté est une négation de la démocratie. — Selon le Petit Larousse illustré : Régime politique dans lequel le Peuple exerce sa souveraineté lui-même, sans l’intermédiaire d’un organe représentatif (démocratie directe) ou par représentants interposés (démocratie représentative).
Telles sont les véritables définitions de tous ces mots. Toutes font intervenir la notion d’Egalité. Comment pourrait-il en être autrement quand il s’agit de concepts sociaux, sachant que l’Egalité est le Principe fondamental de l’ordre social ? Quelle valeur aurait des définitions qui permettraient de l’oublier, qui, par exemple, parleraient de loi sans rappeler qu’une loi au sens propre doit être égale pour tous et est soit une conséquence de l’acte d’association, soit l’expression de la volonté des Citoyens ; qui parleraient de citoyens comme s’il pouvait y en avoir dans l’inégalité ; qui parleraient d’égalité en droits, sans mentionner le droit, pour un Citoyen, de profiter des bienfaits de sa Cité en vertu de sa Citoyenneté ; qui parleraient d’individus sans tenir compte de leur Citoyenneté et de tout ce qu’elle implique ; qui définiraient le Citoyen comme étant quelqu’un qui appartient à la Cité, ce qui est juste, mais sans dire que l’appartenance implique la participation, etc. ? De telles définitions consacreraient tous les abus ou leur ouvriraient la porte ; elles empêcheraient dans tous les cas de la refermer. C’est avec des mots que l’on pense. Ce sont les mots creux qui soutiennent et rendent inébranlable le présent. C’est par des mots retrempés que commence la Révolution.
Philippe Landeux
Ecrit pour et signalé par Riposte Laïque
NOTES
(1) Il suffit de réfléchir à ce que sont les Principes fondamentaux d’une Société digne de ce nom et à la nature profonde de la monnaie, à ses postulats, à ses mécanismes (ou lois) intrinsèques et à ses effets naturels pour voir que les uns et les autres sont en totale opposition, et pour comprendre qu’une « société » ne peut être harmonieuse avec un cœur antisocial.
(2) Toutes les espèces vivantes se divisent en sous-ensembles qui, eux-mêmes, peuvent encore se subdiviser. Au vrai, il en est de même pour toutes choses. Chaque espèce vivante, chaque sorte de choses renferme des unités de divers types qui peuvent constituer plusieurs grandes catégories et former des classes particulières à l’intérieur de ces catégories. Ainsi, l’espèce humaine se subdivise-t-elle en races, elles-mêmes en ethnies. Il ne s’agit pas ici de savoir comment cela s’est produit mais simplement de le constater. Force est également de constater que les races humaines correspondent à des espaces géographiques bien déterminés, souvent éloignés les uns des autres et parfois séparés par des frontières naturelles quasi infranchissables pour des hommes primitifs. S’il n’est donc pas impossible que les « Sociétés » actuelles comprennent des individus venant des quatre coins du monde, il est évident que ce mélange racial ne pouvait pas exister dans les Sociétés primitives, les différentes races n’ayant alors aucun contact entre elles, contrairement aux ethnies. Il s’ensuit que les Sociétés actuelles qui sont le développement des Sociétés primitives ont été bâties par des individus d’une même race et que la dimension raciale fait partie de leur identité. Que les hommes aient aujourd’hui les moyens de circuler et de s’agréger aux Sociétés les plus ouvertes (car toutes ne les sont pas, et les plus critiquées sont souvent celles qui méritent le moins de l’être de ce point de vue) n’enlève rien au fait que les Sociétés qui les accueillent, tout comme celles qu’ils ont quittées, ont une dimension raciale qui peut être nuancée mais ne doit pas disparaître ou être niée sous peine de les anéantir.
(3) D’après les Principes de l’ordre social pris au pied de la lettre, les enfants, les inactifs, les fainéants, les malades, les vieux et les étrangers, qui ne participent pas à la vie de la Cité, voire sont une charge pour elle, ne sont pas ou plus Citoyens et n’ont donc aucun droit dans la Cité. Il se peut que les capacités et la mentalité de la Cité évoluent au point de permettre de reconnaître des droits aux individus de ces catégories, voire même de pousser à l’extrême le devoir de solidarité et de ne plus déchoir de la Citoyenneté certains d’entre eux. Néanmoins, en ce qui concerne les enfants, jamais ceux-ci ne seront Citoyens, ne seront considérés comme tels et ne jouiront des droits attachés à ce statut, sauf à ne pas leur accorder tous les droits en raison de leur jeunesse et de leur incapacité à les exercer, à admettre que les Citoyens peuvent être inégaux et à détruire ainsi l’Egalité et la Société au nom d’individus qui ne sont même pas Citoyens. Il ne faut donc pas confondre les droits que la Cité reconnaît par humanité à des individus pourtant à charge et ceux du Citoyen que les individus méritent par eux-mêmes ; les deux sont appelés « droits », mais ils n’ont pas la même origine et ne sont pas de la même nature. L’humanité peut compléter les Principes ; elle ne doit en aucun cas les saper sous peine de scier la branche sur laquelle elle prend appui.
(4) La question de dominance chez les animaux sociables fausse souvent le jugement des hommes qui oublient que, dans les Sociétés animales, leurs membres n’ont qu’un seul droit, celui d’être en sécurité (ce qui se limite généralement à être en sûreté et, chez les carnivores, à pouvoir manger). Les priorités ou les exclusivités que peuvent avoir les dominants dans certains domaines ne compromettent pas la Sécurité des autres individus et ne sont donc pas une atteinte au Principe d’Egalité.
(5) Les Citoyens qui remplissent un devoir indirect découlant d’un devoir fondamental s’acquittent chacun à leur façon dudit devoir fondamental, sont par conséquent Citoyens au même titre et doivent jouir des mêmes droits. Autrement dit, les droits des Citoyens ne varient pas selon leur fonction, puisque toutes les fonctions qu’ils remplissent dans l’intérêt de la Cité sont des portes de la Citoyenneté qui ouvrent sur les mêmes droits. Quelle que soit sa fonction dans la Cité, un Citoyen est Citoyen. Bien que les fonctions soient par nature différentes et « hiérarchisables », cela ne justifie aucunement que les Citoyens soient inégaux en droits, ce qui serait nier leur Citoyenneté même et les exempterait de tout devoir. Il est donc absurde de croire que la hiérarchie inévitable et nécessaire implique l’inégalité en droits des Citoyens et que l’Egalité proscrit la hiérarchie des fonctions et des hommes qui les occupent. Egalité et hiérarchie sont parfaitement compatibles. La cause actuelle de l’inégalité « en droits » est fondamentalement ailleurs que dans la hiérarchie.
(6) Des individus « associés » contre leur gré ne forment pas une association puisqu’ils sont davantage dans un rapport maîtres / esclaves, donc dans un rapport de force, comme dans l’état de Nature. Pour les faibles, cette « association » est en elle-même un danger à conjurer soit par la fuite, soit par le meurtre. Pour les forts, la présence des faibles, censés les protéger, est illusoire et dangereuse car ceux qu’ils oppriment sont en droit de les tuer à la première occasion et n’ont aucune raison de les aider à repousser un ennemi extérieur, auquel ils sont même susceptibles de prêter main forte. L’union forcée n’est donc dans l’intérêt de personne.
(7) Cette conception de la Citoyenneté — quiconque participe à la vie de la Cité est Citoyen et doit être l’égal en droits de ses Concitoyens — condamne par nature l’esclavage qui sévissait dans les cités antiques. Dans ces cités, la citoyenneté était l’apanage des guerriers professionnels ou occasionnels et correspondait à ce que nous appelons ici la Nationalité (cf. VIII. Citoyenneté / Nationalité), terme qui n’existait pas alors. De plus, ce que nous appelons la Citoyenneté n’existait pas comme statut, de sorte que ceux qui étaient Citoyens selon les présents critères (participer à la vie de la Cité), mais pas selon les critères anciens (défendre la cité), n’étaient rien (femmes, étrangers libres dits métèques chez les Grecs, esclaves). Aujourd’hui, les choses sont inversées mais fondamentalement semblables : citoyenneté et nationalités sont confondues, les termes sont utilisés indifféremment, et ce que les anciens appelaient citoyenneté correspond à ce que nous appelons généralement nationalité. C’est pourquoi les travailleurs immigrés non-naturalisés ne sont toujours pas considérés comme des citoyens. Mais la confusion entre nationalité et citoyenneté fait que la première qui aujourd’hui n’implique aucun devoir attestant la fidélité envers la nation bien qu’elle confère des droits politiques est accordée selon les critères à la fois plus larges et inconsistants, en un mot insipides, de la notion actuelle de citoyenneté. C’est pourquoi les « citoyens du monde » autoproclamés et les immigrés naturalisés mais non assimilés qui, tous, au mieux, ne devraient pas être plus que de simples Citoyens se fourvoient quand ils brandissent leur nationalité comme un sésame, car elle n’a objectivement aucune valeur, ce dont les nationaux réellement attachés à la nation ne sont pas dupes. Pire ! alors que la Citoyenneté et la Nationalité se méritent et peuvent être retirées, leur actuelle confusion fait qu’elles sont quasi inaliénables, dans la mesure où la déchéance justifiée de l’une entraînerait parfois la déchéance abusive de l’autre, si bien que, pour parer à un abus, on accepte le scandale. Ainsi, la confusion des notions les affaiblit mutuellement et entraîne l’étiolement des choses.
(8) Toute propriété est relative : elle n’est réellement reconnue que par la Société qui la défend contre les malfaiteurs intérieurs et les ennemis extérieurs. Hors de cette Société et sans sa force, la Propriété n’existe pas plus que n’importe quel autre droit, même si l’absence momentanée d’agressions étrangères peut faire illusion. Qu’une guerre survienne contre un ennemi plus fort : le pays est envahi, conquis, les biens sont détruits ou enlevés sans vergogne, les habitants sont tués, chassés, exploités, dépouillés, expropriés, les droits dont ils s’enorgueillaient sont méconnus ou, au mieux, maintenus par le vainqueur par intérêt ou humanité. Il en est de même pour l’ensemble du territoire que la Cité considère comme sa Propriété mais qui n’en est une qu’à ses propres yeux et qui n’en est donc pas une dans l’absolu. Si elle ne sait pas le défendre et le conserver, ce territoire sera un jour celui de plus fort qu’elle.
(9) Un bien matériel ne flotte pas dans l’espace : il appartient fatalement à quelqu’un, que ce quelqu’un soit une personne physique ou une personne morale, c’est-à-dire un groupe de personnes pouvant aller du couple à l’ensemble des Citoyens, en passant par tous les sous-ensembles possibles. Ajoutons d’ailleurs que toute propriété est privée du point de vue de ceux qui n’en sont pas propriétaires ou n’ont simplement pas le droit d’en user. La notion de propriété privée n’a donc aucun sens. On ne peut distinguer que la propriété personnelle (dont seul l’individu propriétaire, voire sa famille, peut user), la propriété collective (dont tous les membres d’une collectivité donnée peuvent user à des fins personnelles) et la propriété commune (dont l’usage peut être que collectif ou individuel mais dans l’intérêt de la communauté).
(10) Sous ses apparences sociales, le slogan « La terre aux paysans » est totalement antisocial. L’exploitation du sol est le moyen de nourrir la Cité, c’est-à-dire l’ensemble des Citoyens. C’est à cette fin que la Cité en confie des portions aux paysans, aux éleveurs, etc.. Ces derniers ne peuvent donc user du sol comme ils veulent, selon leurs intérêts ; ils doivent l’exploiter, remplir leur fonction et mettre leur production sur le marché de la Cité pour que tous Citoyens y accèdent. Les paysans ne sont et ne doivent être propriétaires ni du sol ni de leur production puisque, dans le cas contraire, ils auraient, grâce à la Cité, le pouvoir d’affamer les Citoyens, ce qui, même s’ils n’usaient pas de ce pouvoir, serait une aberration. Cela ne veut pas dire que les paysans sont des esclaves, qu’ils travaillent pour rien, mais que, à l’instar de leurs Concitoyens, leurs droits ne dépendent pas de quelque propriété mais de leur Citoyenneté.
(11) « Les lois doivent être égales pour tous les Citoyens. » Il ne faut pas réduire cette formule à « les lois doivent être égales pour tous », ce qui ne veut plus rien dire. Les lois concernant les Citoyens doivent en effet être égales, mais cette égalité ne s’étend pas aux étrangers (touristes, travailleurs étrangers de passage, immigrés clandestins) qui, n’étant pas Citoyens, peuvent et doivent être soumis à des règles ou des lois particulières, sous peine de nier la spécificité des uns et les autres, de traiter les Citoyens comme des étrangers ou les étrangers comme des Citoyens, ce qui serait absurde dans les deux cas. Tenir compte des différences réelles n’est pas faire de la discrimination qui consiste à « établir » des différences artificielles. Ici, l’abus serait non de distinguer mais d’égaliser ce qui est bel et bien différent en terme de statut.
(12) Les théoriciens de la démocratie ont vu le piège et l’imposture du régime représentatif où un corps d’élus, souvent issus d’une même classe sociale, finit par dépouiller le Peuple de la souveraineté et par agir contre lui, soi-disant en son nom. Tout d’abord, le Peuple ne peut être représenté que par lui-même. Des élus ne sont pas des « représentants », mais des mandataires ayant pour fonction de faire ce que le Peuple dans son entier ne peut faire par lui-même et de soumettre leur ouvrage à la ratification du Peuple afin qu’il devienne le sien. Appeler « représentants du Peuple » des individus qui ne sont que ses mandataires a évidemment pour but ou du moins pour conséquence de supprimer la procédure de ratification populaire sous prétexte que le Peuple s’est déjà exprimé à travers ses soi-disant représentants, donc de mettre les mandataires à la place du Peuple. Cependant le problème n’est pas qu’il y ait des mandataires, mais que le régime soit exclusivement « représentatif ». La démocratie directe n’est possible que dans des Sociétés où les Citoyens sont très peu nombreux, de sorte que très vite s’instaure une forme de mandature. L’important n’est donc pas de savoir comment sont déterminés les mandataires, mais si les lois qu’ils imaginent sont ratifiées par le Peuple et deviennent ainsi son œuvre. C’est la caution populaire des lois qui caractérise la démocratie, et non le mode de désignation des législateurs qui peuvent être élus, tirés au sort, nommés, voire autoproclamés. La ratification n’est inutile que dans le cas du mandat impératif, c’est-à-dire lorsque les élus ont pour mission expresse de soutenir un projet de loi précis. Ce cas mis à part, une élection n’est pas un référendum. On doit même dire que, sans ratification systématique des lois imaginées par les élus, des élections ne sont qu’une mascarade démocratique. En effet, si des élus ne sont pas tenus de respecter leurs promesses et peuvent faire ce qu’ils veulent, s’ils trompent leurs électeurs sur toute la ligne, leur élection ne légitime en rien leurs agissements qui oscillent entre la duperie et l’improvisation. Or il est évident que les élus ne tiendront pas toutes leurs promesses et seront amenés à improviser. En somme, une seule chose est vraie ; leur personne a été élue. L’élection ne légitime donc pas leurs actes ; elle leur confère simplement le droit d’occuper une fonction, instituée pour servir le Peuple. En clair, la mandature a pour but de permettre à un nombre réduit de personnes, non de substituer leur volonté à celle de l’ensemble des citoyens, mais de faire ce dont une multitude serait incapable, à savoir délibérer et formuler des lois, ce qui ne veut pas dire les adopter. L’assemblée législative propose ; le Peuple dispose. C’est cela la démocratie. La « démocratie représentative » est donc une double imposture.
(13) Une Société digne de ce nom est par nature égalitaire et démocratique. La Société, l’Egalité et la démocratie (authentique) sont des notions indissociables ; l’une ne peut exister sans les autres. Les expressions « société égalitaire » et « société démocratique » sont des pléonasmes comme « justice sociale » ou « arbre en bois ». A l’inverse « société inégalitaire », « société individualiste » sont des oxymores. Dans ces cas, il ne faut pas parler de société mais de système ou de concentration d’individus.
(14) Le danger que représentent des individus naturalisés mais n’ayant pas la nation dans le cœur, ou pire, en ayant une autre, est parfaitement illustré par l’ancien ministre délégué à la promotion de l’Egalité des chances, Azouz Begag qui, interviewé par le journal El-Khabar, déclare, le 31 octobre 2010 : « Le meilleur moyen de servir les intérêts de l’Algérie est de former et soutenir une nouvelle génération d’hommes politiques issus de l’immigration algérienne en France, afin de les propulser à l’Assemblée nationale où ils pourront voter des lois favorables à l’Algérie ! ». Ces paroles sont-elle dignes d’un ex-ministre français ? Sont-elles seulement dignes d’un Français ordinaire ? Mais sont-elles vraiment surprenantes de la part d’un Azouz (cf. mes articles sur l’importance des prénoms) ?
(15) Les conditions pour pouvoir prétendre à la Nationalité d’une Cité sont fixées par la loi qui, elle-même, est établie par les Citoyens nationaux. Quoique certaines conditions pour appartenir à une Nation et remplir certains devoirs tombent sous le sens, chaque Cité est libre d’en réduire ou d’en allonger la liste, de baisser ou d’élever le niveau de ses exigences. Cependant, tout Citoyen doit pouvoir remplir ces conditions pour peu qu’il le veuille et que la Cité lui en donne les moyens, puisque la loi doit être égale pour tous les Citoyens et qu’aucun ne doit être discriminé de fait. En théorie, ceci exclut des conditions d’ordre naturel portant sur la race, le sexe, la taille, etc.. En pratique, rien, hormis leur éthique, la force et le temps, ne peut empêcher les Citoyens nationaux qui sont juges et partie d’adopter les lois qui leur paraissent nécessaires ou judicieuses pour constituer et préserver la Nation telle qu’ils la conçoivent.
(16) Toute Société, tout groupe, a besoin d’un chef, d’un leader, d’un dirigeant pour « réaliser l’unité ». Une Société n’est pas une juxtaposition d’individus, mais une union. La volonté de tous ne doit faire qu’une. Or il est impossible que les volontés individuelles ne fassent qu’une si chacune reste indépendante des autres, si aucun individu, à un moment ou à un autre, ne sert pour ainsi dire d’entonnoir et ne synthétise la volonté générale. Ses attributions exactes peuvent varier, mais sa fonction est vitale pour le groupe. Qu’il ait l’autorité pour prendre des décisions seul, que ses décisions soient soumises à l’approbation avant exécution, ou qu’il soit l’instrument de décisions collectives, c’est lui qui, en incarnant le groupe, fait des individus un groupe. Même un groupe qui prendrait toutes ses décisions collectivement, même si des individus pouvaient être unanimes pour chaque décision à prendre, un leader serait toujours nécessaire pour conduire les débats, exécuter les décisions, en assurer le suivi, donner le tempo, etc.. Pour qu’un groupe parle d’une même voix, une seule bouche doit parler en son nom. Il n’y a pas d’exemple de groupe sans leader. Il y en a toujours un, même s’il est parfois officieux, ce qui est alors pire pour lui et pour le groupe qu’un leader officiel.
(17) Peu importe le titre du chef : seules comptent la manière dont il a accédé à cette fonction et sa façon de l’exercer. Un même titre peut recouvrir des pouvoirs de natures fondamentalement différentes. Les premiers chefs étaient élus et appelés rois, ce que nous appellerions des présidents à vie ou à durée indéterminée. Ils pouvaient néanmoins être déposés. Plus tard, pour prévenir les conflits de succession, les chefs qui jusque-là étaient souvent choisis parmi les enfants ou les parents de l’ancien chef furent obligatoirement le fils et le plus proche descendant mâle du chef décédé : la royauté devint héréditaire. Ce système avait bien un avantage, mais il ne garantissait plus la valeur personnelle du chef et permettait même à celui-ci d’abuser de son autorité puisqu’elle n’était plus contestable. Le titre de roi n’avait plus du tout le même sens. La notion de président se rapproche davantage de celle de roi au sens antique. Mais elle offre elle aussi des nuances. Un président est élu. Pourtant, tout change suivant qui vote et la durée du mandat. Une élection au suffrage universel direct confère la légitimité. Mais une élection ou une nomination par des électeurs, de grands électeurs ou des députés, eux-mêmes chargés ou non d’un mandat impératif, confère une légitimité plus ou moins faible, voire nulle, et des capacités en proportion. La durée du mandat et la possibilité ou non d’être rééligible jouent aussi sur les capacités et les priorités du président. Le chef ne se définit donc pas par son titre mais par ses pouvoirs réels, lesquels dépendent du mode de sa nomination et des ses attributions. L’histoire fourmille d’exemples de chefs ayant tantôt conservé le titre prestigieux de leur prédécesseur afin de donner une illusion de continuité et de bénéficier de préjugés favorables alors que leurs pouvoirs étaient différents, tantôt renoncé à un titre devenu impopulaire tout exerçant les mêmes pouvoirs sous un autre nom. Il ne faut pas être dupe des mots. Il ne faut pas non plus rejeter la fonction de chef par crainte d’être abusé. C’est en raison de ce travers que la France a connu une période sans chef, de 1792 à 1799, entre le renversement de Louis XVI et l’avènement de Napoléon. La monarchie avait créé chez les révolutionnaires une défiance insurmontable vis-à-vis de la fonction de chef, sous quelque nom que ce soit. Mais elle est une nécessité sociale et il était inévitable qu’elle réapparaisse rapidement pour ne plus jamais disparaître. Napoléon fut d’abord premier Consul pour dix ans, puis Consul à vie, puis Empereur. Il ne fut jamais élu mais toujours plébiscité. Il était donc légitime. Mais qu’était-il au juste ? Un roi, un président, un dictateur ? Il était tout cela à la fois. Au fond, ce ne sont pas tant les hommes qui décident de la forme à donner au pouvoir exécutif que les conditions historiques ou les circonstances ponctuelles qui, par la force des choses, leur en impose une en condamnant à brève échéance celles qui sont inadaptées.
(18) Toute forme de participation à la vie de la Cité est une fonction. Utiliser le mot fonction dans son acception la plus large est donc sans intérêt, de sorte que ce terme est usité pour qualifier des activités particulières, celles qui consistent, pour des Citoyens, à incarner la Cité aux yeux de leurs Concitoyens, qu’il s’agisse pour la Cité de remplir ses devoirs envers eux, d’exercer ses droits ou d’être simplement une interlocutrice. Autrement dit, lorsque les Citoyens dans leur ensemble ne peuvent plus, en raison de leur nombre, assumer collectivement et en permanence certains des rôles de la Cité vis-à-vis d’eux en tant qu’individus, ces rôles doivent être confiés à des Citoyens ou à des sous-ensembles de Citoyens appelés institutions. (Il est important de bien souligner que ces rôles sont des fonctions quand ils sont remplis en permanence, et non de manière occasionnelle, c’est-à-dire quand les Citoyens qui les remplissent n’ont pas besoin de participer autrement à la vie de la Cité.) Les fonctions et les institutions peuvent elles aussi, quand leurs missions se multiplient et qu’elles n’y suffisent plus ou qu’elles s’éloigneraient trop de leur rôle premier, créer une nouvelle branche et donner naissance à une nouvelle fonction ou institution autonome. L’ensemble de ces fonctions et institutions constituent l’Etat, distinct de la Cité dont il n’est qu’une figuration. (Ces fonctions, ces charges, ces postes, ces emplois peuvent être pourvus de différentes manières, selon leur nature, selon des traditions, selon l’époque, mais qui les occupent ? importe moins, en définitive, que comment ils s’en acquittent, bien que certaines façons de les pourvoir soient par nature calamiteuses.) Les fonctions et les institutions apparaissent donc progressivement et logiquement avec l’accroissement du nombre de Citoyens. Bien sûr, elles n’ont pas à l’origine le nom, le sens, l’activité, l’importance et la complexité qu’elles prennent par la suite. Quoi qu’il en soit, toute fonction nouvelle procède d’une ou plusieurs fonctions préexistantes : sa raison d’être est de remplir avec plus d’efficacité (question d’organisation) ou de manière plus légitime (question de composition) un des aspects d’une autre fonction, le fonctionnaire ne suffisant plus à la tâche. C’est pourquoi les fonctions originelles conservent toujours des attributions normalement abandonnées aux fonctions dont elles ont accouchées et qu’elles les font valoir dans les cas extraordinaires. Il s’ensuit que le Peuple et le chef peuvent exceptionnellement exercer tous les pouvoirs dévolus aux fonctionnaires dont l’institution découlent fatalement, directement ou indirectement, de l’un ou de l’autre ou des deux à la fois. On peut dire la même chose au sujet des divers postes créés dans le cadre d’une fonction : celui qui occupe la fonction, le premier fonctionnaire, peut agir à la place de tous ceux qui sont sous ses ordres en tant qu’aides.
D’après ces considérations, il est dans la logique des choses qu’après le chef apparaissent des policiers (Ils procèdent du chef, quoique avec l’évolution ils soient aussi sous l’autorité du pouvoir judiciaire, d’où un conflit permanent.), puis des juges (Ils procèdent à la fois du chef, qui jusque-là en faisait parfois office, et du conseil des anciens dont toutes les sociétés primitives attestent l’existence et qui, sans être une institution proprement dite, est l’embryon du pouvoir législatif.), puis des magistrats (Ils procèdent du chef puisqu’ils le représentent), puis des militaires (Ils ne représentent pas la Cité aux yeux de leurs Concitoyens, mais face à l’étranger. Bien que sous les ordres du chef, ils procèdent des Citoyens qui, jusque-là, étaient tous des guerriers occasionnels.), puis des percepteurs (Ils procèdent directement du chef ou des magistrats. Jusque-là, leur tâche était assurée par des policiers. La professionnalisation des soldats impose la mise en place d’un système efficace de prélèvement qui, du reste, est dans l’intérêt de tous les fonctionnaires et, quand il est juste, de tous les Citoyens. Leur rôle est perçu négativement, mais ils représentent bien la Cité.) et enfin des députés (Ils procèdent du Peuple au nom duquel ils parlent. S’ils procèdent du chef ou s’autoproclament, ils ne représentent rien.)
En songeant à l’évolution des sociétés, on pense à deux personnages importants que l’on retrouve systématiquement sous des noms variables, d’abord confondus puis distincts : le prêtre et le médecin. Ces personnages ont bien une utilité, comme du reste tous les Citoyens, mais ils n’ont pas une fonction, ils ne représentent d’aucune façon la Cité. On peut en dire autant des maîtres, ancêtres des enseignants, qui, à l’origine et pendant longtemps, se confondent d’ailleurs avec les prêtres.
Terminons avec les cas des ministres et des maires. Les premiers ne sont pas une fonction indépendante du chef dont ils ne sont que des aides et, même au début, des conseillers. Les seconds ne représentent pas la Cité mais seulement une portion des Citoyens. C’est donc bien une fonction, mais d’un genre particulier, du moins quand ils sont élus. S’ils sont nommés, ce ne sont que des magistrats et représentent le chef.
(19) Quand on considère un système politique, l’important n’est pas de savoir comment il se fait appeler, mais qui fait les lois, au nom de quoi et dans l’intérêt de qui. La réalité des choses que des mots recouvrent importe plus que les mots eux-mêmes, souvent creux ou illusoires. Cette remarque n’est pas sans rappeler cette déclaration mémorable : « Est-ce dans les mots de république ou de monarchie que réside la solution du grand problème social ? Sont-ce les définitions inventées par les diplomates pour classer les diverses formes de gouvernement qui font le bonheur et le malheur des nations, ou la combinaison des lois et des institutions qui en constituent la véritable nature ? Toutes les constitutions politiques sont faites pour le Peuple ; toutes celles où il est compté pour rien, ne sont que des attentats contre l’humanité ! Eh ! que m’importe que de prétendus patriotes me présentent la perspective prochaine d’ensanglanter la France, pour nous défaire de la royauté, si ce n’est pas la souveraineté nationale et l’égalité civile et politique qu’ils veulent établir sur ses débris ? Que m’importe qu’on s’élève contre les fautes de la cour, si loin de les réprimer, on ne cesse de les tolérer et de les encourager, pour en profiter ? Que m’importe que l’on reconnaisse, avec tout le monde, les vices de la constitution qui concernent l’étendue du pouvoir royal, si on anéantit le droit de pétition ; si on attente à la liberté individuelle, à celle même des opinions ; si on laisse déployer contre le Peuple alarmé une barbarie qui contraste avec l’éternelle impunité des grands conspirateurs ; si on ne cesse de poursuivre et de calomnier tous ceux qui, dans tous les tems, on défendu la cause de la nation contre les entreprises de la cour et de tous les partis ? » (Robespierre, extrait de son journal Le défenseur de la Constitution, 17 mai 1792)
(20) « La véritable nature du pouvoir législatif détermine [...] celle du pouvoir exécutif qui est établi par la loi et dirige la Cité conformément aux lois ». Selon le point 90, le pouvoir exécutif est antérieur au pouvoir législatif. Il semble donc qu’il y ait une contradiction : comment le pouvoir exécutif peut-il être établi par la loi et diriger conformément aux lois si le pouvoir législatif n’est pas lui-même institué ? C’est oublier que des lois, au vrai sens du terme, sont l’expression de la volonté du Peuple et que le pouvoir législatif, en tant qu’institution, n’est que l’instrument du Peuple dans l’œuvre législative. Ainsi, lorsque le pouvoir législatif n’existe pas, le pouvoir exécutif est directement établi par le Peuple et dirige conformément à ses vœux qui font loi ; et lorsque le pouvoir législatif existe et est l’organe qui exprime les lois, c’est son rôle de définir et de borner les pouvoirs de l’Exécutif, de sorte que le pouvoir exécutif est établi par la loi, plus exactement par la Constitution, et dirige bien selon les lois. Quand la loi est véritablement l’expression de la volonté du Peuple, loi est synonyme de Peuple et le principe posé est toujours vrai. Mais ceci reste vrai quand le pouvoir législatif échappe au Peuple ou que le pouvoir exécutif s’en empare. Ce qui change alors, c’est la véritable nature du pouvoir législatif (cf. § 63). Dans le premier cas, le pouvoir exécutif est toujours assujetti aux lois édictées par le pouvoir législatif sans le consentement du Peuple ; dans le second, le pouvoir exécutif est le pouvoir législatif et est donc « soumis » aux lois qu’il se donne lui-même. (Dans ce second cas, la nature du pouvoir législatif qui ne peut être despotique par lui-même mais seulement oligarchique avec des nuances indique toujours, à travers lesdites nuances, la nature despotique ou dictatoriale du pouvoir exécutif.) Dans les deux cas, le système législatif n’est plus démocratique mais oligarchique sous une forme ou sous une autre, les lois ne sont plus dans l’intérêt du Peuple, et peu importe du point de vue des Principes à quelle sauce le Peuple est mangé, même si certaines sont plus douces ou épicées que d’autres.
(21) Un système peut être politiquement démocratique sans être pour autant une authentique démocratie (cf. § 70). Un système est authentiquement démocratique s’il est une démocratie de fond en comble. Or une authentique démocratie exige un système économique égalitaire, un système dans lequel les Citoyens soient réellement égaux en droits, dont celui de profiter des bienfaits de la Cité, autrement dit un système dans lequel il n’y ait ni riches ni pauvres, mais seulement des Citoyens d’un poids économico-politique égal, ce qui est impossible dans un système monétaire, sous Largent (croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger). Dans un système monétaire, inégalitaire par nature, la volonté des hommes ne suffit pas pour instaurer une authentique démocratie. Les lois de Largent prévalent toujours sur celles des hommes, et les riches qui n’ont pas les mêmes intérêts que les pauvres ont toujours plus de poids qu’eux pour faire prévaloir les leurs. Dans un tel contexte, tout ce que peuvent faire les hommes, c’est tendre vers la démocratie pour en avoir l’illusion, c’est-à-dire suivre tous les Principes excepté ceux qui remettent en cause Largent qui fausse tout, et instaurer un système parfaitement démocratique du point de vue de la philosophie politique.
(22) Une dictature n’est en soi ni bonne ni mauvaise. Tout dépend du contexte et du but que s’assignent les dirigeants de cette dictature. Il est évident que, en temps normal, une dictature à caractère permanent, est « mauvaise », du moins injuste, puisque la force du gouvernement est manifestement dirigée contre les citoyens, qu’elle porte volontairement atteinte à leurs libertés, à leur sécurité et à l’Egalité, et qu’elle n’est du reste concevable que dans l’inégalité. En revanche, face à un péril extraordinaire et pressant, menaçant d’emporter la Société, revêtir les dirigeants légitimes d’un pouvoir dictatorial, afin qu’ils puissent agir avec célérité et sans souffrir d’opposition, est souvent le seul moyen pour la Cité d’en réchapper. Tel était le sens du mot dictature dans l’antique république romaine. Tel fut aussi, en quelque sorte, le rôle officieux du grand Comité de salut public durant la Révolution française, dans un pays déchiré par la guerre civile, attaqué sur toutes ses frontières et obligé de mobiliser toutes ses ressources, un pays qui plus est instable politiquement vu la jeunesse de la République et, partant, en proie à la lutte à mort des factions (groupuscules incarnant soit des classes sociales soit des conceptions politiques).
21:34 Écrit par Philippe Landeux dans 1. PRINCIPES DE L'ORDRE SOCIAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, principes, révolution, social, démocratie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 09 février 2011
ROBESPIERRE ET LA DEMOCRATIE
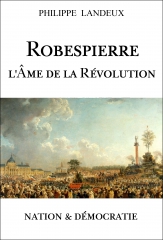 Instaurer l’Egalité et la démocratie, du moins en favoriser l’instauration, fut l’objectif suprême de Robespierre, celui qui guida toute sa politique tout au long de sa carrière.
Instaurer l’Egalité et la démocratie, du moins en favoriser l’instauration, fut l’objectif suprême de Robespierre, celui qui guida toute sa politique tout au long de sa carrière.
Pour ce qui est de l’Egalité, ses idées n’étaient pas très originales : il ne concevait guère mieux qu’une réduction des inégalités financières, via des impôts progressifs, des exemptions, des indemnités, des aides, des taxes, etc., bref il prônait ce que nous connaissons et appelons aujourd’hui l’Etat providence. Ce n’était pas une révolution même si c’était très avancé pour l’époque et quoique personne n’ait proposé mieux depuis.
En revanche, en ce qui concerne la démocratie, Robespierre en a posé les principes absolus (1) et, loin d’avoir été dépassée, sa pensée est encore révolutionnaire. Pour ceux qui croient que le système qu’ils ont sous les yeux est une démocratie, comme pour ceux qui croient que la dégénérescence actuelle est une conséquence de la Révolution en général et de Robespierre en particulier, rien ne peut mieux éclairer les premiers et détromper les seconds que la connaissance exacte de ses positions.
(1) Robespierre a bel est bien posé les principes absolus de la démocratie. Sa faiblesse est d’avoir ignoré qu’il ne peut pas y avoir de véritable démocratie dans l’inégalité, sous Largent. La démocratie ne peut pas apporter l’Egalité, puisque l’Egalité est la condition de la démocratie. L’Egalité et Largent sont fondamentalement incompatibles. (C’est ce que Robespierre sentit lorsqu’il écrivit puis ratura : « Quand leur intérêt [celui des riches] sera-t-il confondu avec celui du peuple ? Jamais. » juin 1793) Ne remettant pas en cause Largent, ne pouvant d’ailleurs pas le faire à son époque (voir la Théorie du Civisme), Robespierre fut inconsciemment réduit à concevoir une Egalité dénaturée par Largent, à présenter comme étant l’Egalité ce qui n’était jamais que moins d’inégalités. Son impuissance à instaurer l’Egalité, ne serait-ce qu’à la théoriser convenablement, ne fait cependant pas de lui un démagogue. Les démagogues ne sont pas ceux qui veulent l’Egalité et la démocratie qui doivent régner dans une Société digne de ce nom, mais bien ceux qui acceptent ou prônent l’inégalité au nom de Largent (car c’est toujours au nom de Largent que l’inégalité est acceptée ou prônée en dernière analyse) et défendent la tyrannie (oppression, exploitation, dictature) au nom de la Liberté.
Robespierre attachait une importance capitale aux lois et à leur formation. Tout en dépendait selon lui. Quelles soient justes (question de contenu) et légitimes (question de législateurs) l’emportait sur toute autre considération. En cela, il était démocrate avant d’être républicain, car la démocratie bien comprise touche au fond des choses alors que la république n’est jamais qu’une forme pouvant contenir tout et son contraire. Comme il le dit lui-même le 17 mai 1792 : « Est-ce dans les mots de république ou de monarchie que réside la solution du grand problème social ? »
Robespierre voulait que les droits des citoyens soient reconnus et garantis et que les élus, les législateurs, soient honnêtes de gré ou de force afin qu’ils œuvrent bien dans l’intérêt général. Toutes ses propositions tendaient à l'un ou l'autre de ces buts.
Robespierre ne formula pas d’un coup toutes ces propositions. Il le fit au gré des sujets à l’ordre du jour. Certaines ne furent faites qu’une fois ; il revint inlassablement sur d’autres. Il aurait été possible de les regrouper par thème mais nous les présenterons dans l’ordre chronologique autant que faire se pourra.
Des législatures courtes
Le 12 septembre 1789, Robespierre demanda en vain que les législatures durent un an, afin
« que le Peuple, qui était condamné à ne pouvoir faire ses loix lui-même, eut au moins la consolation de renouveler souvent ses Représentans ; et d’être ainsi en une continuelle activité pour défendre ses droits et sa liberté ».
Cette disposition fut adoptée par la constitution de 1793 (article 40). Dans son discours sur la constitution à donner à la France (10 mai 1793), il avait simplement proposé que la durée des fonctions des mandataires n’excède pas deux années (article 9).
Le suffrage universel
Dès le 22 octobre 1789, Robespierre s’opposa à la notion de suffrage censitaire. Son intervention est rapportée dans un journal :
« On a décidé ensuite conformément au projet du Comité, qu’il fallait payer en imposition directe la valeur de trois journées de travail ; c’est peu, c’est trop peu, sans doute ; mais on ne peut s’empêcher de concevoir un sentiment d’indignation quand on voit un Robespierre s’opposer de tout son pouvoir à ce qu’on exige aucune portion de contribution. Vil et détestable incendiaire, qui croit défendre la cause du peuple en l’armant contre ses défenseurs naturels ! Sans doute, elle est belle, elle est sublime en théorie, cette idée que tous les hommes ont un droit égal à la législation, mais qu’elle est fausse en pratique ! »
Le 20 avril 1791, aux Cordeliers, Robespierre prononça un grand discours contre l’idée d’assujettir le droit de cité à l’imposition d’un Marc d’argent :
« Vous [les députés] avez vous-mêmes reconnu cette vérité d’une manière frappante, lorsqu’avant de commencer votre grand ouvrage, vous avez décidé qu’il fallait déclarer solennellement ces droits sacrés, qui sont comme les bases éternelles sur lesquelles il doit reposer.
- Tous les hommes naissent et demeurent libres, et égaux en droits.
- Le souveraineté réside essentiellement dans la nation.
- La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à sa formation, soit par eux-mêmes, soit par leurs représentants, librement élus.
- Tous les citoyens sont admissibles à tous les emplois publics, sans aucune autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
« Voilà les principes que vous avez consacrés : il sera facile maintenant d’apprécier les dispositions que je me propose de combattre : il suffira de les rapprocher de ces règles invariables de la société humaine.
« Or, 1° la Loi est-elle l’expression de la volonté générale, lorsque le plus grand nombre de ceux pour qui elle est faite ne peuvent concourir, en aucune manière, à sa formation ? Non. Cependant interdire à tous ceux qui ne paient pas une contribution égale à trois journées d’ouvriers, le droit même de choisir les électeurs destinés à nommer les membres de l’Assemblée législative ; qu’est-ce autre chose que rendre la majeure partie des Français absolument étrangers à la formation de la loi ? Cette disposition est donc essentiellement anti-constitutionnelle et anti-sociale.
« 2° Les hommes sont-ils égaux en droits, lorsque les uns jouissant exclusivement de la faculté de pouvoir être élus membre du corps législatif, ou des autres établissements publics, les autres de celle de les nommer seulement, les autres restent privés en même temps de tous ces droits ? Non ; telles sont cependant les monstrueuses différences qu’établissent entre eux les décrets qui rendent un citoyen actif ou passif ; moitié actif, et moitié passif, suivant les divers degrés de fortune qui lui permettent de payer trois journées, dix journées d’impositions directes, ou un Marc d’argent. Toutes ces dispositions sont donc essentiellement anti-constitutionnelles et anti-sociales.
« 3° Les hommes sont-ils admissibles à tous les emplois publics sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents, lorsque l’impuissance d’acquitter la contribution exigée les écarte de tous les emplois publics, quels que soient leurs vertus et leurs talents ? Non ; toutes ces dispositions sont donc essentiellement anti-constitutionnelles et anti-sociales.
« 4° Enfin, la nation est-elle souveraine, quand le plus grand nombre des individus qui la composent est dépouillé des droits politiques qui constituent la souveraineté ? Non ; et cependant vous venez de voir que ces mêmes décrets les ravissent à la plus grande partie des Français. Que serait donc votre déclaration des droits, si ces décrets pouvaient subsister ? Une vaine formule. Que serait la nation ? Esclave ; car la liberté consiste à obéir aux lois qu’on s’est données, et la servitude à être contraint de se soumettre à une volonté étrangère. Que serait votre constitution ? Une véritable aristocratie. Car l’aristocratie est l’Etat où une portion des citoyens est souveraine et le reste sujets. Et quelle aristocratie ? La plus insupportable de toutes ; celle des riches. »
Le suffrage universel fut bien sûr le mode de suffrage que Robespierre préconisa le 29 juillet 1792, aux Jacobins, pour l’élection des députés à la Convention qui n’était pas encore convoquée :
« Que tous les français domiciliés dans l’arrondissement de chaque assemblée primaire, depuis un tems assez considérable, pour déterminer le domicile, tel que celui d’un an, soit admis à y voter ; que tous les citoyens soient éligibles à tous les emplois sans autre privilège, que celui des vertus et des talens. Par cette seule disposition, vous soutenez, vous ranimez le patriotisme et l’énergie du peuple ; vous multipliez à l’infini les ressources de la patrie ; vous anéantissez l’influence de l’aristocratie et de l’intrigue ; et vous préparez une véritable convention nationale ; la seule légitime, la seule complète, que la France aurait jamais vue. »
Le suffrage universel est une des rares dispositions soutenues par Robespierre qui soit non seulement en vigueur aujourd’hui mais qui soit encore plus étendue qu’il ne l’envisageait lui-même. Il ne lui était en effet jamais venu à l’esprit de reconnaître aux femmes le droit de cité qu’elles n’obtinrent, du reste, en France, qu’en 1945.
Des députés exclusifs
Le 7 novembre 1789, pour faire la nique à Mirabeau, l’Assemblée décréta que ses membres ne pourraient accéder à aucun minitère ni aucune autre place à nomination royale. Robespierre n’intervint pas sur le sujet car il était d’accord avec le principe. Le 25 octobre 1790, au sujet de la Haute Cour nationale, il formula des exigences qui, dans son esprit, s’appliquaient sans nul doute aussi aux députés. Il demanda que les membres de ladite cour
« soient nommés par le peuple, que la durée de son autorité soit courte, qu’il [ce tribunal] soit surveillé par le corps législatif, qu’il soit aussi nombreux que la nature des choses peut le permettre, que les membres de la cour nationale ne pussent être réélus », qu’ils « ne puissent recevoir aucun dons, pension ni emploi du pouvoir exécutif, même pendant les deux ans qui suivront immédiatement le temps de leur magistrature ».
Une députation nombreuse
Le 18 novembre 1789, Robespierre exprima le désir que les Assemblées nationales soient composées d’au moins mille députés car il était persuadé que « plus elles seront nombreuses, plus l’intrigue aura de peine à s’y introduire, et plus la vérité paraîtra avec éclat ».
L’immunité parlementaire
Le 25 juin 1790, à l’Assemblée, Robespierre posa le principe de l’immunité parlementaire :
« Pour que les Représentans de la Nation jouissent de l’inviolabilité, il faut qu’ils ne puissent être attaqués par aucun Pouvoir particulier ; aucune décision ne peut les frapper si elle ne vient d’un pouvoir égal à eux, et il n’y a point de pouvoir de cette nature. Il existe un Pouvoir supérieur aux Représentans de la Nation, c’est la Nation elle-même. Si elle pouvait se rassembler en Corps, elle serait leur véritable Juge… Si vous ne consacrez ces principes, vous rendez le Corps législatif dépendant d’un Pouvoir inférieur, qui, pour le dissoudre, n’aurait qu’à décréter chacun de ses Membres. Il peut le réduire à la nullité, et toutes ces idées si vraies, si grandes d’indépendance et de liberté, ne sont plus que des chimères. Je conclus à ce qu’il ne soit déclaré qu’aucun Représentant de la Nation ne peut être poursuivi dans un Tribunal, à moins qu’il ne soit intervenu un acte du Corps législatif, qui déclare qu’il y a lieu à accusation. »
Pour Robespierre, immunité ne rimait pas avec impunité. Comme il le dit ici, les élus du peuple ne peuvent avoir de juge que le peuple même. Faute de contre-pouvoir populaire constitutionnel, il ne peut appartenir qu’aux élus de mettre en accusation l’un d’entre eux. Cela arriva souvent durant la Révolution. Mais cette solution est vicieuse en elle-même car elle fait trop de place à l’esprit de parti naturel à tout groupe et à l’esprit de corps naturel à toute institution. Robespierre en imagina donc une autre dont il sera question plus loin.
Contre le cumul des fonctions publiques
Le 25 août 1790, l’Assemblée exclut les prêtes des fonctions de juges. Robespierre appuya cette mesure sur deux principes :
« Quelle est donc la raison constitutionnelle qui doit nous déterminer à les exclure [les prêtres, devenus des fonctionnaires de par la constitution civile du clergé] des fonctions judiciaires ? Ce n’est point une raison particulière aux ecclésiastiques ; c’est une raison commune à tous les fonctionnaires publics ; c’est le principe que les fonctions publiques doivent être séparées. On ne doit point en réunir plusieurs, dans les mêmes mains : 1° parce que celui qui est chargé par la société de quelque emploi doit avoir tout le temps et toute la liberté nécessaire pour s’y livrer tout entier ; 2° parce qu’un citoyen qui réunirait plusieurs fonctions publiques serait trop puissant et trop redoutable à la liberté publique. »
Robespierre réitéra cette opinion dans son discours sur la constitution à donner à la France : « Nul ne peut exercer à la fois deux emplois publics. (art. X) » (10 mai 1793).
Le droit d’être armé
Décembre 1790, dans son discours publié sur l’organisation des gardes nationales, Robespierre affirma un droit oublié par les démocrates délavés et pourtant inséparable de la démocratie, celui pour tous les citoyens d’être amés :
« Etre armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme ; être armé pour défendre la liberté et l’existence de la commune patrie est le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi sacré que celui de la défense naturelle et individuelle dont il est la conséquence, puisque l’intérêt et l’existence de la société sont composés des intérêts et des existences individuelles de ses membres. Dépouiller une portion quelconque des citoyens du droit de s’armer pour la patrie et investir exclusivement l’autre, c’est donc violer à la fois et cette sainte égalité qui fait la base du pacte social, et les loix les plus irréfragables et les plus sacrées de la nature. »
Le droit d’être armé peut être soumis à des modalités mais ne peut être contesté sur le principe. En l’occurrence, Robespierre, en parlant du droit d’être armé, soutenait le droit pour tout citoyen de faire partie de la garde nationale.
La liberté de la presse
Le 24 août 1789, lors de la discussion sur la déclaration des droits, Robespierre s’était prononcé pour la liberté illimitée de la presse. Le 11 mai 1791, il fit aux Jacobins un grand discours sur le sujet :
« La liberté de la presse doit être entière et indéfinie, ou elle n’existe pas. [...]
« Mais pourquoi prendre tant de soin pour troubler l’ordre que la nature établissait d’elle-même ? Ne voyez-vous pas que, par le cours nécessaire des choses, le tems amène la proscription de l’erreur et le triomphe de la vérité ? laissez aux opinions bonnes ou mauvaises un essor également libre, puisque les premières seulement sont destinées à rester. [...]
« Les lois, que sont-elles ? l’expression libre de la volonté générale, plus ou moins conforme aux droits et à l’intérêt des nations, selon le degré de conformité qu’elles ont aux lois éternelles de la raison, de la justice et de la nature. Chaque citoyen a sa part et son intérêt dans cette volonté générale ; il peut donc, il doit même déployer tout ce qu’il a de lumières et d’énergie pour l’éclairer, pour la réformer, pour la perfectionner. Comme dans une société particulière, chaque associé a le droit d’engager ses co-associés à changer les conventions qu’ils ont faites, et les spéculations qu’ils ont adoptées pour la prospérité de leurs entreprises : ainsi, dans la grande société politique, chaque membre peut faire tout ce qui est en lui, pour déterminer les autres membres de la cité à adopter les dispositions qui lui paraissent les plus conforme à l’avantage commun. [...]
« ... quel est le but essentiel de la liberté de la presse ? C’est de contenir l’ambition et le despotisme de ceux à qui le peuple a commis son autorité, en éveillant sans cesse son attention sur les atteintes qu’ils peuvent porter à ses droits. [...]
« Ce ne sont pas ces hommes incorruptibles, qui n’ont d’autre passion que celle de faire le bonheur et la gloire de leur patrie, qui redoutent l’expression publique des sentiments de leurs concitoyens. Ils sentent bien qu’il n’est pas si facile de perdre leur estime, lorsqu’on peut opposer à la calomnie une vie irréprochable et les preuves d’un zèle pur et désintéressé [...]
« Qui sont ceux qui déclament sans cesse contre la licence de la presse, et qui demandent des lois pour la captiver ? ce sont ces personnages équivoques, dont la réputation éphémère, fondée sur les succès du charlatanisme, est ébranlée par le moindre choc de la contradiction ; ce sont ceux qui voulant à-la-fois plaire au peuple et servir les tyrans, combattus entre le désir de conserver la gloire acquise en défendant la cause publique, et les honteux avantages que l’ambition peut obtenir en l’abandonnant, qui, substituant la fausseté au courage, l’intrigue au génie, tous les petits manèges des cours aux grands ressorts des révolutions, tremblent sans cesse que la voix d’un homme libre vienne révéler le secret de leur nullité ou de leur corruption ; qui sentent que pour tromper ou pour asservir leur patrie, il faut, avant tout, réduire au silence les écrivains courageux qui peuvent la réveiller de sa funeste léthargie, à-peu-près comme on égorge les sentinelles avancées pour surprendre le camp ennemi ; ce sont tous ceux enfin qui veulent être impunément faibles, ignorans, traîtres ou corrompus. »
Le 22 août 1791, aux Jacobins, il ajouta :
« Je pense bien que les calomniateurs doivent être poursuivis en justice : cependant je crois que les fonctionnaires doivent être soumis à la censure de l’opinion publique qui doit toujours être parfaitement libre. Si le magistrat avait le droit de poursuivre tous ses calomniateurs, l’écrivains patriote qui chercherait à faire observer la conduite du magistrat, serait obligé de lutter inégalement avec le magistrat, toutes les fois qu’il parlerait de lui. Le fonctionnaire public qui sera accusé à tort, saura, par l’exposé de sa conduite irréprochable, faire sortir sa vertu brillante d’un plus bel éclat. »
Cependant, le 19 avril 1793, alors que l’élaboration de la constitution commençait, il objecta au girondin Buzot qui réclamait lui aussi la liberté indéfinie de la presse :
« Il n’y a qu’une seule exception, qui n’est applicable qu’aux temps des révolution, et que Buzot paraît avoir méconnue, car les révolutions sont faites pour établir les droits de l’homme. Il faut même, pour l’intérêt de ces droits, prendre tous les moyens nécessaires pour le succès des révolutions. Or, l’intérêt de la Révolution peut exiger certaines mesures qui répriment une conspiration fondée sur la liberté de la presse. Par exemple, vous avez déjà adopté des loix qui combattent le principe que Buzot a voulu établir absolument et dans tous les temps. […] De telles mesures, quoique contraires au principe de la liberté indéfinie, qui doit régner dans un état de calme, sont cependant nécessaires dans ce moment ; et si vous ôtiez toute espèce de frein à la licence des conspirateurs qui pourraient inonder la France entière de libelles liberticides, vous porteriez un coup mortel à la liberté, et vous vous mettriez hors d’état d’assurer le maintien des droits de l’homme, qui doivent être la base de notre constitution. Il est plus nécessaire que jamais de maintenir, dans toute leur sévérité, ces lois révolutionnaires, qui étouffent le germe du royalisme et du fédéralisme, fléaux qui perdraient la République entière. »
Le droit de pétition
Les 9 et 10 mai 1791, à l’Assemblée, Robespierre défendit le droit illimité de pétition, c’est-à-dire le droit de s’adresser individuellement ou collectivement aux élus :
« Si en décrétant le droit de pétition vous avez pensé accorder aux Français un droit nouveau, vous vous êtes trompés. Le droit de pétition n’est autre chose que la faculté qui appartient à tout citoyen d’émettre son vœu et de demander à ceux qui peuvent subvenir à ses besoins ce qui lui est nécessaire. Les Français jouissaient de ce droit avant que vous fussiez assemblés, aucune loi ne l’avait limité, et le décret que vous rendriez pour mettre des bornes à ce droit, serait la seule chose nouvelle que vous eussiez faite à cet égard. […] Je déclare donc que je tiens encore à ces principes que j’ai soutenus sans cesse dans cette tribune ; j’y tiens jusqu’à la mort ; et nous serions réduits à une condition bien misérable, si l’on pouvait avec succès nous peindre comme des perturbateurs du repos public et comme les ennemis de l’ordre, parce que nous continuerions à défendre, avec énergie, les droits les plus sacrés dont nos commettans nous aient confié la défense, car nos commettans sont tous les Français, et je les défendrai tous, sur-tout les plus pauvres. (Applaudi) […] Une collection d’individus, comme un particulier, a le droit de pétition, et ce droit n’est point une usurpation de l’autorité politique : elle n’a rien de commun avec les pouvoirs qui doivent être rigoureusement réservés à ceux qui en sont investis par le peuple ; c’est au contraire un droit naturel, et je soutiens que puisque tout individu isolément a le droit de pétition, il n’est pas possible que vous interdisiez à une collection d’hommes quelque titre, quelque nom qu’elle porte, que vous lui interdisiez, dis-je, la faculté d’émettre son vœu et de l’adresser à qui que ce puisse être. » (9 mai)
« Le droit de pétition n’est autre chose que la faculté accordée à un homme, quel qu’il soit, d’émettre son vœu, de demander ce qu’il lui paraît le plus convenable, soit à son intérêt particulier, soit à l’intérêt général. Il est évident qu’il n’y a point là de droits politiques, parce qu’en adressant une pétition, en émettant un vœu, son désir particulier, on ne fait aucun acte d’autorité, on exprime à celui qui a l’autorité en main ce que l’on désire qu’il vous accorde. » (10 mai)
Le droit de pétition n’est pas celui de proposer, encore moins de provoquer, des référendums. Il y a loin entre presser des élus et les court-circuiter. Il ne vint jamais à l’esprit de Robespierre de faire cette proposition dans la mesure où ses autres propositions garantissaient la fidélité des élus en les assujettissant à la volonté du peuple.
La non rééligibilité immédiate des députés sortants
Les 16 et 18 mai 1791, à l’Assemblée, Robespierre prôna et obtint que les députés sortants ne soient pas rééligibles à la législature suivante. Il était très attaché à cette disposition (2).
(2) Robespierre avait bien sûr raison sur le principe : en redevenant régulièrement de simples citoyens, soumis aux lois comme tout un chacun, les députés n’en sont que plus motivés à faire de bonnes lois. Mais c’est oublier que, dans un système monétaire, les “citoyens” sont inégaux en droits, qu’il y a des riches et des pauvres et que les députés sont généralement riches ou s’enrichissent grâce à leur fonction. Les députés sont donc intéressés à faire des lois en faveur des riches. Il est vrai que si toutes les dispositions proposées par Robespierre étaient simultanément appliquées, les lois seraient aussi justes que possible. Il n’en demeurerait pas moins que les riches resteraient riches et puissants, ce qui, au final, ne changerait pas grand chose.
« Autant les peuples sont indolens ou facile à tromper, autant ceux qui les gouvernent sont habiles et actifs pour étendre leur pouvoir et opprimer la liberté publique ; c’est cette double cause qui a fait que les magistratures électives sont devenues perpétuelles et ensuite héréditaires. C’est l’histoire de tous les siècles, qui a prouvé qu’une loi prohibitive de la réélection est le plus sûr moyen de conserver la liberté. Parlez-vous d’un corps de représentans destinés à faire des lois, à être les interprètes de la volonté générale ? La nature même de leurs fonctions les rappelle impérieusement dans la classe des simples citoyens. Ne faut-il pas en effet qu’ils se trouvent dans la situation qui confond le plus leur intérêt et le vœu personnel avec celui du peuple ? Or, pour cela, il faut que souvent ils redeviennent peuple eux-mêmes. Mettez-vous à la place des simples citoyens, et dites de qui vous aimeriez mieux recevoir des lois, ou de celui qui est sûr de n’être bientôt plus qu’un citoyen ou de celui qui tient encore à son pouvoir par l’espérance de le perpétuer. [...]
« Vous dites que le corps législatif sera trop faible pour résister à la force du pouvoir exécutif, si tous les membres sont renouvelés tous les deux ans. [...] C’est dans votre système que le corps législatif sera trop faible pour résister, non pas à la force du pouvoir exécutif, mais à ses caresses et à ses séductions. Car, dès le moment où il sera assis sur les bases de la constitution, ce n’est pas à le détruire que le pouvoir exécutif s’appliquera, mais à le corrompre. [...]
« On a fait une autre objection qui ne me paraît pas plus raisonnable, lorsqu’on a dit que, sans l’espoir de la rééligibilité, on ne trouverait pas dans les vingt-cinq millions d’hommes qui peuplent la France, des hommes dignes de la législature. Ce qui me paraît évident, c’est que s’opposer à la réélection, est le véritable moyen de bien composer la législature. Quel est le motif qui doit appeler, qui peut appeler un citoyen vertueux à désirer ou à accepter cet honneur, le plus de ceux que la nation française puisse accorder à ses citoyens ? Sont-ce les richesses, le désir de dominer, et l’amour du pouvoir ? Non. Je n’en connais que deux : le désir de servir sa patrie : le second, qui est naturellement uni à celui-là, c’est l’amour de la véritable gloire, celle qui consiste, non dans l’éclat des dignités, ni dans le faste d’une grande fortune, mais dans le bonheur de mériter l’amour de ses semblables par des talens et des vertus. » (18 mai 1791) (Discours du 16 mai)
Le 1er août 1792, aux Jacobins, Robespierre qui était pourtant rééligible demanda que soit convoquée « une convention nationale, dont les membres seront élus directement par les assemblées primaires, et ne pourront être choisis parmi ceux de l’assemblée constituante ni de la première législature. »
Elections et votes à haute voix
Le 27 août 1792, alors que les élections pour la Convention approchaient, Robespierre qui présidait alors l’assemblée de la section de la place Vendôme proposa que, en raison des circonstances, les élections se fassent à haute voix et que le choix des députés soit soumis à l’examen des assemblées primaires. Ce mode d’élection fut adopté par toutes les sections de Paris. Le 5 novembre 1792, dans sa réponse à Louvet, il donna lui-même le détail de cette affaire :
« L'assemblée électorale avait arrêté unanimement que tous les choix qu'elle ferait seraient soumis à la ratification des assemblées primaires, et ils furent, en effet, examinés et ratifiés par les sections. A cette grande mesure, elle en avait ajouté une autre, non moins propre à tuer l'intrigue, non moins digne des principes d'un peuple libre, celle de statuer que les élections seraient faites à haute voix et précédées de la discussion publique des candidats. »
Le 10 mai 1793, dans son discours sur la constitution à donner à la France, il prôna de nouveau les délibérations et le vote à haute voix (voir plus loin). Du reste, comme il l’avait déjà demandé à la Constituante le 17 septembre 1791, et comme il l’inscrivit dans sa déclaration des droits, article 20, il était d’avis que les assemblées électorales soient totalement libres de régler leur police et d’adopter le mode de scrutin qui leur convenait. La Constitution de 1793 reprit à son compte cet article.
Des séances largement ouvertes au public
Le 6 décembre 1792, dans ses Lettres à ses commettants (titre de son nouveau journal), Robespierre fit une observation qui, dans l’esprit, rejoignait toutes ses propositions fondées sur les vertus de la lumière, par opposition aux vices de l’ombre.
« J’avoue que si quelque chose prouve à quel point nous sommes inconséquens dans notre conduite et mesquins dans nos institutions, c’est l’indifférence avec laquelle nous avons souffert que le Manège des Thuileries fut si long-tems le temple de la législation. On ne s’est pas même aperçu que la nature de ce local était incompatible avec la publicité, que nous semblions regarder comme la sauve-garde de la liberté. On ne peut pas dire que les représentans de 25 millions d’hommes délibèrent publiquement, lorsqu’ils ne peuvent être vus ou entendus que de trois ou quatre cents hommes entassés dans des cages étroites et incommodes. Etait-ce la publicité des tribunaux et des assemblées de Rome et des anciennes républiques ? Il y a avait un moyen simple et infaillible, et le seul peut-être de forcer les mandataires du peuple d’être digne de lui, et d’épargner à la patrie tous les maux qu’elle a soufferts, tous ceux qui la menacent encore ; c’était de les faire délibérer au moins sous les yeux de dix mille citoyens : nous n’y avons pas même pensé. Une magnifique salle d’opéra eût été bâtie en six semaines : après quatre ans, l’assemblée législative n’a pas encore un lieu décent, pour délibérer. »
Dans son discours sur la constitution à donner à la France, le 10 mai 1793, Robespierre affirma ce principe sous forme d’article :
« Les délibérations de la législature et de toutes les autorités constituées, seront publiques : la publicité qu'exige la Constitution est la plus grande publicité possible. La législature doit tenir ses séances dans un lieu qui puisse admettre douze mille spectateurs » (art. XIII).
Les tribunes de l’Assemblée nationale sont toujours aussi ridicules. Néanmoins la télévision permet à tous les « citoyens » qui le désirent d’assister à ses séances. Mais des téléspectateurs produisent-ils sur les législateurs le même effet que des spectateurs en chair et en os ?
Les députés sont les mandataires, non les représentants du peuple
Les lois faites par l’Assemblée doivent être ratifiées par le peuple
Robespierre aborda ces thèmes de manière implicite le 10 août 1791 lorsqu’il s’opposa à l’adoption de l’article suivant : « la nation, de qui émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation ».
« Il est impossible de prétendre, comme on l’a fait, que la nation était obligée de déléguer toutes les autorités, toutes les fonctions publiques ; qu’il n’y avait aucune manière d’en retenir aucune partie sans aucune modification que ce soit. Je n’examine pas un systême que l’assemblée a décrété, mais je dis que dans le systême de la constitution, on ne peut point rédiger l’article de cette manière ; on ne peut dire que la nation ne peut exercer ses pouvoirs que par délégation ; on ne peut dire qu’il y ait un droit que la nation n’ait point. On peut bien régler qu’elle n’en usera pas, mais on ne peut pas dire qu’il existe un droit dont la nation ne peut pas user si elle le veut. »
Le 16 juin 1793, à la Convention, il se montra plus explicite :
« Le mot représentant ne peut être appliqué à aucun mandataire du peuple, parce que la volonté ne peut se représenter. Les membres de la législature sont les mandataires à qui le peuple a donné la première puissance ; mais dans le vrai sens on ne peut pas dire qu’ils le représentent. La législature fait des lois et des décrets ; les lois n’ont le caractère de lois que lorsque le peuple les a formellement acceptées. Jusqu’à ce moment, elles n’étaient que des projets ; alors elles sont l’expression de la volonté du peuple. Les décrets ne sont exécutés avant d’être soumis à la ratification du peuple, que parce qu’il est censé les approuver : il ne réclame pas, son silence est pris pour une approbation. Il est impossible qu’un gouvernement ait d’autres principes. Ce consentement est exprimé ou tacite ; mais, dans aucun cas, la volonté souveraine ne se représente, elle est présumée. Le mandataire ne peut être représentant, c’est un abus de mot, et déjà en France on commence à revenir de cette erreur. »
Ce discours s’applique à tous les détenteurs d’autorité publique. Ils ne sont pas le peuple, ils ne sont que ses mandataires. Ils doivent être élus pour occuper légitimement leur fonction, mais l’élection ne leur confère pas la légitimité d’agir à leur guise : leurs actes ne sont légitimes qu’autant qu’ils sont approuvés par le peuple. Sans cette approbation, sans possibilité réelle pour le peuple de donner son accord ou de s’opposer à chacune des décisions de ses élus, le peuple n’est souverain que sur le papier et des élections ne sont qu’une mascarade démocratique.
Ce principe est celui qui impose l’approbation de la constitution par référendum. C’est celui qui fonde toute élection, tout référendum. C’est celui qui est systématiquement violé par une Assemblée qui édicte des lois sans que le peuple n’ait son mot à dire.
Que les élus sortants soient jugés
Le 10 mai 1793, dans le droit fil de son intervention du 25 juin 1790 sur l’inviolabilité des députés (voir plus haut), Robespierre proposa comme mesures constitutionnelles :
« XVI. Les membres de la législature ne pourront être poursuivis, par aucun tribunal constitué, pour raison des opinions qu'ils auront manifestées dans l'assemblée ; mais à l'expiration de leurs fonction, leur conduite sera solennellement jugée par le peuple qui les aura choisis. Le peuple prononcera sur cette question : tel citoyen a-t-il répondu oui ou non à la confiance dont le peuple l'a honoré ?
« XVII. Les faits positifs de corruption et de trahison qui pourraient être imputés aux fonctionnaires publics dont il est parlé aux deux articles précédens, seront jugés par le tribunal populaire, et leurs délits privés, par les tribunaux ordinaires.
« XVIII. Tous les membres de la législature et tous les membres de l'agence exécutive, seront tenus de rendre compte de leur fortune, deux ans après l'expiration de leur autorité. »
Considérer les gouvernants comme corruptibles, et le peuple bon
Le 21 avril 1793, dans sa déclaration des droits, Robespierre posa un principe essentiel, bien loin des conceptions des élites en général et de nos démocrates modernes en particulier, à savoir :
« Dans tout état libre, la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre l’autorité de ceux qui gouvernent. Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible est vicieuse. » (article 19)
L’article 9 de la déclaration officielle de 1793 ne retint que la première phrase.
Indemniser ceux qui servent la chose publique
Une disposition qui avait un sens dans le contexte du XVIIIe siècle et que Robespierre ne cessa de réclamer fut l’indemnisation des électeurs pauvres obligés de perdre le salaire d’une ou plusieurs journées de travail pour participer aux élections. Il fit cette proposition dès les élections pour les Etats Généraux. Le 29 mars 1789,
« Il représenta que l’Assemblée comptait parmi ses membres plusieurs Artisans qui avaient consacré aux affaires de la Commune, quatre journées nécessaires à leur subsistance ; et conclut que l’humanité et la justice exigeaient que la Commune leur payât au moins les modiques salaires qu’elles auraient pu leur procurer ».
Le 30 août 1791, Robespierre soutint, en vain, une députation des électeurs du Pas-de-Calais qui réclamait une indemnité pour les électeurs mobilisés depuis 18 mois.
Le 10 mai 1793, dans son discours sur la constitution à donner à la France, il déclara :
« Qu’importe que la loi rende un hommage hypocrite à l’égalité des droits, si la plus impérieuse de toutes les lois, la nécessité, force la partie la plus saine et la plus nombreuse du peuple à y renoncer ? Que la patrie indemnise l’homme qui vit de son travail lorsqu’il assiste aux assemblées publiques ; qu’elle salarie par la même raison d’une manière proportionnée tous les fonctionnaires publics ; que les règles des élections, que les formes des délibérations soient aussi simples, aussi abrégées qu’il est possible ; que les jours des assemblées soient fixés aux époques les plus commodes pour la partie laborieuse de la nation. »
En conséquence, il proposa l’article suivant :
« VIII. Afin que l'inégalité des biens ne détruise point l'égalité des droits, la Constitution veut que les citoyens qui vivent de leur travail, soient indemnisés du tems qu'ils consacrent aux affaires publiques, dans les assemblées du peuple où la loi les appelle. »
Dans le même esprit, Robespierre soutint, le 17 septembre 1793, la mesure faite adoptée par Danton le 5 septembre portant que les citoyens pauvres qui assisteraient aux assemblées de section seraient indemnisés à hauteur de 40 sous.
« Il n’y a que l’aristocratie qui puisse entreprendre de faire croire au peuple qu’il est avili, parce que la patrie vient au-devant de ses besoins, et qu’elle tâche de rapprocher la pauvreté de l’insolente richesse. Pourquoi donc cet avilissement qu’on prétend jeter sur l’homme qui reçoit une indemnité de la justice nationale ? Sommes-nous donc avilis, nous représentants du peuple, en recevant l’indemnité qu’il nous accorde pour subvenir à nos besoins ? »
On voit que Robespierre, constant, ne pronait pas cette mesure par démagogie, par populisme, mais bien par principe, celui qui veut que les citoyens se consacrent à la chose publique et soient donc en état de le faire au besoin grâce à un secours de la société sans lequel celle-ci serait doublement injuste. Il commença pas appliquer ce principe aux pauvres mais il l’appliquait à tous les citoyens, à tous les fonctionnaires. Ainsi, le 20 janvier 1791, il se proposait de lire à l’Assemblée un discours sur l’organisation des tribunaux criminels dans lequel était écrit ceci :
« L’égalité des droits, qui assure à tous les Citoyens la faculté d’être élus par la confiance publique, serait illusoire, si la différence des fortunes mettait le plus grand nombre d’entr’eux dans l’impossibilité physique de soutenir le poids des fonctions nationales. C’est pour cela que je regarde comme tenant essentiellement à la liberté, l’article par lequel je propose d’indemniser les Jurés. J’avoue qu’en général ce n’est pas sans allarmes, que j’ai vu introduire encore le systême de laisser sans salaire un grand nombre de Fonctionnaires publics. Ce n’est pas surtout sans étonnement, que j’ai entendu les Membres du Comité prononcer cette maxime nouvelle, que si les Jurés étaient indemnisés, cette institution serait déshonorée. Les Juges, les Administrateurs, sont donc déshonorés, parce que la justice, la dignité, l’intérêt de la société exigent qu’ils soient salariés ? Les Législateurs sont donc déshonorés ! Le Roi, sur-tout, doit être bien humilié de sa liste civile ! Je ne sais si cette espèce de délicatesse-là paraît à quelqu’un bien sublime ? pour moi, je la trouve ou bien puérile, ou bien perfide. Oui, le plus dangereux de tous les pièges que l’on peut tendre au patriotisme, la plus funeste manière de trahir le peuple, en le livrant à l’aristocratie des riches, c’est sans contredit d’accréditer cette absurde doctrine, qu’il est honteux de n’être pas assez riche, pour vivre, en servant la Patrie sans indemnité ; c’est d’oser mettre en parallèle, avec quelques dépenses nécessaires, l’intérêt sacré de la liberté et de la Patrie. »
Le 3 mars 1791, Robespierre s’opposa à ce que les indemnités des députés servent en tout ou partie à financer un projet de tontine viagère :
« Le salaire des Représentans de la Nation n’est point une propriété individuelle, c’est une propriété nationale. La Nation leur donne une indemnité, parce que l’intérêt exige que tous les Citoyens soient en état de remplir l’emploi qui leur est confié. Pour cela elle leur accorde une indemnité légère en soi, mais qui acquiert une grande importance, parce qu’elle est nécessaire au bien public. En conséquence, toute motion tendante à détourner de sa destination le salaire des Représentans de la Nation, n’est point un secours accordé aux malheureux, c’est l’anéantissement du principe le plus intéressant de l’intérêt général. »
Le 14 décembre 1792, il posa le principe de manière générale :
« Qu’arriverait-il si on refusait une indemnité en faveur d’un citoyen quelconque que les suffrages ont porté à des places qui ne lui permettent pas de vaquer à ses affaires particulières ? Il en arriverait que les citoyens, dont les facultés ne permettraient pas d’abandonner leurs moyens de subsistance ordinaire, se trouveraient écartés des places ; et certes, ne serait-ce pas alors que, par ce fait, le peuple perdrait sa souveraineté pour n’avoir pas les moyens d’exercer ses doits. »
Une démocratie, une nation
Robespierre n’a jamais abordé clairement la question du droit de cité. A qui appartient ce droit ? La réponse était pour lui évidente : aux citoyens français qui, ensemble, constituent le peuple souverain. La démocratie n’avait de sens que dans le cadre de la nation. Mais qu’est-ce qu’un citoyen français ? Il ne disserta jamais sur ce sujet qui, du reste, est double : un citoyen français possède à la fois la citoyenneté et la nationalité qui sont deux choses différentes. Ne pas distinguer ces deux concepts empêche de définir chacun d’eux convenablement, tandis que les confondre oblige à donner du tout une définition scabreuse (3). Parler de « droits naturels », comme le faisait Robespierre, tout en ne concevant les droits que dans la cadre d’une société induit le même genre d’acrobaties intellectuelles. Il est cependant possible d’avoir une position finale relativement juste à condition d’en appeler au bon sens et d’occulter ainsi les mauvais postulats qui ne peuvent être invoqués en tant que principes. C’est ainsi que, malgré quelque faiblesses dialectiques, l’intuition et le sens pratique évitèrent à Robespierre de tomber dans la démagogie universaliste qui de nos jours fait des ravages.
(3) La constitution de 1793 qui reprit en bonne partie les idées de Robespierre mais qui constituait malgré tout un compromis, définissait l’état de citoyen français comme suit :
ART. 4. Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété ou épouse une Française ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard ; tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - est admis à l'exercice des droits de citoyen français.
ART. 5. L'exercice des Droits de citoyen se perd par la naturalisation en pays étranger, par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire, par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
Aussi, ne partagea-t-il pas l’angélisme de la Constituante et des Girondins au sujet des étrangers. Les accueillir, donner asile aux persécutés, avoir pour eux certains égards est une chose ; leur accorder le droit de cité en est une autre, surtout en temps de guerre et de révolution. Sur ce point, ses interventions de plus en plus radicales ne laissent aucun doute sur ses positions qui, à l’heure de l’immigration massive, méritent d’être méditées.
Le 25 février 1793, aux Jacobins, Robespierre parla des troubles qui avaient eu lieu dans la journée dans la rue des Lombards :
« A côté des citoyens honnêtes, nous avons vu des étrangers et des hommes opulents, revêtus de l’habit respectable de sans-culotte. Nous en avons entendu dire : " On nous promettait l’abondance après la mort du roi, et nous sommes plus malheureux depuis que ce pauvre roi n’existe plus. " Nous en avons entendu déclamer, non pas contre la portion intrigante et contre-révolutionnaire de la Convention, qui siège où siégeaient les aristocrates de l’Assemblée constituante, mais contre la Montagne, mais contre la députation de Paris et contre les Jacobins, qu’ils représentaient comme accapareurs. »
Le 8 juin 1793, Robespierre proposa à la Convention de « faire une loi qui bannisse les étrangers ».
Le 29 juillet 1793, aux Jacobins, Robespierre demanda que les déserteurs étrangers soient arrêtés mais s’opposa à l’arrestation de tous les étrangers.
« Je demande qu’on envoie sur le champ une députation au maire de Paris et au commandant-général de la garde nationale parisienne, pour les engager à faire mettre en état d’arrestation tous les déserteurs qui se trouvent en ce moment dans la capitale. […] Je n’ai pas dû demander que tous les étrangers fussent arrêtés, car c’était le seul et le plus efficace moyen de les bannir sans ressource, or il en est un plus grand nombre, dont les lumières, les vertus et le patriotisme servent utilement la chose publique, mais vous ne devez pas mettre de ce nombre les déserteurs autrichiens qu’une longue habitude nous a rendus tous suspects. Je demande que les hommes, qu’un sentiment impérieux fait regarder comme des traîtres, que ces hommes qui ont eu l’audace de venir dans notre sein au nom de vos ennemis qui sont aussi ceux du peuple, que ces hommes enfin dont la conduite, d’après leur propre aveu, n’est pas exempte de louche, soient mis, mais mis seuls, en état d’arrestation ; s’ils sont innocens, nous saurons les dédommager de cette rigueur passagère ; s’ils sont coupables, ils doivent nous payer sans grâce les nombreux sacrifices que nous faisons toujours à la liberté. »
Le 1er août 1793, la Convention décréta l’arrestation des « étrangers des pays avec lesquels la République est en guerre, et non domiciliés en France avant le 14 juillet 1789. »
Le 6 septembre 1793, la Convention décréta l’arrestation des « étrangers nés sur le territoire des puissances avec lesquelles la République française est en guerre », jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement. Etaient exceptés les artistes et tous les ouvriers pour lesquels deux citoyens attesteraient le patriotisme, et tous ceux qui, n’étant ni l’un ni l’autre, avaient donné des preuves de civisme et d’attachement à la République.
Le 7 septembre 1793, la Convention décréta l’arrestation des banquiers étrangers, étant souvent soit des espions soit des agents de corruption, et la pose des scellés sur leurs papiers.
Le 16 octobre 1793, Robespierre appuya le rapport de Saint-Just portant l’arrestation de tous les ressortissants des puissances en guerre contre la République.
« Depuis le commencement de la Révolution, on a dû remarquer qu’il existe en France deux factions bien distinctes, la faction anglo-prusienne [Brissot, Petion, Clootz, etc.], et la faction autrichienne [Proli, Guzman, etc.], toutes deux réunies contre la République, mais divisées entre elles pour leurs intérêts particuliers. Vous avez porté un grand coup à la faction anglo-prussienne ; l’autre n’est pas morte, vous avez à la terrasser. Je le répète, je ne crois pas si légèrement à la philosophie des Anglais ; ceux qui sont dans ce cas, sont des prodiges. Je me défie indistinctement de tous ces étrangers dont le visage est couvert du masque du patriotisme, et qui s’efforcent de paraître plus républicains et plus énergiques que nous. Ce sont ces ardens patriotes qui sont les plus perfides artisans de nos maux. Ils sont les agens des puissances étrangères, car je sais bien que nos ennemis n’ont pas manqué de dire : Il faut que nos émissaires affectent le patriotisme le plus chaud, le plus exagéré, afin de pouvoir s’insinuer plus aisément dans nos Comités et dans nos assemblées ; ce sont eux qui sèment la discorde, qui rôdent autour des citoyens les plus estimables, autour des législateurs même les plus incorruptibles ; ils emploient le poison du modérantisme et l’art de l’exagération pour suggérer des idées plus ou moins favorables à leurs vue secrettes (On applaudit). Propose-t-on une mesure sage, mais cependant courageuse et calculée sur l’étendue des besoins de la patrie ? Ils disent aussitôt qu’elle est insuffisante, et demande une loi plus populaire en apparence, mais qui, par leurs menées, deviendrait un instrument de destruction. Propose-t-on une mesure plus douce, mais calculée encore sur les besoins de la patrie ? Ils s’écrient qu’il y a de la faiblesse, que cette mesure va perdre la patrie. Ce sont ces agens qu’il faut atteindre, c’est à eux qu’il faut parvenir en dépit de leur art perfide et du masque dont ils ne cessent de se couvrir. Ces agens là sont de tous les pays. Il y a des Espagnols, des Anglais, des Autrichiens ; il faut les frapper tous (Vifs applaudissemens). La mesure est rigoureuse, elle pourra atteindre quelques philosophes amis de l’humanité ; mais cette espèce est si rare, que le nombre des victimes ne sera pas grand. D’ailleurs, cette espèce est si généreuse et si magnanime, qu’elle ne s’aigrira pas contre les mesures qui doivent assurer la prospérité de la France, le bonheur du genre humain et de la terre même qui leur a donné le jour, et où la tyrannie domine encore (On applaudit). »
Le 12 décembre 1793, aux Jacobins, Robespierre proposa et obtint l’exclusion d’Anacharsis Clootz, autoproclamé Orateur du genre humain. Cette intervention est particulièrement d’actualité. C’est un cas d’école.
« Pouvons-nous regarder comme patriote un baron allemand ? Pouvons-nous regarder comme sans-culotte un homme qui a plus de cent mille livres de rente ? Pouvons-nous croire républicain l’homme qui ne vit qu’avec les banquiers [Vandenyver], les contre-révolutionnaires ennemis de la France ? non, Citoyens, mettons-nous en garde contre les étrangers qui veulent paraître plus patriotes que les Français eux-mêmes. Cloots, tu passes ta vie avec nos ennemis, avec les agens et les espions des puissances étrangères ; comme eux, tu es un traître qu’il faut surveiller. Citoyens, Cloots vient de tout vous expliquer ; il connaît les Vandenyver, et les connaissait pour des contre-révolutionnaires. Il vous assure qu’il a cessé de les voir, mais c’est encore là une fourberie de Prussien. Pourquoi donc, Cloots, si tu connaissais les Vandenyver pour des contre-révolutionnaires, es-tu venu solliciter leur élargissement au Comité de sûreté générale : parle, qu’as-tu à répondre.
« Mais ces inculpations sont peu de choses, quand il est question de M. Cloots. Ses trahisons tiennent à un système mieux ourdi. Citoyens, vous l’avez vu tantôt aux pieds du tyran et de la Cour, tantôt aux genoux du peuple... Lorsqu’une faction liberticide dominait au milieu de nous, lorsque les chefs tenaient les rênes du gouvernement, Cloots embrassa le parti de Brissot et de Dumouriez. Lorsque ces derniers servaient les puissances étrangères, et nous faisaient déclarer la guerre, le prussien Cloots appuyait leurs opinions avec frénésie ; il faisait des dons patriotiques, vantait les généraux, et voulait qu’on attaquât l’Univers... Sa conduite ne lui en attira pas moins le mépris de la faction. L’amour-propre lui fit publier un pamphlet intitulé "Ni Marat ni Roland". Il y donnait un soufflet à ce dernier, mais il en donnait un plus grand à la Montagne.
« J’accuse Cloots d’avoir augmenté le nombre des partisans du fédéralisme. Ses opinions extravagantes, son obstination à parler d’une République universelle, à inspirer la rage des conquêtes, pouvaient produire le même effet que les déclamations et les écrits séditieux de Brissot et de Lanjuinais. Et comment Cloots pouvait-il s’intéresser à l’unité de la République, aux intérêts de la France ; dédaignant le titre de citoyen français, il ne voulait que celui de citoyen du monde. Eh ! s’il eût été bon Français, eût-il voulu que nous tentassions la conquête de l’Univers ? Eût-il voulu que nous fissions un département français du Monomotapa ? Eût-il voulu que nous déclarassions la guerre à toute la terre et à tous les élémens ? [...]
« Il est une troisième crise dont M. Cloots pourra se vanter, mais ce ne sera que devant des imbecilles ou des fripons... Je veux parler du mouvement contre le culte, mouvement qui, mûri par le temps et la raison, eût pu devenir excellent, mais dont la violence pouvait entraîner les plus grands malheurs, et qu’on doit attribuer aux calculs de l’aristocratie... Gobel, dont vous connaissez tous la conduite politique, était du nombre de ces prêtres qui se plaignaient de la réduction de leurs traitemens, et dont l’ambition voulait ressusciter l’hydre du ci-devant clergé... Et cependant nous avons vu cet évêque changer subitement de ton, de langage et d’habit, se présenter à la barre de la Convention nationale, et nous offrir ses lettres de prêtrise. Eh ! Cloots, nous connaissons tes visites et tes complots nocturnes. Nous savons que, couvert des ombres de la nuit, tu as préparé avec l’évêque Gobel cette mascarade philosophique. Tu prévoyais les suites funestes que peuvent avoir de semblables démarches ; par cela même, elles n’en plaisaient que davantage à nos ennemis.
« Cloots croyait sans doute que les vrais amis du peuple avaient pris le change et étaient dupes de ces mascarades. Il vint se targuer au Comité de ce bel exploit... " Mais, lui dis-je, vous nous avez dit dernièrement qu’il fallait entrer dans les Pays-Bas, leur rendre l’indépendance, et traiter les habitans comme des frères... Pourquoi donc cherchez-vous à nous aliéner les Belges en heurtant des préjugés auxquels vous les savez fortement attachés ? ... — Oh ! oh ! répondit-il, le mal était déjà fait... On nous a mille fois traités d’impies. — Oui, mais il n’y avait pas de faits " (Cloots pâlit, n’osa pas répondre et sortit). Citoyens, regarderez-vous comme patriote un étranger qui veut être plus démocrate que les Français et qu’on voit tantôt au Marais, tantôt au-dessus de la Montagne ? car jamais Cloots ne fut à la Montagne ; il fut toujours au-dessous ou au-dessus. Jamais il ne fut le défenseur du peuple français mais celui du genre humain.
« Citoyens, je vous prie de faire une réflexion : quand nous avons décrété des lois rigoureuses contre les nobles, Cloots a été excepté ; quand nous avons décrété l’arrestation des étrangers, Cloots a encore été excepté ; que dis-je excepté ! dans ce moment-là même, Cloots fut élu président des jacobins [le 9 novembre, jusqu’au 30] : donc, par une conséquence infaillible, le parti de l’étranger domine au milieu des Jacobins. »
Cette tirade contre Clootz n’était pas la première. Le 2 janvier 1792, au moment des discussions sur la guerre, à laquelle Clootz était favorable, Robespierre s’en était déjà pris à lui.
« Puisque l'orateur du genre humain pense que la destinée de l'univers est liée à celle de la France, qu'il défende avec plus de réflexion les intérêts de ses clients, ou qu'il craigne que le genre humain ne lui retire sa procuration. Laissez donc, laissez toutes ces trompeuses déclamations, ne nous présentez pas l'image touchante du bonheur, pour nous entraîner dans des maux réels ; donnez-nous moins de descriptions agréables, et de plus sages conseils. »
Relevons cette lettre de Saint-Just et Lebas, en mission à Strasbourg, qui, le 14 décembre 1793, annoncèrent à Robespierre qu’ils envoyaient au Comité de salut public l’accusateur public Euloge Schneider, « un ci-devant prêtre, un sujet de l’Empereur. Il sera, avant son départ, exposé sur l’échafaud de la guillotine. Cette punition, qu’il s’est attiré par sa conduite insolente, a été aussi commandée par la nécessité de réprimer les étrangers. Ne croyons pas les charlatans cosmopolites, et ne nous fions qu’à nous mêmes. »
Le 25 décembre 1793, suite au rapport de Robespierre sur les principes du gouvernement révolutionnaire, la Convention décréta qu’« aucun étranger ne pourra être admis à représenter le peuple français. » Le lendemain, elle les exclut de toutes les fonctions publiques.
Les révolutionnaires en général et Robespierre en particulier n’étaient ni chauvins ni xénophobes, mais ils n’étaient pas naïfs et l’expérience leur apprit à se méfier des étrangers, immigrés ou réfugiés, qui, poursuivant leurs intérêts ou agissant pour le compte de puissances étrangères, poussèrent souvent aux maladresses et aux excès préjudiciables à la Révolution, quand ils ne trempèrent pas dans des affaires de corruption. L’heure était alors trop grave pour ne pas prendre de précautions légitimes à leur sujet.
Quoi qu’il en soit, il ressort que, aux yeux de Robespierre, les étrangers ayant par nature un point de vue étranger ne devaient pas avoir le droit de cité en France. Ce fondateur de la gauche considèrerait sans aucun doute comme des traîtres et des démagogues criminels ceux qui aujourd’hui nient la France et le peuple français, crachent sur le patriotisme, prônent l’immigration à outrance, croient qu’il suffit de sacraliser l’immigré pour être de gauche, considèrent comme d’extrême droite ceux qui n’acceptent pas l’invasion de leur pays, substituent la préférence étrangère à la préférence nationale, tolèrent la double nationalité, vantent le multiculturalisme, débinent la démocratie sous le nom de populisme et réclament dans le même temps le droit de vote pour les étrangers.
Le respect des lois
Le 17 juin 1792, dans son Défenseur de la Constitution, Robespierre publia un article particulièrement important sur « le respect du aux lois et aux autorités constituées ». Il contient tant de choses en rapport avec le sujet qu’il mérite d’être cité in extenso.
« Les lois sont les conditions et le lien de la société ; tout membre de la société qui leur refuse l’obéissance, cesse de l’être par celle même.
« Les lois peuvent être considérées sous deux aspects, par rapport au souverain, c’est-à-dire à la nation ; par rapport aux sujets, c’est-à-dire aux individus.
« Le souverain est au-dessus des lois ; le sujet doit leur être toujours soumis. La nation peut changer, à son gré, la loi qui est son ouvrage ; chaque citoyen est toujours obligé de la respecter.
« Quiconque veut maintenir, par la force ou par artifice, une loi que la volonté de la nation a proscrite, est rebelle à la loi ; il se révolte contre le souverain même en qui réside la puissance législative. Alors la loi même a cessé de l’être, quoiqu’elle conserve encore ce nom, et qu’elle continue d’obtenir une soumission forcée. C’est en vain qu’Appius et les décemvirs, étendant leur autorité au de là des bornes et de la durée que le peuple a prescrites, commandent encore aux Romains, au nom de la loi ; la loi réclame contre leur tyrannie ; elle n’attend que la mort de Virginie et le réveil du peuple, pour punir les tyrans.
« Aussi long-tems que la majorité exige le maintien de la loi, tout individu qui la viole, est rebelle. Qu’elle soi sage ou absurde, juste ou injuste, il n’importe ; son devoir est de lui rester fidèle.
« Telle est la nature du respect qu’il lui doit : l’obéissance.
« Quant au respect, qui est un sentiment, qui suppose l’adhésion du cœur et de l’esprit à la sagesse ou à la justice de la loi, nulle puissance humaine ne peut l’imposer, et le maintien de l’ordre ne l’exige pas. Il dépend de l’opinion qui est essentiellement libre et indépendante. Le législateur n’est point infaillible, fût-il le peuple lui-même. Les chances de l’erreur sont bien plus nombreuses encore, lorsque le peuple délègue l’exercice du pouvoir législatif à un petit nombre d’individus ; c’est-à-dire, lorsque c’est seulement par fiction que la loi est l’expression de la volonté du plus grand nombre, ou ce qui est présumé l’être ; mais je ne respecte que la justice et la vérité. J’obéis à toutes les lois ; mais je n’aime que les bonnes. La société a droit d’exiger ma fidélité, mais non le sacrifice de ma raison : telle est la loi éternelle de toutes les créatures raisonnables.
« Si les bonnes lois ont, seules, droit à cette sorte de respect, elles sont sûres aussi de l’obtenir. La sagesse a sur les hommes un empire naturel ; et tous obéissent avec joie, quand c’est l’intérêt général qui commande. Les bonnes lois amènent de bonnes mœurs qui, à leur tour, cimentent leur puissance. Est-il quelques individus pervers ou égarés par l’intérêt personnel ? La volonté générale les contient, et la force publique les subjugue facilement. Tels sont les élémens simples de l’ordre social et de l’économie politique. Ils sont établis pour des hommes, ils doivent être fondés sur la morale et sur l’humanité. Si je vois le législateur suivre des principes opposés, je ne reconnais plus le législateur ; j’aperçois un tyran.
« Le législateur place dans la loi elle-même le principe de la soumission des citoyens ; il sait que, quand la volonté générale se fait entendre, il ne faut pas tant d’appareil pour la faire exécuter. Le législateur a plus de confiance dans la nature humaine ; il cherche à l’élever, à la perfectionner : le tyran la calomnie ; il avilit le peuple, il fait toujours marcher la loi au milieu des armes et des bourreaux, parce que la loi qu’il fait n’est qu’une volonté injuste et particulière, opposée à celle de la société entière. L’obéissance ne lui suffit pas, il impose un morne silence ; il exige pour ses lois un culte superstitieux et une croyance aveugle ; il punit, comme des blasphèmes, les écrits et les discours qui dévoilent ses erreurs et ses crimes. Il veut ravir aux hommes jusqu’aux moyens de perfectionner leur raison et leur bonheur, en leur défendant de s’éclairer mutuellement sur leurs intérêts les plus chers ; il feint de redouter la liberté des opinions, pour l’autorité des lois : il ne la craint que pour son ambition, pour sa cupidité, pour son ineptie.
« Chez un peuple libre et éclairé, le droit de censurer les actes législatifs est aussi sacré que la nécessité de les observer est impérieuse. C’est l’exercice de ce droit qui répand la lumière, qui répare les erreurs politiques, qui affermit les bonnes institutions, amène la réforme des mauvaises, conserve la liberté, et prévient le bouleversement des états. La démonstration des vices d’une loi ne la détruit pas ; mais elle prépare doucement l’opinion publique à en désirer l’abrogation ; elle dispose sensiblement l’autorité souveraine à la réaliser. La loi n’est que l’expression de la volonté générale : la volonté générale n’est que le résultat des lumières générales ; et les lumières générales ne peuvent être formées et accrues, que par la libre communication des pensées entre les citoyens. Quiconque met des entraves à ce commerce sublime détruit l’essence même de la loi ; il en étouffe le germe, qui est la raison publique ; il paralyse la puissance législative elle-même.
« Sous le gouvernement représentatif, surtout, c’est-à-dire, quand ce n’est point le peuple qui fait les lois, mais un corps de représentans, l’exercice de ce droit sacré est la seule sauve-garde du peuple contre le fléau de l’oligarchie. Comme il est dans la nature des choses que les représentans peuvent mettre leur volonté particulière à la place de la volonté générale, il est nécessaire que la voix de l’opinion publique retentisse sans cesse autour d’eux, pour balancer la puissance de l’intérêt personnel et les passions individuelles ; pour leur rappeler, et le but de leur mission et le principe de leur autorité. Là, plus qu’ailleurs, la liberté de la presse est le seul frein de l’ambition, le seul moyen de ramener le législateur à la règle unique de la législation. Si vous l’enchaînez, les représentans, déjà supérieurs à toute autorité, délivrés encore de la voix importune de ces censeurs, éternellement caressés par l’intérêt et par l’adulation, deviennent les propriétaires ou les usufruitiers paisibles de la fortune et des droits de la nation ; l’ombre même de la souveraineté disparaît, il ne reste que la plus cruelle, la plus indestructible de toutes les tyrannies ; c’est alors qu’il est au moins difficile de contester la vérité de l’anathème foudroyant de Jean-Jacques Rousseau contre le gouvernement représentatif absolu.
« Les principes que nous avons exposés, s’appliquent aux autorités constituées : mais il y a là-dessus des idées bien intéressantes à développer, et des notions bien confuses à éclaircir.
« Les autorités constituées ont droit au même respect que la loi, puisque c’est la loi qui les a établies. Les actes publics qui en émanent doivent obtenir la soumission, sans ôter la liberté des opinions sur leur conformité aux règles de la justice. Mais il ne faut pas les confondre avec les hommes qui les exercent, il faut soigneusement distinguer le magistrat de l’individu. Les fonctionnaires publics de tous les pays commettent assez généralement, à cet égard, une erreur aussi funeste que commune. Ils ont coutume de rejeter sur la perversité des peuples les désordres de la société ; ils les accusent de rebellion, lorsqu’eux seuls sont coupables d’orgueil et d’injustice, et de tout tems ce grand procès fut décidé contre les peuples ; car ce sont les fonctionnaires publics qui le jugent. Ceux-ci sont naturellement enclins à s’identifier eux-mêmes avec l’autorité publique qui leur est confiée ; ils se croient propriétaires de ce dépôt, et en disposent sans scrupule au profit de leur vanité, de leur ambition, et de leur cupidité ; ils mettent sans façon leurs personnes à la place de la nation. Comment se regarderaient-ils comme ses mandataires ? jamais la nation ne se présente devant eux, avec les traits auguste du souverain ; ils ne voient que des individus dans l’humble attitude de supplians ou de courtisans ! Font-ils quelque bien ? Ils croient accorder une grâce ! Font-ils quelque mal ! Ils croient exercer un droit . De là, tous les égaremens de l’orgueil et tous les crimes de la tyrannie. Ceux qu’ils oppriment osent se plaindre ? Ils crient à la désobéissance, à la rebellion. Ils invoquent le respect dû aux autorités constituées ; ils jurent que la tranquillité publique est troublée ; ils les immolent au nom de la loi.
« Pour arracher l’espèce humaine à cet avilissement, il faut lui rappeler les véritables principes du gouvernement ; il faut retracer, aux yeux des gouvernans et des gouvernés, leurs droits et leurs devoirs. Les emplois publics ne sont ni des honneurs, ni des prérogatives ; ce sont des charges. Ceux qui les exercent ne sont pas les dominateurs des peuples, mais leurs chargés d’affaires. Tout citoyen doit obéissance au magistrat ; hors de l’exercice de ses fonction, le magistrat n’est plus qu’un individu, l’égal de ses concitoyens. Le magistrat doit à la nation respect et fidélité ; Sa dignité, c’est le choix du peuple ; ses distinctions sont ses vertus ; ses privilèges, ses devoirs, sa gloire, de bien servir la patrie.
« Malheureusement les serviteurs du peuple ne se chargent bien souvent de ses affaires que pour faire les leurs ; et ils les font de telle manière que bientôt ils le ruinent, le dépossèdent et le forcent à les servir lui-même. Sous quelle autre idée peut-on se représenter les despotes orgueilleux et les magistrats prévaricateurs ? Presque partout le véritable souverain est détrôné, le père de famille chassé de son patrimoine, et le monde ne présente qu’une triste et ridicule comédie où les valet insultent à leur maître après l’avoir dépouillé.
« " Les peuples seront heureux, disait Platon, lorsque les magistrats deviendront philosophes ou lorsque les philosophes deviendront magistrats ". En quoi consiste cette philosophie ? à savoir qu’il ne faut point voler le bien d’autrui ; que, si c’est un crime d’attenter à la propriété des individus, ce n’est point une vertu de ravir celle des nations ; qu’une injustice ne devient ni plus légitime, ni moins odieuse, lorsqu’elle fait le malheur, non d’un citoyen et d’une famille, mais du genre humain, que ceux qui punissent le brigandage et le meurtre ne doivent pas être eux-mêmes les plus coupables des brigands et des assassins.
« Combien cette simple règle de morale épargnerait aux hommes de dissensions et de calamités ? Alors au moins ceux qui gouvernent, s’appliqueraient à bien gouverner, et non à faire croire qu’ils gouvernent bien. Ils ne commanderaient pas la confiance et l’estime, comme on lève un impôt ; ils la mériteraient. La mériter, est le seul moyen de l’obtenir : la réclamer éternellement, seulement par des paroles, et en faire une maxime du gouvernement, c’est avertir qu’on en est indigne. L’économe fidèle aime bien agir sous l’œil du maître, et lui rendre compte. Celui qui le conjure de fermer les yeux, et qui affecte de regarder sa surveillance comme une injure, en prouve clairement la nécessité. Tout fonctionnaire public qui montre une vive sensibilité pour les imputations dont il est l’objet, qui prétend qu’on avilit les autorités constituées toutes les fois qu’on censure sa conduite, est un mandataire qui crie à ses commettans de fermer les yeux, parce qu’il a quelque trame perfide à achever contre le salut et contre la liberté du peuple. Le peuple doit toujours avoir les yeux ouvert sur ses agens, comme le père de famille sur ses serviteurs.
« Cette doctrine n’est pas celle des tyrans : mais, sans doute, elle est celle de la raison, de la justice et de la nature. Si vous croyez les tyrans, elle n’est bonne qu’à troubler la tranquillité publique, et à renverser la société.
« Quant à la société, ce sont les tyrans qui la détruisent ; car il est impossible de reconnaître une société légitime dans ce partage où tous les avantages et toute la puissance appartiennent à un seul ou à plusieurs, la servitude, la misère et l’opprobre à tous. La tranquillité ! Ah ! sans doute, il est facile d’avoir la paix avec les brigands, si vous leur abandonnez le trésor qu’ils veulent vous ravir. Mais l’esclavage est-il la tranquillité ? Non, c’est la mort. La tranquillité, c’est l’ordre public, c’est l’harmonie sociale. Peut-elle exister sans la justice, sans la liberté, sans le bonheur ? Quels sont ceux qui la troublent ? Sont-ce les tyrans qui violent les droits des peuples, ou les peuples qui les réclament ? Peuples, tyrans, voilà toute votre cause ; que la raison, que l’humanité la juge une fois, et non la force et le despotisme. »
En résumé, selon Robespierre, la démocratie qui suppose que les citoyens soient égaux en droits et jouissent de tous les droits que la société est susceptible de leur garantir (afin qu’ils puissent exercer toutes leurs facultés) implique des mesures de trois ordres.
Premièrement, qu’ils jouissent de leurs droits ou qu’ils aient à les conquérir, les citoyens doivent pouvoir les connaître, les revendiquer et le cas échéant les défendre, d’où l’attachement de Robespierre à la liberté illimitée de la presse, au droit de pétition individuel et collectif et à celui, pour tous, d’être armés ou, du moins, de pouvoir faire partie de la garde nationale.
Deuxièmement, faute d’un législateur suprême juste et inamovible, les lois, pour être légitimes, le plus justes possible et dès lors respectables, doivent être l’ouvrage direct ou indirect du peuple même, d’où l’attachement de Robespierre pour la ratification des lois par le peuple, quels que soient les législateurs (Cette disposition consacre à elle seule la souveraineté du peuple. Si le peuple est bien le souverain, il n'y a aucun obstacle aux dispositions secondaires qui deviennent presque superflues.), et la possibilité pour tous d’être éligibles et de participer aux élections des députés, d’où le suffrage universel et l’indemnisation des électeurs pauvres.
Troisièmement, dans le cas où les précautions précédentes ne seraient pas prises, l’honnêteté devrait suppléer. Autrement dit tout doit être fait pour que les citoyens ayant droit de cité élisent des hommes honnêtes et que les élus, une fois en fonction, soient contraints à l’honnêteté. Etant toujours plus difficile de guérir que de prévenir, c’est ici que les précautions se multiplient et portent sur les différentes étapes des mandats : avant, pendant et après.
Afin que le choix des députés soit le plus judicieux possible, et non le fruit de l’intrigue, les assemblées électorales doivent être libres de régler leur police, quoiqu’elles soient invitées à procéder aux élections à haute voix.
Afin que l’assemblée législative ne trompe pas le peuple et que les députés ne soient pas détournés de leur mission par l’ambition et la corruption, il faut en premier lieu que ces derniers soient salariés (pour ne pas être payés par d’autres, d’après le mot de Buzot, 3 mars 1791), qu’ils ne puissent être nommés à quelque poste que ce soit par le pouvoir exécutif, qu’ils soient au contraire révocables à volonté par leurs mandants, que leur mandat soit court et qu’ils n’en aient pas d’autres, qu’ils ne soient pas immédiatement rééligibles, qu’ils soient nombreux et qu’ils délibèrent sous les yeux d’un vaste public.
Enfin, au cas où certains auraient malgré tout trouvé le moyen d’être infidèles en tant que législateurs ou malhonnêtes en tant qu’individus, ils doivent rendre compte de leur mandat à leurs mandants et être à jamais exclus des fonctions publiques si ces derniers leur refusent leur confiance ; ils doivent en outre être en permanence justiciables devant un tribunal spécial des abus de pouvoir et des délits de droit commun.
On pourrait ajouter un quatrième niveau, une dernière sauvegarde : ce serait les dispositions du premier niveau qui permettent de faire pression moralement et physiquement sur les législateurs, voire de passer outre : liberté de la presse, droit de pétition, auquel il faudrait ajouter celui de provoquer des référendums, et droit d’être armé. Alors la boucle serait bouclée.
Maintenant, pour faire tout à fait œuvre utile, il ne saurait être question d’achever cette étude sans présenter in extenso les deux textes dont nous avons déjà donné quelques extraits et qui fondent le robespierrisme et, partant, le jacobinisme authentique, à savoir la déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon Robespierre, proposée aux Jacobins et adoptée par eux le 21 avril 1793, et son discours sur la constitution à donner à la France, fait à la Convention le 10 mai 1793.
Droits de l’homme et du citoyen, selon Robespierre (21 avril 1793)
Les représentants du peuple Français réunis en convention nationale, reconnaissant que les lois humaines qui ne découlent point des lois éternelles de la justice, ne sont que des attentats de l’ignorance et du despotisme contre l’humanité ; convaincus que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des crimes et des malheurs du monde, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l’objet de sa mission. En conséquence, la convention nationale proclame, à la face de l’univers et sous les yeux du législateur immortel, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.
ARTICLE Premier — Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, et le développement de toutes ses facultés.
ART. 2 — Les principaux droits de l’homme sont ceux de pourvoir à la conservation de l’existence et la liberté.
ART. 3 — Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la différence de leurs forces physiques et morales. L’égalité des droits est établie par la nature ; la société, loin d’y porter atteinte, ne fait que la garantir contre l’abus de la force qui la rend illusoire.
ART. 4 — La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme, d’exercer à son gré toutes ses facultés ; elle a la justice pour règle, les droits d’autrui pour bornes, la nature pour principe, et la loi pour sauvegarde.
ART. 5 — Le droit de s’assembler paisiblement, le droit de manifester ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, sont des conséquences si nécessaires du principe de la liberté de l’homme, que la nécessité de les énoncer suppose ou la présence, ou le souvenir récent du despotisme.
ART. 6 — La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer à son gré de la portion de bien qui lui est garantie par la loi.
ART. 7 — Le droit de propriété est borné comme tous les autres par l’obligation de respecter les droits d’autrui.
ART. 8 — Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables.
ART. 9 — Tout trafic qui viole ce principe est essentiellement illicite et immoral.
ART. 10 — La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.
ART. 11 — Les secours indispensables à celui qui manque du nécessaire, sont une dette de celui qui possède le superflu. Il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée.
ART. 12 — Les citoyens, dont les revenus n’excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance, sont dispensés de contribuer aux dépenses publiques ; les autres doivent les supporter progressivement selon l’étendue de leur fortune.
Cet article ne figure pas dans la version que Robespierre publia dans ses Lettres à ses commettans. Il avait réalisé que dispenser une partie des citoyens de payer des impôts serait en faire une classe de citoyens à part, division qui donnerait des arguments aux partisans du suffrage censitaire. Le 17 juin 1793, à la Convention, alors que certains soutenaient l’exonération des pauvres, il déclara : « J’ai partagé un moment l’erreur de Ducos, je crois même l’avoir écrite quelque part ; mais j’en reviens aux principes, et je suis éclairé par le bon sens du peuple, qui sent que l’espèce de faveur qu’on lui présente n’est qu’une injure. En effet, si vous décrétez, sur-tout constitutionnellement, que la misère excepte l’honorable obligation de contribuer aux besoin de la patrie, vous décrétez l’avilissement de la partie la plus pure de la Nation ; vous décrétez l’aristocratie des richesses, et bientôt vous verriez ces nouveaux aristocrates, dominant dans les législatures, avoir l’odieux machiavélisme de conclure que ceux qui ne payent point les charges ne doivent point partager les bienfaits du gouvernement ; il s’établirait une classe de prolétaires, une classe d’ilotes, et l’égalité et la liberté périraient pour jamais. N’ôtez point aux citoyens ce qui leur est le plus nécessaire, la satisfaction de présenter à la République le denier de la veuve. Bien loin d’écrire dans la Constitution une distinction odieuse, il faut au contraire y consacrer l’honorable obligation pour tout citoyen de payer les contribution. Ce qu’il y a de populaire, ce qu’il y a de juste, c’est le principe consacré dans la déclaration des droits, que la société doit le nécessaire à tous ceux qui ne peuvent se le procurer par leur travail. Je demande que ce principe soit inséré dans la Constitution, que le pauvre qui doit une obole pour la contribution, la reçoive de la patrie pour la reverser dans le trésor public. » Sa proposition fut adoptée. Pourtant, dans la rubrique Contributions publiques, la Constitution indiqua simplement : « Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques. » (article 101).
ART. 13 — La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.
ART. 14 — Le peuple est le souverain ; le gouvernement est son ouvrage et sa propriété ; les fonctionnaires publics sont ses commis. Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement et révoquer ses mandataires.
ART. 15 — La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté du peuple.
ART. 16 — La loi doit être égale pour tous.
ART. 17 — La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société ; elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile.
ART. 18 — Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l’homme, est essentiellement injuste et tyrannique ; elle n’est point une loi.
ART. 19 — Dans tout état libre, la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre l’autorité de ceux qui gouvernent. Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible est vicieuse.
ART. 20 — Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais le vœu qu’elle exprime doit être respecté comme le vœu d’une portion du peuple, qui doit concourir à former la volonté générale. Chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté ; elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées, et maîtresse de régler sa police et ses délibérations.
ART. 21 — Tous les citoyens sont admissibles à toutes les fonctions publiques, sans aucune autre distinction que celle des vertus et des talents, sans aucun autre titre que la confiance du peuple.
ART. 22 — Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à la nomination des mandataires du peuple et à la formation de la loi.
ART. 23 — Pour que ces droits ne soient point illusoires et l’égalité chimérique, la société doit salarier les fonctionnaires publics, et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail, puissent assister aux assemblées publiques où la loi les appelle, sans compromettre leur existence ni celle de leur famille.
ART. 24 — Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et aux agents du gouvernement, lorsqu’ils sont les organes ou les exécuteurs de la loi.
ART. 25 — Mais tout acte contre la liberté, contre la sûreté ou contre la propriété d’un homme, exercé par qui que ce soit, même au nom de la loi, hors des cas déterminés par elle et des formes qu’elle prescrit, est arbitraire et nul ; le respect même de la loi défend de s’y soumettre ; et si on veut l’exécuter par la violence, il est permis de le repousser par la force.
ART. 26 — Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique appartient à tout individu. Ceux à qui elles sont adressées, doivent statuer sur les points qui en font l’objet ; mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en restreindre, ni en condamner l’exercice.
ART. 27 — La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme et du citoyen.
ART. 28 — Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre du corps social, lorsque le corps social est opprimé.
ART. 29 — Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
ART. 30 — Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de défendre lui-même tous ses droits.
ART. 31 — Dans l’un et l’autre cas, assujettir à des formes légales la résistance à l’oppression, est le dernier raffinement de la tyrannie.
ART. 32 — Les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs publics.
ART. 33 — Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
ART. 34 — Le peuple a le droit de connaître toutes les opérations de ses mandataires ; ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion, et subir son jugement avec respect.
ART. 35 — Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s’entraider selon leur pouvoir comme les citoyens du même état.
ART. 36 — Celui qui opprime une seule nation se déclare l’ennemi de toutes.
ART. 37 — Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l’homme, doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles.
ART. 38 — Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu’ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre qui est le genre humain, et contre le législateur de l’univers qui est la nature.
Discours sur la Constitution à donner à la France (10 mai 1793)
« L'homme est né pour le bonheur et pour la liberté, et partout il est esclave et malheureux ! La société a pour but la conservation de ses droits et la perfection de son être, et partout la société le dégrade et l'opprime ! Le temps est arrivé de le rappeler à ses véritables destinées ; les progrès de la raison humaine ont préparé cette grande révolution, et c'est à vous qu'est spécialement imposé le devoir de l'accélérer.
« Pour remplir votre mission, il faut faire précisément tout le contraire de ce qui a existé avant vous.
« Jusqu’ici l'art de gouverner n'a été que l'art de dépouiller et d’asservir le grand nombre au profit du petit nombre, et la législation le moyen de réduire ces attentats en système : les rois et les aristocrates ont très bien fait leur métier ; c'est à vous maintenant de faire le vôtre, c'est-à-dire de rendre les hommes heureux et libres par les lois.
« Donner au gouvernement la force nécessaire pour que les citoyens respectent toujours les droits des citoyens, et faire en sorte que le gouvernement ne puisse jamais les violer lui-même, voilà à mon avis le double problème que le législateur doit chercher à résoudre. Le premier me paraît très facile : quant au second, on serait tenté de le regarder comme insoluble si l'on ne consultait que les événements passés et présents sans remonter à leurs causes.
« Parcourez l'histoire : vous verrez partout les magistrats opprimer les citoyens, et le gouvernement dévorer la souveraineté ; les tyrans parlent de séditions ; le peuple se plaint de la tyrannie quand le peuple ose se plaindre, ce qui arrive lorsque l'excès de l'oppression lui rend son énergie et son indépendance. Plût à Dieu qu'il pût les conserver toujours ! Mais le règne du peuple est d'un jour ; celui des tyrans embrasse la durée des siècles.
« J'ai beaucoup entendu parler d'anarchie depuis la révolution du 14 juillet 1789, et surtout depuis la révolution du 10 août 1792 ; mais j'affirme que ce n'est point l'anarchie qui est la maladie des corps politiques, mais le despotisme et l'aristocratie. Je trouve, quoiqu'ils en aient dit, que ce n'est qu'à compter de cette époque tant calomniée que nous avons eu un commencement de lois et de gouvernement, malgré les troubles qui ne sont autre chose que les dernières convulsions de la royauté expirante, et la lutte d'un gouvernement infidèle contre l'égalité.
« L'anarchie a régné en France depuis Clovis jusqu'au dernier des Capets. Qu'est-ce que l'anarchie, si ce n'est la tyrannie, qui fait descendre du trône la nature et la loi pour y placer des hommes ?
« Jamais les maux de la société ne viennent du peuple, mais du gouvernement. Comment n'en serait-il pas ainsi ? L'intérêt du peuple c'est le bien public ; l'intérêt de l'homme en place est un intérêt privé. Pour être bon, le peuple n'a besoin que de se préférer lui-même à ce qui n'est pas lui ; pour être bon il faut que le magistrat s'immole lui-même au peuple.
« Si je daignais répondre à des préjugés absurdes et barbares, j'observerais que ce sont le pouvoir et l'opulence qui enfantent l'orgueil et tous les vices ; que c'est le travail, la médiocrité, la pauvreté, qui sont les gardiens de la vertu ; que les vœux du faible n'ont pour objet que la justice et la protection des lois bienfaisantes ; qu'il n’estime que les passions de l'honnêteté ; que les passions de l’homme puissant tendent à s'élever au-dessus des lois justes, ou à en créer de tyranniques ; je dirais enfin que la misère des citoyens n'est autre chose que le crime des gouvernements. Mais j'établis la base de mon système par un seul raisonnement.
« Le gouvernement est institué pour faire respecter la volonté générale ; mais les hommes qui gouvernent ont une volonté individuelle, et toute volonté cherche à dominer ; s'ils emploient à cet usage la force publique dont ils sont armés, le gouvernement n'est que le fléau de la liberté. Concluez donc que le premier objet de toute Constitution doit être de défendre la liberté publique et individuelle contre le gouvernement lui-même.
« C'est précisément cet objet que les législateurs ont oublié ; ils se sont tous occupés de la puissance du gouvernement ; aucun n'a songé aux moyens de le ramener à son institution ; ils ont pris des précautions infinies contre l'insurrection du peuple et ils ont encouragé de tout leur pouvoir la révolte de ses délégués. J'en ai déjà indiqué les raisons ; l'ambition, la force, et la perfidie ont été les législateurs du monde ; s’ils ont asservi jusqu'à la raison humaine en la dépravant, et l'ont rendue complice de la misère de l’homme ; le despotisme a produit la corruption des mœurs et la corruption des mœurs a soutenu le despotisme. Dans cet état de choses, c'est à qui vendra son âme au plus fort pour légitimer l’injustice et diviniser la tyrannie. Alors la raison n'est plus que folie ; l'égalité, anarchie ; la liberté, désordre ; la nature, chimère ; le souvenir des droits de l’humanité, révolte : alors on a des bastilles et des échafauds pour la vertu, des palais pour la débauche, des trônes et des chars de triomphe pour le crime : alors on a des rois, des prêtres, des nobles, des bourgeois, de la canaille, mais point de peuple et point d’hommes.
« Voyez ceux mêmes d'entre les législateurs que le progrès des lumières publiques semble avoir forcés à rendre quelque hommage aux principes ; voyez s'ils n'ont pas employé leur habileté à les éluder lorsqu’ils ne pouvaient plus les raccorder à leurs vues personnelles ; voyez s’ils ont fait autre chose que varier les formes du despotisme et les nuances de l’aristocratie ! Ils ont fastueusement proclamé la souveraineté du peuple, et ils l’ont enchaîné ; tout en reconnaissant que les magistrats sont des mandataires, ils les ont traités comme ses dominateurs et comme ses idoles ; tous se sont accordés à supposer le peuple insensé et mutin, et les fonctionnaires publics essentiellement sages et vertueux. Sans chercher des exemples chez les nation étrangères, nous pourrions en trouver de bien frappants au sein de notre révolution, et dans la conduite même des législateurs qui nous ont précédés. Voyez avec quelle lâcheté elles encensaient la royauté ! avec quelle impudence elles prêchaient la confiance aveugle pour les fonctionnaires publics corrompus, avec quelle insolence elles avilissaient le peuple ! avec quelle barbarie elles l'assassinaient ! Cependant voyez de quel côté étaient les vertus civiques : rappelez-vous les sacrifices généreux de l’indigence, et la honteuse avarice des riches ; rappelez-vous le sublime dévouement des soldats, et les infâmes trahisons des généraux ; le courage invincible, la patience magnanime du peuple ; et le lâche égoïsme, la perfidie odieuse de ses mandataires !
« Mais ne nous étonnons pas trop de tant d'injustices. Au sortir d’une si profonde corruption comment pouvaient-ils respecter l'humanité, chérir l'égalité, croire à la vertu ? Nous, malheureux, nous élevons le temple de la liberté avec des mains encore flétries des fers de la servitude ! Qu'était notre ancienne éducation, sinon une leçon continuelle d’égoïsme et de sotte vanité ? Qu'étaient nos usages et nos prétendues lois, sinon le code de l'impertinence et de la bassesse, où le mépris des hommes était soumis à une espèce de tarif, et gradué suivant des règles aussi bizarres que multipliées ? Mépriser et être méprisé, ramper pour dominer, esclaves et tyrans tour à tour, tantôt à genoux devant un maître, tantôt foulant aux pieds le peuple, telle était notre destinée, telle était notre ambition à nous tous tant que nous étions, hommes bien nés ou hommes bien élevés, honnêtes gens ou gens comme il faut, hommes de loi et financiers, robins ou hommes d'épée. Faut-il donc s'étonner si tant de marchands stupides, si tant de bourgeois égoïstes conservent encore pour les artisans ce dédain insolent que les nobles prodiguaient aux bourgeois et aux marchands eux-mêmes ? Ô le noble orgueil ! ô la belle éducation ! Voilà cependant pourquoi les grandes destinées du monde sont arrêtées ! voilà pourquoi le sein de la patrie est déchiré par des traîtres ! voilà pourquoi les satellites féroces des despotes de l'Europe ont ravagé nos moissons, incendié nos cités, massacré nos femmes et nos enfants ! Le sang de trois cent mille Français a déjà coulé ; le sang de trois cent mille autres va peut-être couler encore afin que le simple laboureur ne puisse siéger au sénat à côté du riche marchand de grains, afin que l’artisan ne puisse voter dans les assemblées du peuple à côté de l’illustre négociant ou du présomptueux avocat, et que le pauvre intelligent et vertueux ne puisse garder l’attitude d'un homme en présence du riche imbécile et corrompu ! Insensés, qui appelez des maîtres pour ne point avoir d’égaux, croyez-vous donc ne que les tyrans adopteront tous les calculs de votre triste vanité et de votre lâche cupidité ? Croyez-vous que le peuple, qui a conquis la liberté, qui versait son sang pour la patrie quand vous dormiez dans la mollesse ou que vous conspiriez dans les ténèbres, se laissera enchaîner, affamer, égorger par vous ? Non. Si vous ne respectez ni l’humanité, ni la justice, ni l’honneur, conservez du moins quelque soin de vos trésors, qui n'ont d'autre ennemi que l’excès de la misère publique, que vous aggravez avec tant d'imprudence ! Mais quel motif peut toucher des esclaves orgueilleux ? La voix de la vérité qui tonne dans les cœurs corrompus ressemble aux sons qui retentissent dans les tombeaux, et qui ne réveillent point les cadavres.
« Vous donc à qui la liberté, à qui la patrie est chère, chargez-vous seuls du soin de la sauver ; et puisque le moment où l’intérêt pressant de sa défense semblait exiger toute votre attention, est celui où l’on veut élever précipitamment l’édifice de la Constitution d’un grand peuple, fondez-la du moins sur la base éternelle de la vérité !
« Posez d’abord cette maxime incontestable que le peuple est bon, et que ses délégués sont corruptibles, que c’est dans la vertu et dans la souveraineté du peuple qu’il faut chercher un préservatif contre les vices et le despotisme du gouvernement.
« De ce principe incontestable tirons maintenant des conséquences pratiques, qui sont autant de bases de toute Constitution libre.
« La corruption des gouvernements a sa source dans l’excès de leur pouvoir et dans leur indépendance du souverain. Remédiez à ce double abus.
« Commencez par modérer la puissance des magistrats.
« Jusqu'ici les politiques qui ont semblé vouloir faire quelque effort, moins pour défendre la liberté que pour modifier la tyrannie, n'ont pu imaginer que deux moyens de parvenir à ce but : l'un est l'équilibre des pouvoirs, et l'autre le tribunat.
« Quant à l'équilibre des pouvoirs, nous avons pu être les dupes de ce prestige dans un temps où la mode semblait exiger de nous cet hommage à nos voisins, dans un temps où l'excès de notre propre dégradation nous permettait d'admirer toutes les institutions étrangères qui nous offraient quelque faible image de la liberté ; mais pour peu qu'on réfléchisse on s'aperçoit aisément que cet équilibre ne peut être qu'une chimère ou un fléau ; qu'il supposerait la nullité absolue du gouvernement s'il n'amenait nécessairement une ligue des pouvoirs rivaux contre le peuple ; car on sent aisément qu'ils aiment beaucoup mieux s'accorder que d'appeler le souverain pour juger sa propre cause : témoin l'Angleterre, où l'or et le pouvoir du monarque font constamment pencher la balance du même côté ; où le parti de l'opposition même ne paraît solliciter de temps en temps la réforme de la représentation nationale que pour l'éloigner, de concert avec la majorité qu'elle semble combattre ; espèce de gouvernement monstrueux, où les vertus publiques ne sont qu'une scandaleuse parade, où le fantôme de la liberté anéantit la liberté même, où la loi consacre le despotisme, où les droits du peuple sont l’objet d'un trafic avoué, où la corruption est dégagée du frein même de la pudeur.
« Eh ! que nous importent les combinaisons qui balancent l'autorité des tyrans ? C'est la tyrannie qu'il faut extirper : ce n'est pas dans les querelles de leurs maîtres que les peuples doivent chercher l'avantage de respirer quelques instants, c'est dans leur propre force qu'il faut placer la garantie de leurs droits.
« C'est par la même raison que je ne suis pas plus partisan de l'institution du tribunat ; l'histoire ne m'a pas appris à la respecter. Je ne confie point la défense d’une si grande cause à des hommes faibles ou corruptibles ; la protection des tribuns suppose l’esclavage du peuple. Je n'aime point que le peuple romain se retire sur le Mont-Sacré pour demander des protecteurs à un sénat despotique et à des patriciens insolents : je veux qu'il reste dans Rome, et qu'il en chasse tous ses tyrans. Je hais autant que les patriciens eux-mêmes et je méprise beaucoup plus ces tribuns ambitieux, ces vils mandataires du peuple, qui vendent aux grands de Rome leurs discours et leur silence, et qui ne l'ont quelquefois défendu que pour marchander sa liberté avec ses oppresseurs.
« Il n'y a qu'un seul tribun du peuple que je puisse avouer, c’est le peuple lui-même : c'est à chaque section de la République française que je renvoie la puissance tribunitienne ; et il est facile de l'organiser d'une manière également éloignée des tempêtes de la démocratie absolue et de la perfide tranquillité du despotisme représentatif.
« Mais avant de poser les digues qui doivent défendre la liberté publique contre les débordements de la puissance des magistrats, commençons par la réduire à de justes bornes.
« Une première règle pour parvenir à ce but, c'est que la durée de leur pouvoir doit être courte, en appliquant surtout ce principe à ceux dont l’autorité est plus étendue ;
« 2° Que nul ne puisse exercer en même temps plusieurs magistratures ;
« 3° Que le pouvoir soit divisé ; il vaut mieux multiplier les fonctionnaires publics que de confier à quelques-uns une autorité trop redoutable ;
« 4° Que la législation et l’exécution soient séparées soigneusement.
« 5° Que les diverses branches de l'exécution soient elles-mêmes distinguées le plus qu'il est possible, selon la nature même des affaires, et confiées à des mains différentes.
« L’un des plus grands vices de l'organisation actuelle c'est la trop grande étendue de chacun des départements ministériels, où sont entassées diverses branches d'administration très distinctes par leur nature.
« Le ministère de l'intérieur surtout, tel qu'on s'est obstiné à le conserver jusqu'ici provisoirement, est un monstre politique, qui aurait provisoirement dévoré la République naissante si la force de l'esprit public, animé par le mouvement de la révolution, ne l'avait défendue jusqu'ici et contre les vices de l’institution et contre ceux des individus.
« Au reste, vous ne pourrez jamais empêcher que les dépositaires du pouvoir exécutif ne soient des magistrats très puissants ; ôtez-leur donc toute autorité et toute influence étrangère à leurs fonctions.
« Ne permettez pas qu'ils assistent et qu'ils votent dans les assemblées du peuple pendant la durée de leur agence. Appliquez la même règle aux fonctionnaires publics en général. Eloignez de leurs mains le trésor public ; confiez-le à des dépositaires et à des surveillants qui ne puissent participer eux-mêmes à aucune autre espèce d’autorité.
« Laissez dans les départements, et sous la main du peuple, la portion des tributs publics qu'il ne sera pas nécessaire de verser dans la caisse générale, et que les dépenses soient acquittées sur les lieux autant qu'il sera possible.
« Vous vous garderez bien de remettre à ceux qui gouvernent des sommes extraordinaires, sous quelque prétexte que ce soit, surtout sous le prétexte de former l'opinion.
« Toutes ces manufactures d'esprit public ne fournissent que des poisons : nous en avons fait récemment une cruelle expérience, et le premier essai de cet étrange système ne doit pas nous inspirer beaucoup de confiance dans ses inventeurs. Ne perdez jamais de vue que c'est à l'opinion publique de juger les hommes qui gouvernent, et non à ceux-ci de maîtriser et de créer l'opinion publique.
« Mais il est un moyen général et non moins salutaire de diminuer la puissance des gouvernements au profit de la liberté et du bonheur du peuple. Il consiste dans l'application, de cette maxime, énoncée dans la Déclaration des Droits que je vous ai proposée. La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société, elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile.
« Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner : laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui ; laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient pas essentiellement à l'administration générale de la République ; en un mot, rendez à la liberté individuelle et tout ce qui n'appartient pas naturellement à l'autorité publique, et vous aurez laissé d'autant moins de prise à l'ambition et à l'arbitraire.
« Respectez surtout la liberté du souverain dans les assemblées primaires. Par exemple, en supprimant ce code énorme qui entrave et qui anéantit le droit de voter sous le prétexte de le régler, vous ôterez des armes infiniment dangereuses à l'intrigue et au despotisme des directoires ou des législatures ; de même qu’en simplifiant le code civil, en abattant la féodalité, les dîmes, et tout le gothique édifice du droit canonique, on rétrécit singulièrement le domaine du despotisme judiciaire. Quelqu'utiles que soient toutes ces précautions, vous n’aurez rien fait encore si vous ne prévenez la seconde espèce d'abus que j'ai indiquée, qui est l’indépendance du gouvernement.
« La Constitution doit s'appliquer surtout à soumettre les fonctionnaires publics à une responsabilité imposante, en les mettant dans la dépendance réelle non des individus, mais du souverain.
« Celui qui est indépendant des hommes se rend bientôt indépendant de ses devoirs : l'impunité est la mère comme la sauvegarde publique, et le peuple est toujours asservi dès qu'il n'est plus craint.
« Il est deux espèces de responsabilité, l’une qu’on peut appeler morale, et l'autre physique.
« La première consiste principalement dans la publicité ; mais suffit-il que la Constitution assure la publicité des opérations et des délibérations du gouvernement ? Non, il faut encore lui donner toute l'étendue dont elle est susceptible.
« La nation entière a le droit de reconnaître la conduite de ses mandataires. Il faudrait, s'il était possible, que l'assemblée des délégués du peuple délibérât en présence du peuple entier ; un édifice vaste et majestueux, ouvert à douze mille spectateurs, devrait être le lieu des séances du corps législatif ; sous les yeux d'un si grand nombre de témoins, ni la corruption, ni l'intrigue, ni la perfidie n'oseraient se montrer ; la volonté générale serait seule consultée ; la voix de la raison et de l’intérêt public serait seule entendue. Mais l'admission de quelques centaines de spectateurs encaissés dans un local étroit et incommode offre-t-elle une publicité proportionnée à l’immensité de la nation, surtout lorsqu'une foule d'ouvriers mercenaires effraient le corps législatif pour intercepter ou pour altérer la vérité par les récits infidèles qu'ils répandent dans toute la République ? Que serait-ce donc si les mandataires eux-mêmes méprisaient cette petite portion du public qui les voit, s'ils voulaient faire regarder comme deux espèces d'hommes différentes les habitants du lieu où ils résident et ceux qui sont éloignés d'eux, s'ils dénonçaient perpétuellement ceux qui sont les témoins de leurs actions à ceux qui lisent leurs pamphlets, pour rendre la publicité non seulement inutile, mais funeste à la liberté ?
« Les hommes superficiels ne devineront jamais quelle a été sur la révolution l’influence du local qui a recelé le corps législatif, et les hommes de mauvaise foi n'en conviendront pas ; mais les amis éclairés du bien public n'ont pas vu sans indignation qu'après avoir appelé les regards du peuple autour d'elle pour résister à la cour, la première législature les ait fuis autant qu'il était en son pouvoir lorsqu'elle a voulu se liguer avec la cour contre le peuple ; qu'après s'être en quelque sorte cachée à l’Archevêché, où elle porta la loi martiale, elle se soit renfermée dans le Manège, où elle s'environna de baïonnettes pour ordonner le massacre des meilleurs citoyens au Champ-de-Mars, sauver le parjuré Louis, et miner les fondements de la liberté ! Ses successeurs se sont bien gardés d’en sortir. Les rois ou les magistrats de l'ancienne police faisaient bâtir en quelques jours une magnifique salle d'Opéra, et, à la honte de la raison humaine, quatre ans se sont écoulés avant qu'on eût préparé une nouvelle demeure à la représentation nationale ! Que dis-je ? celle même où elle vient d'entrer est-elle plus favorable à la publicité et plus digne de la nation ? Non, tous les observateurs se sont aperçus qu’elle a été disposée avec beaucoup d'intelligence par le même esprit d'intrigue, sous les auspices d'un ministre pervers, pour retrancher les mandataires corrompus contre les regards du peuple. On a même fait des prodiges en ce genre ; on a enfin trouvé le secret, recherché depuis si longtemps, d'exclure le public en l’admettant ; de faire qu'il puisse assister aux séances, mais qu'il ne puisse entendre, si ce n'est dans le petit espace réservé aux honnêtes gens et aux journalistes ; qu’ils soit absent et présent tout à la fois, la postérité s'étonnera de l'insouciance avec laquelle une grande nation a souffert si longtemps ces lâches et grossières manœuvres, qui compromettaient à la fois sa dignité, sa liberté et son salut.
« Pour moi, je pense que la Constitution ne doit pas se borner à ordonner que les séances du corps législatif et des autorités constituées seront publiques, mais encore qu'elle ne doit pas dédaigner de s'occuper des moyens de leur assurer la plus grande publicité ; qu'elle doit interdire aux mandataires le pouvoir d'influer en aucune manière sur la composition de l’auditoire, et de rétrécir arbitrairement l'étendue du lieu qui doit recevoir le peuple. Elle doit pourvoir à ce que la législature réside au sein d'une immense population, et délibère sous les yeux de la plus grande multitude possible de citoyens infinie.
« Le principe de la responsabilité morale veut encore que les agents du gouvernement rendent à des époques déterminées et assez rapprochées des comptes exacts et circonstanciés de leur gestion ; que ces comptes soient rendus publics par la voie de l'impression, et soumis à la censure de tous les citoyens ; qu'ils soient envoyés en conséquence à tous les départements, toutes les administrations et à toutes les communes.
« A l'appui de la responsabilité morale il faut déployer la responsabilité physique, qui est en dernière analyse la plus sûre gardienne de la liberté ; elle consiste dans la punition des fonctionnaires publics prévaricateurs.
« Un peuple dont les mandataires ne doivent compte à personne de leur gestion n'a point de constitution ; un peuple dont les mandataires ne rendent compte qu'à d'autres mandataires inviolables n'a point de constitution, puisqu’il dépend de ceux-ci de le trahir impunément, et de le laisser trahir par les autres. Si c'est là le sens qu'on attache au gouvernement représentatif, j'avoue que j'adopte tous les anathèmes prononcés contre lui par Jean-Jacques Rousseau. Au reste, ce mot a besoin d’être expliqué, comme beaucoup d'autres, ou plutôt il s'agit bien moins de définir le gouvernement français que de le constituer.
« Dans tout état libre les crimes publics des magistrats doivent être punis aussi sévèrement et aussi facilement que les crimes privés des citoyens, et le pouvoir de réprimer les attentats du gouvernement doit retourner au souverain.
« Je sais que le peuple ne peut pas être un juge toujours en activité, aussi n'est-ce pas là ce que je veux ; mais je veux encore moins que ses délégués soient des despotes au-dessus des lois. On peut remplir l'objet que je propose par des mesures simples dont je vais développer la théorie.
« 1° Je veux que tous les fonctionnaires publics nommés par le peuple puissent être révoqués par lui, selon les formes qui seront établies, sans autre motif que le droit imprescriptible qui lui appartient de révoquer ses mandataires.
« 2° Il est naturel que le corps chargé de faire les lois surveille ceux qui sont commis pour les faire exécuter : les membres de l'agence exécutive seront donc tenus de rendre compte de leur gestion au corps législatif. En cas de prévarication, il ne pourra pas les punir, parce qu'il ne faut pas lui laisser ce moyen de s'emparer de la puissance exécutive ; mais il les accusera devant un tribunal populaire, dont l'unique fonction sera de connaître ces prévarications des fonctionnaires publics. Les membres du corps législatif ne pourront être poursuivis par ce tribunal pour raison des opinions qu'ils auront manifestées dans les assemblées, mais seulement pour les faits positifs de corruption ou de trahison dont ils pourraient être prévenus. Les délits ordinaires qu'ils pourraient commettre sont du ressort des tribunaux ordinaires. Dans l'un et dans l'autre cas ils pourront être jugés, ainsi que les autres fonctionnaires et les autres citoyens, sans qu'il soit nécessaire que le corps législatif ait déclaré qu'il y a lieu à accusation contre eux ; seulement l'accusateur public du tribunal sera tenu d'informer le corps législatif des poursuites dirigées contre les membres prévenus.
« A l'expiration de leurs fonctions les membres de la législature et les agents de l'exécution ; ou ministres, pourront être déférés au jugement solennel de leurs commettants : le peuple prononcera simplement s'ils ont conservé ou perdu sa confiance. Le jugement qui déclarera qu'ils ont perdu sa confiance emportera l'incapacité de remplir aucune fonction publique. Le peuple ne décernera pas de peine plus forte ; et si les mandataires sont coupables de quelques crimes particuliers et formels, il pourra les renvoyer au tribunal établi pour les punir.
« Ces dispositions s’appliqueront également aux membres du tribunal populaire.
« Quelque nécessaire qu'il soit de contenir les magistrats, il ne l'est pas moins de les bien choisir : c'est sur cette double base que la liberté doit être fondée. Ne perdez pas de vue que dans le gouvernement représentatif il n'est pas de lois constitutives aussi importantes que celles qui garantissent la pureté des élections.
« Ici je vois répandre de dangereuses erreurs ; ici je m’aperçois qu'on abandonne les premiers principes du bon sens et de la liberté pour poursuivre de vaines abstractions métaphysiques. Par exemple, on veut que dans tous les points de la République les citoyens votent pour la nomination de chaque mandataire, de manière que l'homme de mérite et de vertu qui n'est connu que de la contrée qu'il habite ne puisse jamais être appelé à représenter ses compatriotes, et que les charlatans fameux, qui ne sont pas toujours les meilleurs citoyens ni les hommes les plus éclairés, ou les intrigants portés par un parti puissant qui dominerait dans toute la République, soient à perpétuité et exclusivement les représentants nécessaires du peuple français.
« Mais en même temps on enchaîne le souverain par des règlements tyranniques ; partout on dégoûte le peuple des assemblées ; on en éloigne les sans-culottes par des formalités infinies : que dis-je ? on les chasse par la famine, car on ne songe pas même à les indemniser du temps qu'ils dérobent à la subsistance de leurs familles pour le consacrer aux affaires publiques.
« Voilà cependant les principes conservateurs de la liberté que la constitution doit maintenir : tout le reste n'est que charlatanisme, intrigue et despotisme.
« Faites en sorte que le peuple puisse assister aux assemblées publiques, car lui seul est l'appui de la liberté et de la justice : les aristocrates, les intrigants en sont les fléaux.
« Qu'importe que la loi rende un hommage hypocrite à l’égalité des droits, si la plus impérieuse de toutes les lois, la nécessité, force la partie la plus saine et la plus nombreuse du peuple à y renoncer ? Que la patrie indemnise l'homme qui vit de son travail lorsqu'il assiste aux assemblées publiques ; qu'elle salarie par la même raison d'une manière proportionnée tous les fonctionnaires publics ; que les règles des élections, que les formes des délibérations soient aussi simples, aussi abrégées qu'il est possible ; que les jours des assemblées soient fixés aux époques les plus commodes pour la partie laborieuse de la nation.
« Que l'on délibère à haute voix : la publicité est l'appui de la vertu, la sauvegarde de la vérité, la terreur du crime, le fléau de l'intrigue. Laissez les ténèbres et le scrutin secret aux criminels et aux esclaves : les hommes libres veulent avoir le peuple pour témoin de leurs pensées. Cette méthode forme les citoyens aux vertus républicaines ; elle convient à un peuple qui vient de conquérir sa liberté, et qui combat pour la défendre : quand elle cesse de lui convenir la République n'est déjà plus.
« Au surplus, que le peuple, je le répète, soit parfaitement libre dans ses assemblées ; la Constitution ne peut établir que les règles générales, nécessaires pour bannir l'intrigue et maintenir la liberté même ; toute autre gêne n’est qu'un attentat à la souveraineté.
« Qu'aucune autorité constituée surtout ne se mêle jamais ni de sa police, ni de ses délibérations.
« Par-là vous aurez résolu le problème encore indécis de l'économie politique populaire, de placer dans la vertu du peuple et dans l'autorité du souverain le contrepoids nécessaire des passions du magistrat et de la tendance du gouvernement à la tyrannie.
« Au reste, n’oubliez pas que la solidité de la Constitution elle-même s’appuie sur toutes les institution, sur toutes les lois particulières d'un peuple ; quelque nom qu'on leur donne ; elles doivent toutes concourir avec elle au même but ; elle s'appuie sur la bonté des mœurs, sur la connaissance et sur le sentiment des droits sacrés de l’homme.
« La déclaration des Droits est la constitution de tous les peuples ; les autres lois sont muables par leur nature et sont subordonnées à celle là. Qu'elle soit sans cesse présente à tous les esprits ; qu'elle brille à la tête de votre code public : que le premier article de ce code soit la garantie formelle de tous les droits de l'homme ; que le second porte que toute loi qui les blesse est tyrannique et nulle ; qu’elle soit portée en pompe dans vos cérémonies publiques ; qu'elle frappe les regards du peuple dans toutes ses assemblées, dans tous les lieux où résident ses mandataires ; qu'elle soit écrite sur les murs de nos maisons ; qu'elle soit la première leçon que les pères donneront à leurs enfants.
« On me demandera peut-être comment, avec des précautions si sévères contre les magistrats, je puis assurer l’obéissance aux lois et au gouvernement. Je réponds que je l’assure davantage précisément par ces précautions là même : je rends aux lois et au gouvernement toute la force que j’ôte aux vices des hommes qui gouvernent et qui font les lois.
« Le respect qu’inspire le magistrat dépend beaucoup plus du respect qu’il porte lui-même aux lois que du pouvoir qu'il usurpe, et la puissance des lois est bien moins dans la force militaire qui les entoure que dans leur concordance avec les principes de la justice et avec la volonté générale.
« Quand la loi a pour principe l'intérêt public, elle a le peuple lui-même pour appui, et sa force est la force de tous les citoyens, dont elle est l'ouvrage et la propriété. La volonté générale et la force publique ont une origine commune : la force publique est au corps politique ce qu'est au corps humain le bras, qui exécute spontanément ce que la volonté commande, et repousse tous les objets qui peuvent menacer le cœur ou la tête.
« Quand la force publique ne fait que seconder la volonté générale, l'état est libre et paisible ; lorsqu'elle la contrarie, l'état est asservi ou agité.« La force publique est en contradiction avec la volonté générale dans deux cas : ou lorsque la loi n’est pas la volonté générale, ou lorsque le magistrat l’emploie pour violer la loi. Telle est l'horrible anarchie que les tyrans ont établie de tout temps sous le nom de tranquillité, d'ordre public, de législation et de gouvernement ; tout leur art est d'isoler et de comprimer chaque citoyen par la force pour les asservir tous à leurs odieux caprices, qu'ils décorent du nom de loix.
« Législateurs, faites des lois justes ; magistrats, faites-les religieusement exécuter : que ce soit là toute votre politique, et vous donnerez au monde un spectacle inconnu, celui d'un grand peuple libre et vertueux.Art. I. La Constitution garantit à tous les Français les droits imprescriptibles de l'homme et du citoyen énoncés dans la déclaration précédente.
II. Elle déclare tyrannique et nul tout acte de la législation ou du gouvernement qui les viole.
III. La Constitution française ne reconnaît d'autre gouvernement légitime que le gouvernement républicain, ni d'autre république que celle qui est fondée sur la liberté et sur l'égalité.
IV. La République française est une et indivisible.
V. La souveraineté réside essentiellement dans le Peuple Français ; tous les fonctionnaires publics sont ses mandataires : il peut les révoquer de la même manière qu'il les a choisis.
VI. La Constitution ne reconnaît d'autre pouvoir que celui du souverain ; les diverses portions d'autorités exercées par les différens magistrats, ne sont que des fonctions publiques, qu'il leur délègue pour l'avantage commun.
VII. La population et l'étendue de la République obligent le peuple français à se diviser en sections, pour exercer sa souveraineté ; mais ses droits ne sont ni moins réels, ni moins sacrés que s'il délibérait tout entier, dans une assemblée unique.
En conséquence, chaque section du souverain ne peut être soumise, ni à l'influence, ni aux ordres d'aucune autorité constituée, et les mandataires qui attentent, soit à la liberté, soit à la sûreté, soit à la dignité d'une portion du peuple, sont coupables de rebellion envers le peuple entier.
VIII. Afin que l'inégalité des biens ne détruise point l'égalité des droits, la Constitution veut que les citoyens qui vivent de leur travail, soient indemnisés du tems qu'ils consacrent aux affaires publiques, dans les assemblées du peuple où la loi les appelle.
IX. La durée des fonctions des mandataires du peuple ne peut excéder deux années.
X. Nul ne peut exercer à la fois deux emplois publics.
XI. Les fonctions exécutives, les fonctions législatives et les fonctions judiciaires sont séparées.
XII. La Constitution ne veut pas que la loi même puisse garantir la liberté individuelle, sans aucun profit pour le bien public ; elle laisse aux communes le droit de régler leurs propres affaires, en ce qui tient à l'administration générale de la République.
XIII. Les délibérations de la législature et de toutes les autorités constituées, seront publiques : la publicité qu'exige la Constitution est la plus grande publicité possible. La législature doit tenir ses séances dans un lieu qui puisse admettre douze mille spectateurs.
XIV. Tout fonctionnaire public est responsable au (sic) peuple.
XV. Il sera établi un tribunal dont l'unique fonction sera de connaître de leurs prévarications.
XVI. Les membres de la législature ne pourront être poursuivis, par aucun tribunal constitué, pour raison des opinions qu'ils auront manifestées dans l'assemblée ; mais à l'expiration de leurs fonctions, leur conduite sera solennellement jugée par le peuple qui les aura choisis. Le peuple prononcera sur cette question : tel citoyen a-t-il répondu oui ou non à la confiance dont le peuple l'a honoré ?
XVII. Les faits positifs de corruption et de trahison qui pourraient être imputés aux fonctionnaires publics dont il est parlé aux deux articles précédens, seront jugés par le tribunal populaire, et leurs délits privés, par les tribunaux ordinaires.
XVIII. Tous les membres de la législature et tous les membres de l'agence exécutive, seront tenus de rendre compte de leur fortune, deux ans après l'expiration de leur autorité.
XIX. Lorsque les droits du peuple seraient violés par un acte de la législature, ou du gouvernement, chaque département pourra le déférer à l'examen du reste de la République ; et dans le délai qui sera déterminé, les assemblées primaires s'assembleront pour manifester leur vœu sur ce point.
XX. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen sera placée dans l'endroit le plus apparent des lieux où les autorités constituées tiendront leurs séances ; elle sera portée, en pompe, dans toutes les cérémonies publiques ; elle sera le premier objet de l'instruction publique.
19:51 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 9.1. PAROLES D'HOMMES | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : robespierre, démocratie, discours, universel, principes | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |




